f
mr
: la houe
un
outil agricole à travers le
temps et l'espace
Aboubacry Moussa LAM
Article publié dans
ANKH n°2
Résumé
: En Égypte ancienne "mr ",
désigne une houe qui existait en deux modèles respectivement grand et
petit. En Afrique noire contemporaine on retrouve des outils agricoles
analogues à la fois dans leurs formes et dans leurs modes d'utilisation.
A cela s'ajoute une terminologie commune de l'espace agricole et du
pouvoir terrien en Égypte ancienne et chez les Peuls de la région du
fleuve Sénégal ainsi que chez les Mandingues de Casamance pris comme
exemples. Des faits, qui avec tant d'autres (cf. Ankh n°1),
traduisent l'unité culturelle profonde existant entre les anciens
Égyptiens et les Négro-Africains d'aujourd'hui.
Abstract
: —
mr
, A
FARMING INSTRUMENT THROUGH TIME AND SPACE
— In
Ancient Egypt, "mr", denoted a large or small hoe. In contemporary Black
Africa, similarly shaped hoes are used for the same agricultural tasks
as in Ancient Egypt. Also, the terminology used for designating
agricultural space and land ownership by Fulaani of the Senegal river
region and the Mandingo of Casamance is the same as in Ancient Egypt.
These are only several of numerous examples (cf. Ankh n°1)which
indicate the deep cultural unity connecting the ancient Egyptians with
present day Negro Africans.
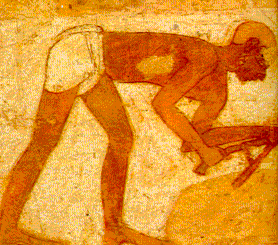
Tombe de Rekhmiré, XVIIIème dynastie, Thèbes
I. Introduction
Les
relations entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire ont
donné lieu à de nombreux écrits depuis la naissance de l'égyptologie, en
1822. L'opinion dominante fut d'abord que l'Égypte n'avait rien à voir
avec son environnement africain.
Depuis le colloque du Caire
(1974), les égyptologues occidentaux acceptent, presque à regret, que
c'est à partir d'un complexe paléo-africain que s'est individualisée la
civilisation pharaonique [1].
Ce qui semble être une
position très conciliante cache, en réalité, une nouvelle stratégie qui
vise toujours à séparer l'Égypte ancienne de l'Afrique noire. En effet,
dans l'entendement des tenants de cette thèse, c'est seulement après
l'individualisation de la civilisation égyptienne à partir dudit
complexe, que cette dernière, à la suite de mutations rapides, décolle
littéralement, laissant sur place, pour ainsi dire, le reste de
l'Afrique. Autrement dit, la plupart des similitudes existant entre
l'Égypte ancienne et l'Afrique noire, s'expliqueraient par cette
"période obscure" : l'Égypte rayonnante avait déjà coupé le cordon
ombilical qui la reliait au reste de l'Afrique noire.
Le but de cette étude est de
démontrer, à travers un outil agricole, qu'un tel point de vue n'est pas
soutenable ; car même s'il faut reconnaître que de nombreux cas de
similitude renvoient en effet à ce qu'il est convenu d'appeler "l'aire
culturelle périsaharienne", beaucoup d'autres, et vraisemblablement les
plus nombreux, supposent une vie commune dans la vallée du Nil même, et
après l'individualisation de la civilisation égyptienne.

Le roi Scorpion la houe (mr)
en main (A.
Shmolean Museum, Oxford) :
La scène représente la
fondation d'un temple. Il s'agit d'une représentation réalisée sur
une tête de massue en calcaire qui remonterait au prédynastique tardif,
vers 3600 avant notre ère (?). Le roi Scorpionqui appartient à la
communauté des Anouis, tient ce surnom de l'image martelée d'un scorpion
qui figure en face du visage.
II. La description de l'outil
mr
Pour
qui connaît la place de l'agriculture dans l'Égypte ancienne, le choix
d'un outil agricole dont le rôle est fondamental dans le procès de
production afin d'atteindre l'objectif visé, ne saurait surprendre.
L'outil en question est le
mr à travers lequel les égyptologues identifient généralement une
houe. Il se présente sous deux formes :
- un grand modèle avec un
manche suffisamment long pour être manipulé dans la position debout
(voir photo n°1) ;
- un petit modèle dont le
manche très court suppose un certain fléchissement de l'utilisateur
(voir photo n° 2).
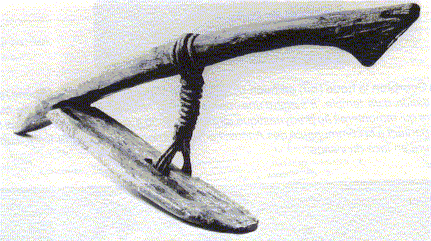
Petit modèle de houe
égyptienne (mr) (Musée du Louvre).
La solidité est assurée par
une torsade de fibres végétales.
La première
version se présente avec deux pièces de bois dont celle qui sert de
manche est percée d'un trou dans lequel vient s'ajuster la deuxième qui
joue le rôle de pointe ou de tranchant. Pour s'assurer de la solidité de
l'ensemble, les anciens Égyptiens n'hésitaient pas, souvent, à relier
les deux éléments par une torsade de corde en fibres végétales. Dans ce
cas, si nous ne tenons pas compte de la corde, nous pouvons affirmer que
le mr était entièrement en bois. On comprend dès lors pourquoi le
bout qui entrait en contact avec le sol était taillé en biseau dans la
plupart des cas.
En dehors de ses proportions
plus modestes déjà signalées, la deuxième version se singularise par un
tranchant franchement large ou plus ou moins pointu à la base [2]. On
peut raisonnablement supposer que des soucis de fonctionnalité étaient à
l'origine de ce détail technique.
Au lieu d'être totalement en
bois, l'outil pouvait recevoir un tranchant en métal. Pour le
grandmodèle, il n'y a aucun doute à ce sujet (voir photo n°1 où, sur
certains des modèles, on distingue nettement une partie métallique).
Pour le petit modèle,
nous n'avons pas réussi à trouver un exemplaire nous permettant d'être
catégorique, mais la présence de houes métalliques (voir photo n° 3) et
de manches en bois (PÉTRIE,
ibid., planche LXVIII) dans le matériel archéologique de l'Égypte
rend la chose fortement probable.
Les deux versions du
mr
s'expliquent selon nous par des destinations différentes :
La première servait
vraisemblablement à creuser des trous ou à décaper assez profondément le
sol par endroits. Pour cela, il fallait imprimer à l'outil un certain
mouvement qui, pour avoir toute la vigueur requise, nécessitait la
station debout.
La deuxième, elle, servait à
décaper légèrement et de manière homogène le sol, donc à labourer.
Evidemment ce ne sont là que les usages principaux, la plupart des
outils agricoles étant multifonctionnels : le mr pouvait servir,
par exemple, à éliminer les souches, à creuser des canaux (tête de
massue du roi Scorpion).
III. La houe en Afrique de l'Ouest
En
Afrique noire nous retrouvons un peu partout l'équivalent du mr égyptien, mais nous choisirons nos exemples chez les Haal-Pulaar'en de
la région du fleuve Sénégal et les Mandingues de Casamance.
Chez les premiers nous avons
le njinndaangu et le jalo qui ressemblent respectivement, à quelques
détails près, aux deux versions du mr egyptien :
Pour le grand modèle nous
avons ici, à la place des deux pièces de bois emboîtées l'une dans
l'autre et raffermies par une torsade de corde, une seule pièce de bois,
en réalité une branche fourchue et un bandage de cuir au niveau de la
fourche. Le tranchant est bien entendu une houe en fer (photo n° 4).

Houes mandingues
(Musée del'IFAN-Cheikh Anta Diop, Dakar)
La seule
différence entre le petit et le grand modèle réside au niveau de la
taille des outils, même le bandage de cuir du premier est parfois
présent sur certains exemplaires du deuxième.
Comme en Égypte, l'outil le
plus grand est manipulé par un travailleur en station debout alors que
le plus petit exige, lui, la flexion de l'utilisateur.
Chez les Mandingues il
existe aussi deux modèles : un grand et un petit, qui sont manipulés
dans les mêmes conditions et qui ont les mêmes fonctions que celles
décrites plus haut. Ils se présentent tous les deux sous la forme de
deux pièces de bois dont la première, fourchue, est solidement attachée
à la deuxième par un savant entrelacs de fibres végétales (ici l' écorce
de bambou). Le détail technique digne d'être noté ici, c'est bien
entendu le croissant de métal entourant le tranchant de l'outil (voir
photos n°5 et n°6 où malheureusement le rajout métallique n'est pas
perceptible).
La similitude de ce
tranchant avec celui de certains exemplaires égyptiens mérite aussi d'êtresignalée.
On peut supposer ici que le croissant de métal n'a été qu'une perfection
technique opérée sur un outil qui, à l'origine, était sans doute
entièrement en bois comme celui de l'Égypte ancienne.
L'extrême similitude, jusque
dans les moindres détails, entre les exemplaires égyptiens et
négro-africains actuels, ne laisse aucun doute sur leur origine commune.
Cette origine renvoie-t-elle à l'aire culturelle périsaharienne
c'est-à-dire à la période précédant l'individualisation de la
civilisation égyptienne ? Apparemment rien ne s'y oppose mais le fait
que l'art rupestre, si riche, n'ait pas conservé les traces de l'outil
dans le vaste Sahara, laisse planer un sérieux doute sur son existence à
cette époque. Et même si une invention précoce ne peut pas être
totalement exclue, il faudra sans doute se faire à l'idée que les
modèles à tranchant métallique ont dû voir le jour dans la vallée du Nil
et après l'individualisation de la civilisation égyptienne. En effet, le
travail des métaux ne se développe, semble-t-il, qu'à partir de la
période prédynastique [3]. Il se trouve que ce sont des tranchants de
même type que les Haal-pulaar'en de la région du fleuve Sénégal
utilisent encore de nos jours.
Voilà déjà un premier indice
qui prouve que la fameuse rupture que se plaisent à évoquer certains
spécialistes n'est pas intervenue au moment où ils la placent.
Vraisemblablement, de nombreuses populations négro-africaines ont
continué leur cohabitation avec les anciens Égyptiens dans la vallée du
Nil même.
IV. Quelques termes liés à la terre en
égyptien, pulaar et wolof
Si
le mr égyptien ressemble tant à certains outils agricoles
négro-africains, c'est parce tous résultent d'une même technique de
fabrication millénaire et qu'ils s'adaptent à un milieu particulier :
celui d'une vallée alluviale, à l'origine celle du Nil. A cet égard, il
est hautement significatif que le nom de l'outil en égyptien (mr)
corresponde en pulaar au terme désignant ce à quoi il était destiné : rem-
qui veut dire cultiver, travailler la terre. Il a suffi, pour
obtenir ce résultat, de procéder à une simple permutation des deux
consonnes de mr et d'intercaler une voyelle entre elles.
Dans le même ordre d'idée,
signalons que rmnyt : exploitation, en égyptien, correspond au
pulaar remnata : ce qui fait cultiver, i.e. l'exploitation ou
celui qui l'accorde. Notons aussi qu'il n'est pas indifférent de savoir
que rmn — demi-aroure en égyptien — correspond au pulaar
leemn- [4] : arpentable, faire arpenter (une exploitation). Ce
dernier rapprochement est très important car il met en évidence la
source commune des pouvoirs terriens égyptien et négro-africain.
En effet, Laman en
wolof et en séreer désigne le maître de la terre, c'est-à-dire celui à
qui la tradition donne le pouvoir d'arpenter au profit de la communauté
(leeman en pulaar) des domaines individuels.
Cette prérogative du maître
de terre (jom jatti en pulaar) résulte du principe du droit du
premier occupant. A ce niveau, il ne serait pas inutile de noter que jatti existe aussi en wolof. Dans cette langue, le terme signifie
"nature sauvage (inhabitée par l'homme)" alors qu'en pulaar il renvoieà
la propriété foncière, au fief. La différence de sens entre le wolof et
le pulaar n'est qu'apparente: en effet la possession territoriale qui
devient un fief ne peut s'exercer, en vertu même du principe du droit du
premier occupant, que sur une nature encore inhabitée par l'homme. Il
s'agit donc en fait de deux visions renvoyant à des phases différentes
d'une seule et même réalité.
La graphie du terme égyptien
correspondant :

d3tt
: terre, propriété, domaine, État, est très intéressante à analyser.
Précisons avant tout que l'existence des termes wolof et pulaar permet
de lever définitivement le doute qu'épigraphistes, philologues etc.
faisaient planer sur la lecture de ce mot [5].
Le premier signe
hiéroglyphique représente un territoire agricole sillonné de canaux
d'irrigation [6]. Cela signifie que nous sommes en présence d'une
civilisation agraire. Empressons-nous d'ajouter que cette dernière est
aussi urbaine car le déterminatif du mot est constitué par l'idéogramme
de la villeÖ.
Il serait presque superflu d'insister sur le fait que le contenu du
terme égyptien d3tt ne peut renvoyer qu'à la vallée du
Nil, le premier endroit qui ait vu éclore une civilisation à la fois
agraire et urbaine.
Si c'est effectivement ce
terme que nous retrouvons en wolof et en pulaar, nous tenons notre
deuxième indice prouvant que la séparation n'a pas été aussi précoce
qu'on se plaît à le dire dans certains milieux ; et c'est heureux que ce
deuxième indice soit étroitement lié à notre outil (mr). En
effet, sur la tête de massue du roi Scorpion, c'est précisément un
pharaon armé d'un mr qu'on voit s'activant à creuser un canal.
V. Conclusion
Cette
saisissante réalité nous permet de conclure notre étude en réaffirmant
que le lien entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire ne
s'est pas coupé avant l'éclosion de la civilisation pharaonique mais
bien après l'affirmation de cette dernière ; et d'autres faits de
civilisation permettent de situer la rupture au crépuscule de ce qui fut
l'histoire la plus longue de l'humanité.
Notes et références
[1] Rapport
final du colloque annexé au Volume II de L'Histoire générale de
l'Afrique, publiée sous l'égide de l'UNESCO.
[2] Voir
ces détails in PETRIE (W.M.F.), Tools and Weapons, British School of Archaeology in Egypt, 30, London, 1917, planche
LXIII et p. 54.
[3] Pour le
fer, l'unanimité est loin d'être faite entre les tenants du travail
précoce du fer en Égypte (Ancien Empire) et ceux qui soutiennent que ce
métal n'a été introduit dans le pays que vers la fin de la période
pharaonique (VIIe siècle avant J.C.). Affirmons sans équivoque que les
arguments présentés par Cheikh Anta DIOP, chef de file du premier
groupe, nous paraissent plus convaincants que ceux de ses adversaires :
cf. Cheikh Anta DIOP, "La métallurgie du fer sous l'Ancien Empire
égyptien", BIFAN, série B, t. .XXXV, n° 3, 1973, p. 532-547.
[4] Le r
et le l permutaient en égyptien
[5]
GARDINER (A.H), Egyptian Grammar, sign-list, p. 488, n° 24 et
FAULKNER (R.O.), A Concise Dictionary of' Middle Egyptian, p.
319.
[6]
GARDINER (A.H.), Ibid.

