La
recherche
et l'histoire ancienne de l'Afrique
Quels
sont les résultats récents de la recherche - en paléontologie, biologie
moléculaire, physico-chimie, archéologie, histoire, linguistique,
égyptolologie, etc. - qui intéressent l'histoire ancienne de l'Afrique,
thématisée, à partir de 1954, par Cheikh Anta Diop dans Nations nègres et Culture
? C'est à cette question qu'il est
succinctement répondu ci-après.
 1. La
paléontologie, l'archéologie, la génétique et l'origine de l'homme
1. La
paléontologie, l'archéologie, la génétique et l'origine de l'homme
Toumaï. Son
découvreur est Ahounta
Djimdoumalbaye,
juillet 2001
(A. Beauvilain, L'Aventure humaine,
Paris, La Table Ronde, 2003)
Dans l'état
actuel de nos connaissances, le continent de l'apparition de l'Homme est
l'Afrique, surnommée pour cette raison berceau de l'humanité. La
liste des hominidés découverts dans le sol africain s'allonge
régulièrement, de Toumaï et Orrorin vieux d'environ 7 et 6
millions d'années à Omo I, homo sapiens sapiens daté de
195 000 ans, en passant par les Australopithèques qui ont vécu il
y a environ 4 millions d'années, les Homo habilis, 2,5 millions
d'années, les Homo ergaster, 2,2 millions d'années, les Homo
erectus, 2 millions d'années. Cette énumération ne préjuge
pas du caractère linéaire ou buissonnant de l'évolution
humaine qui aboutit à l'homme moderne.
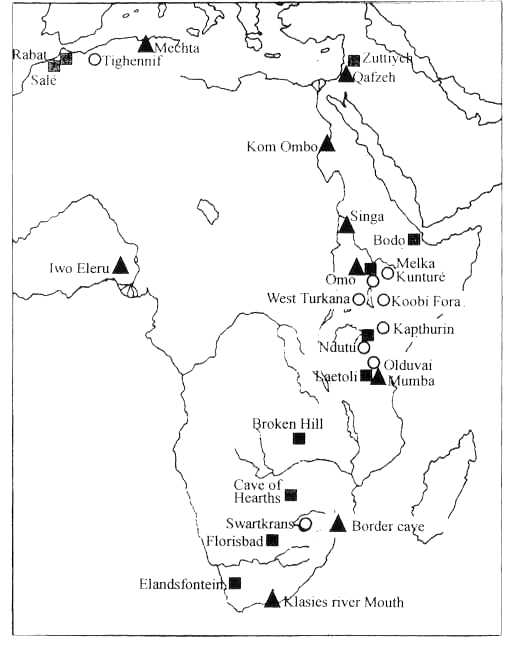
Sites des fossiles en Afrique
et au Proche- Orient
Pour ce qui concerne Homo sapiens sapiens
(ou homme moderne), rappelons-le, deux interprétations sont en
présence :
- La première
est celle de la monogenèse africaine de l'humanité qui fait naître
l'humanité actuelle en une région unique : l'Afrique. L'apparition des
races actuelles est un phénomène "récent" qui résulte de l'adaptation de
l'Homo sapiens sapiens africain aux nouvelles conditions
géo-climatiques et de vie rencontrées lors de son émigration sur les
autres continents. La thèse monogénétique, reformulée en 1976 par Williams Howells, est de nouveau reprise par le paléontologue
allemand Günter Bräuer en 1982. Cette thèse est
aujourd'hui connue sous le nom de "modèle Out of Africa"ou
encore "Arche de Noé" parce qu'elle considère que seuls les
Hommes modernes d'Afrique ont survécu remplaçant complètement les
descendants des Homo erectus, et les Néandertaliens
qui
s'étaient perpétués en Asie et en Europe.
- La seconde,
celle du polycentrisme ou encore théorie multirégionale,
(ou modèle du Candélabre) soutient que les différentes races
actuelles sont issues d'une évolution parallèle sur chaque continent de
l'homo erectus qui avait émigré hors d'Afrique. Elle est défendue
par des paléontologues comme Milford H. Wolpof et Wu Xhingzi.
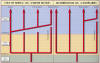
Une troisième
théorie intermédiaire dite réticulaire imagine des échanges
constants de gènes entre les populations de l'Asie et de l'Afrique par
le biais de migrations fréquentes réciproques. Par ce phénomène
d'échange les deux continents auraient ainsi contribué à constituer le
patrimoine génétique des premiers hommes modernes. Les hommes
modernes auraient alors un double berceau l'Afrique et l'Asie.
Paléontologie
En 1988, les
paléontologues Günter Bräuer, Reiner Protsch, Christopher Stringer concluent à l'origine africaine monogénétique
de l'homme moderne.
En 1994, dans
la revue ANKH, Günter Bräuer, paléo-anthropologue de l'Université de Hambourg, en Allemagne, fait le point sur le modèle
"Out of Africa" c'est-à-dire sur la thèse de l'origine
monogénétique africaine de l'homo sapiens sapiens :
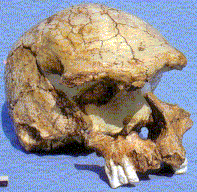
"... l'homme
anatomiquement moderne s'est développé il y a un peu plus de 100 000 ans
en Afrique subsaharienne, à partir d'une lignée évolutive facile à
suivre. Cet homme moderne s'est répandu dans le Nord et au
Proche-Orient".
Il apporte de
nouvelles données confortant ce modèle, en 1996 à Dakar (Sénégal), lors
du colloque international "L'oeuvre de Cheikh Anta Diop et la
Renaissance africaine au seuil du 3ème millénaire"
confortant le modèle "Out of Africa". Puis en juin 1998, dans le
cadre du colloque Humanity from African Naissance to Coming Millenia
- Colloquia in Human Biology and Palaeoanthropology, qui s'est tenu
à Sun City en Afrique du Sud il procède à une analyse critique du modèle
"Out of Africa" en essayant de cerner d'une part le processus de
"modernisation" de l'homme en Afrique à partir d'un homo sapiens
archaïque et d'autre part le processus de remplacement des
populations humaines archaïques par les hommes modernes dans les
différentes régions du monde, en Afrique, en Europe, en Asie orientale
et en Australie. Ce remplacement s'est-il produit selon un phénomène
biologique complexe impliquant des croisements entre populations
modernes nouvellement arrivées et populations archaïques locales ou bien
s'est-il déroulé "brutalement" sans mélange entre les deux types de
populations et aboutissant à l'extinction des populations archaïques ?
Si les plus récentes données archéologiques et analyses anthropologiques
paraissent confirmer l'antériorité de la présence des "near-modern
humans" en Afrique subsaharienne, des spécialistes s'interrogent
néanmoins sur le ou les scenarii qui ont mené jusqu'à l'humanité
contemporaine.
Tout
récemment l'annonce a été faite de la découverte de nouveaux fossiles d'homo
sapiens en Éthiopie, datant de d'environ 160 000 ans (homo idaltu).
Les études qui en ont été faites notamment par le paléontologue
éthiopien Berhane Asfaw et américain Tim D. White,
permettent d'affirmer encore :
"Their
anatomy and antiquity constitute strong evidence of modern-human
emergence in Africa" et que "... modern human morphology emerged
in Africa long before the Neanderthals vanished from Eurasia".

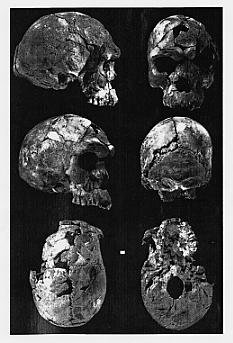
Le paléontologue éthiopien Berhane Asfaw -
Homo Idaltu : homo sapiens sapiens vieux de 160 000
ans trouvé en Ethiopie
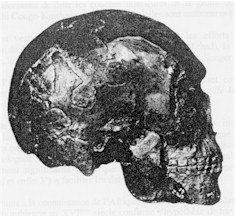
Crâne fossile OMO1 : homo sapiens sapiens
découvert par le paléontologue Louis Leakey, en 1967, dans le sud de l'Ethiopie
(Kibish Formation). Initialement daté de 130 000 ans, il a été récemment
re-daté par une équipe de chercheurs australiens et américains. Cette
nouvelle datation fournit 195 000 ans ± 5000 ans, faisant de
ce fossile le plus ancien représentant de l'homme anatomiquement moderne
bien daté. Cf. Nature, vol. 433, 17 february 2005.
De plus, les récentes études démontrant la
discontinuité génétique entre les homo sapiens sapiens (hommes
modernes) et les homo neandertalensis (hommes de Neandertal)
renforcent encore la théorie de l'origine monogénétique africaine de
l'homme moderne tout en rendant toujours plus irrecevable au plan
scientifique l'hypothèse polycentrique.

Jean-Jacques
Hublin, qui dirige le laboratoire Dynamique de l'évolution
humaine du CNRS à Paris, écrit dans un article intitulé "Climat
de l'Europe et origine des Néandertaliens" :
"Les vestiges
exhumés depuis 150 ans en Europe indiquent que, il y a 40 000 ans
environ, l'Europe a été colonisée par des hommes semblables aux
Européens d'aujourd'hui, quoique plus robustes : leur haute taille et
leurs proportions corporelles semblables à celles des Africains actuels
témoignent de leur origine tropicale".
Pascal Picq,
du Collège de France, ajoute :
"Tous
parents, mais tous différents. Toutes les femmes et tous les hommes
d'aujourd'hui appartiennent à une seule espèce. Comment expliquer ces
différences à partir d'une origine commune ? Une certitude cependant,
les premières femmes et les premiers hommes modernes avaient la peau
noire".
Archéologie
Les gravures
et les artefacts trouvés aux cours des années 1990 dans la Grotte de
Blombos à 200 kilomètres du Cap en Afrique du Sud, datés d'environ
77000 ans constituent une autre confirmation de l'antériorité de l'homme moderne en Afrique par rapport aux autres continents (homo
sapiens sapiens). Cet art, le plus ancien connu dans le monde, à ce
jour, précède de 30000 à 40000 ans le magnifique art pariétal du Sud de
l'Europe (La Grotte Chauvet en France, le site d'Altamira
en Espagne, ...).
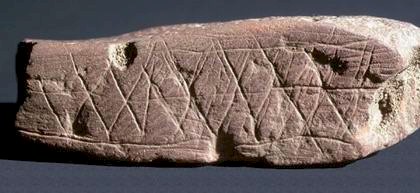
Ocre gravé trouvé dans la grotte de
Blombos en Afrique du Sud daté de - 77000 ans. Cet objet, comportant
une série de lignes parallèles, est la première attestation connue de
l'existence de la "pensée symbolique" qui caractérise l'homme moderne (homo
sapiens sapiens). L'homme moderne apparaît pour la première fois,
en Afrique, il y a plus de 130000 ans. Vers - 40000 ans, il sort du
continent africain et peuplera l'Asie, l'Europe, l'Océanie, ....
D'autres nombreux objets ont été également découverts dans cette grotte
(cf. Henshilwood, C.S., Sealy, J.S., Yates, R., Cruz-Uribe, K.,
Goldberg, P., Grine, F.E., Klein, R.G., Poggenpoel, C.A., van Niekerk,
K. & Watts, I. 2001, "Blombos Cave, Southern Cape, South Africa :
Preliminary Report on the 1992-1999 Excavations of the Middle Stone Age
Levels", Journal of Archaeological Science, 28, 421-448 ; "Emergence
of modern human behavior : Middle Age Engravings from South Africa",
Michael Balter, "From a Modern Human's Brow or Doodling ?, Science,
vol. 295, 11 January 2002, pp. 247-248 ; Hervé Morin, "Quand Homo
sapiens jouait les artistes en Afrique du Sud", Le Monde,
mercredi 16 janvier 2002, p. 24).
Richard
Mankiewicz, dans son livre L'histoire des mathématiques,
mentionne que :
"Le plus
ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland en
Afrique australe. Il date d'environ 35000 ans av. J.-C. et consiste en
un péroné de babouin portant 29 encoches nettement visibles."
Génétique
Parallèlement
à la découverte, à l'étude et à la datation des fossiles, des industries
lithiques, des sites d'occupation du sol, des peintures rupestres, la
biologie moléculaire, avec les études du sang, des gènes chromosomiques,
de l'ADN mitochondrial, apporte aussi son éclairage propre sur l'origine
de l'homme (l'homme moderne plus particulièrement). Elle propose, en
effet, une chronologie des processus de différentiation des populations
actuelles d'Europe, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique à partir de
populations d'origine africaine, grâce à "l'horloge moléculaire".
L'idée de ce chronomètre moléculaire avait été émise en 1963 par E. Zuckerkandl et L. Pauling: son principe repose sur le fait
que les protéines qui composent les êtres vivants subissent des
modifications (mutations des gènes codant les protéines) au cours du
temps avec l'hypothèse que le taux de mutation est constant en fonction
du temps. Ce type d'études s'est développé d'abord dans les années 1970
avec M. Nei et A. Roychoudury, ensuite par Jim
Wainscoat, Allan C. Wilson et ses collaborateurs, Gérard
Lucotte et Jacques Ruffié. Depuis, ces études n'ont cessé de
se multiplier. Luigi Luca Cavalli-Sforza et son équipe
établissent des recoupements entre les données de la biologie
moléculaire, les données de la linguistique et celles de la
paléontologie.
En septembre
1998, la revue américaine Proceedings of the National Academy of
Sciences publie un article co-signé par des chercheurs généticiens
chinois (Pékin, Shanghaï) et américains (Houston au Texas) qui assigne
une origine africaine aux populations chinoises, renforçant encore le
modèle "Out of Africa". Ces résultats sont confirmés, en 2001,
dans un article de la revue Science et intitulé "African
Origin of Modern Humans in East Asia : A tale of 12,000 Y Chromosomes"
:
"This result
indicates that modern humans of African origin completely replaced
earlier populations in East Asia".
Les résultats
de la recherche génétique, de plus en plus nombreux, semblent converger
vers la même conclusion d'une origine commune africaine et "récente" de
l'humanité actuelle. En juin 1999, la revue Pour la Science a
produit un dossier très complet sur "Les origines de l'humanité"
abordant aussi bien les aspects paléontologiques que génétiques. Une
toute nouvelle et imposante synthèse intitulée Aux origines de
l'humanité a été élaborée sous la direction d'Yves Coppens et
Pascal Picq du Collège de France.
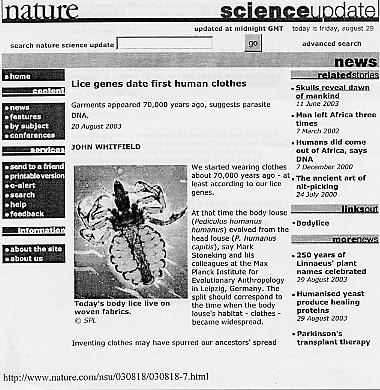
Les résultats
des investigations génétiques font écrire à Bryan Sykes,
chercheur et professeur de génétique à l'Université d'Oxford, dans son
livre Les sept filles d'Eve :
"Dans le
schéma multirégional, un Européen moderne et un Chinois moderne auraient
eu un dernier ancêtre commun voici au moins un million d'années. Suivant
le scénario Out of Africa, en revanche, ils étaient encore liés par un
passé beaucoup plus récent. Le mérite de l'arbre des gènes fondé sur
l'étude de la mitochondrie est d'avoir pour la première fois introduit
dans l'équation une échelle chronologique objective. Il a établi très
clairement que l'ancêtre mitochondriale commune de tous les
humains modernes vivait il y a quelque 150000 ans seulement. Cela
cadrait parfaitement avec les tenants de la théorie de l'école Out of
Africa, qui se sont réjouis de cette découverte."
Il ressort de ce qui précède que les
résultats les plus récents de la recherche obtenus conjointement dans
les domaines de la paléontologie, de l'archéologie et la génétique
présentent une forte cohérence d'ensemble et une convergence remarquable
confirmant la validité de la théorie de l'origine monogénétique et
africaine de l'homme moderne (homo sapiens sapiens). C'est
pourquoi, aujourd'hui, cette théorie recueille l'accord du plus grand
nombre des savants dans le monde. Dès 1962, à partir de l'analyse des
résultats de la paléo-anthropologie humaine et de l'archéologie déjà
acquis et disponibles à cette époque, Cheikh Anta Diop avait soutenu la
théorie de l'origine monogénétique et africaine de l'homme moderne,
notamment dans son étude intitulée "Histoire primitive de l'Humanité.
Évolution du monde noir".
 2. Biologie
moléculaire et momies égyptiennes 2. Biologie
moléculaire et momies égyptiennes
Le philosophe
grec Xénophane, cité par Arnold Toynbee, notait :
"Les
Ethiopiens disent que leurs dieux ont le nez camus et la peau noire, et
les Thraces que les leurs ont les yeux bleus et les cheveux roux. A
supposer que les boeufs et les chevaux aient des mains et veuillent
dessiner de leurs mains et faire des oeuvres d'art comme les hommes, les
chevaux représenteraient leurs dieux sous la forme de chevaux, les boeufs
sous la forme de boeufs, et dessineraient leurs corps sur le modèle du
leur."
Le phénotype
nègre des anciens Egyptiens était un fait d'évidence dans l'Antiquité.
Le témoignage unanime des "auteurs anciens" comme Hérodote,
surnommé "le père de l'Histoire", Aristote, philosophe éminent de
l'Antiquité, Lucien, Apollodore, Eschyle, Strabon,
Diodore de Sicile, Diogène Laërce, Ammien
Marcellin, etc. indiquent sans équivoque que les Egyptiens anciens
sont des Noirs comme tous les naturels du continent africain.
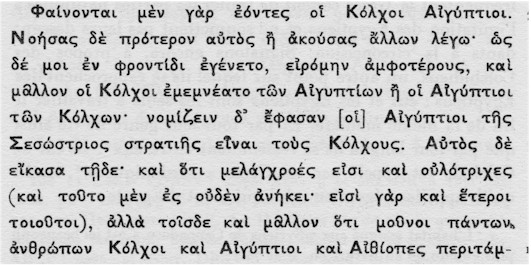
L'égyptologue
Mubabinge Bilolo a analysé le témoignage d'Aristote à
partir du texte grec dans l'article intitulé : "Aristote et la
mélanité des anciens Egyptiens", montrant ainsi qu'il y a
concordance entre les résultats de l'analyse philologique et ceux de
l'analyse bio-anthropologique. Vont encore dans le même sens, les
conclusions de l'enquête historique minutieuse et palpitante menée par
l'égyptologue Aboubacry Moussa Lam dans son livre L'Affaire des Momies
royales - La vérité sur la reine Ahmès Nefertari, à partir des
rapports de fouilles et d'analyses établis par les égyptologues et les
anthropologues à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
siècle.
C'est cette
appartenance de l'Egypte pharaonique au monde négro-africain, qui
explique que le qualificatif "noir" est attribué par les Egyptiens
anciens à leur pays, à eux-mêmes et à leurs dieux.
Nous avons vu
précédemment que souhaitant apporter des éléments complémentaires sur
cette question :
"Cheikh Anta
Diop propose, d'abord en 1967, puis de nouveau en 1973, de recourir à
l'anthropologie physique en déterminant la pigmentation des anciens
Egyptiens par un dosage de la mélanine contenue dans la peau des momies
égyptiennes. La mélanine est en effet le corps chimique responsable de
la couleur de la peau. Dans une étude publiée en 1973, il indique
l'existence de plusieurs méthodes possibles de dosage de la mélanine. Il
met en oeuvre l'une d'entre elles (technique des coupes minces
observées en lumière ultra-violette ou naturelle) pour étudier la
pigmentation de la peau de quelques momies égyptiennes conservées au
laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme de Paris, et
provenant des fouilles de l'égyptologue Auguste Mariette. Par
cette même méthode il propose l'analyse de la couleur de la peau de
toutes les momies royales authentiques conservées au Caire telles que
celles de Thoutmosis III, Séthi 1er, Ramsès II, etc. C'est en
vain qu'il a attendu les échantillons de peau de quelques mm2
de surface promis par le Conservateur du Musée du Caire de
l'époque. Par ailleurs, il s'étonne qu'une telle analyse n'ait pas été
déjà tentée par d'autres chercheurs." En février 1974, il présente les
résultats de ses analyses au Colloque du Caire sur Le peuplement de
l'Egypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique.
Cinq années
plus tard, une table ronde sur l'Anthropologie physique des anciens
Egyptiens se tient à Grenoble du 12 au 14 septembre 1979. Elle est
organisée par le CNRS sous l'autorité des professeurs Yves Coppens
et Eugen Strouhal. On y trouve une contribution intitulée : "Étude
de la peau des Egyptiens prédynastiques" par E. Rabino Massa
(Instituto di Antropologia, Università di Torino). L'auteur écrit
:
"L'étude de
la peau des anciens Egyptiens peut avoir un intérêt considérable, tant
du point de vue de la paléopathologie, car elle permet de reconnaître
des maladies, que du point de vue anthropologique pour la détermination
de l'origine ethnique des populations humaines".
Si l'article
ne comporte pas de résultats quantitatifs du taux de mélanine présent
dans les échantillons de peau prélevés sur des momies égyptiennes, il
confirme la présence de grains de mélanine et la faisabilité de son
dosage :
"L'analyse
histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la
stratification typique de l'épiderme et de relever la présence de
granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale".

Jean Bernard,
qui a été Directeur de l'Institut de recherches sur les leucémies et
maladies du sang, Président de l'Académie des Sciences et
membre de l'Académie française, dans son ouvrage Le sang et
l'histoire (1983), montre que l'analyse du sang permet de
caractériser les populations, évoquant au passage le cas de la momie de
Nakht :
"Les groupes
sanguins, les hémoglobines, les enzymes, restent les mêmes (sauf
rarissimes exceptions) de la naissance à la mort. Au-delà de la mort.
L'examen de la momie du tisserand égyptien Nakht, qui vivait du temps de
Ramsès II, a montré que le tisserand appartenait au groupe sanguin B.
Permanence héréditaire. Ces caractères sanguins se transmettent
immuables de génération en génération selon les lois de la génétique
mendélienne. Ils sont les témoins aisément accessibles, très fidèles, de
notre patrimoine génétique. L'étude des caractères du sang, de leurs
variations reflète très exactement l'état, les variations des gènes qui
gouvernent les caractères du sang. La permanence des caractères du sang
qui exprime la permanence génétique permet de reconna"tre, de définir,
au long des siècles, les populations."
Depuis plus
d'une dizaine d'années, les techniques de la biologie moléculaire, plus
précisément celles mises en oeuvre pour l'étude de l'ADN et des gènes
anciens ou archéogénétique, sont appliquées à l'étude des momies
égyptiennes comme l'illustrent les travaux du chercheur suédois Svante Pääbo travaillant au Département de Zoologie de l'Université
de Munich, l'un des initiateurs de l'archéologie moléculaire.
En effet, le professeur Svante Pääbo a produit, en 1985, la
première mise en évidence de la préservation de l'ADN dans les restes
humains et la démonstration de la possibilité non seulement de le
récupérer mais aussi de le dupliquer. Dans un article intitulé "A
molecular approach to the study of Egyptian History", Svante Pääbo et
Anna Di Rienzo de l'Université de Berkeley
en Californie, indiquent que les premières investigations portant sur l'ADN
mitochondrial ont été menées sur les populations de l'Afrique
sub-saharienne en 1989 puis du Japon, de la Sardaigne et du Nord ouest
des Etats-Unis. Ils mentionnent également une étude en cours du même
type sur la population du Delta du Nil dans le but de formuler des
hypothèses sur l'origine et l'histoire de cette population. Les auteurs
soulignent le long travail nécessaire à l'obtention de résultats avec
une statistique correcte, c'est-à-dire scientifiquement pertinents.
Eric Crubézy,
professeur d'anthropologie à l'Université Paul Sabatier à Toulouse,
signale dans un article intitulé "Les surprises de l'ADN ancien - Une
technique miracle à manier avec précaution", l'analyse de l'ADN de
deux corps inhumés dans la nécropole d'Adaïma, en Egypte, 3700
ans avant J.-C. :
"Celui-ci
[l'ADN] les apparente aussi à des populations d'origine subsaharienne,
ce que confortent des éléments morphologiques et épidémiologiques
concernant l'ensemble de la population".
Analyses de
la pigmentation de la peau, analyses des groupes sanguins et analyses de
l'ADN, en particulier des momies royales égyptiennes autochtones
authentiques, sont donc autant de techniques d'investigation
opérationnelles dont les résultats doivent d'être connus afin de
contribuer à la reconstitution objective du passé.
 3. Biologie moléculaire, populations et
migrations
3. Biologie moléculaire, populations et
migrations
Jean Bernard,
cité plus haut, consacre un chapitre de son livre au sang et à
l'histoire des migrations. Il y montre, sur des exemples concrets,
comment certaines énigmes ont pu être résolues ou des controverses
stoppées grâce à l'analyse du sang, . :
" Que sont
réellement les Ainu ? Blancs ou Jaunes ? d'où viennent-ils ? Les
controverses ouvertes par les descriptions de La Pérouse se poursuivent
depuis deux cents ans ... Les études du sang des Ainu, l'hématologie ont
permis de répondre aux questions posées, de classer les Ainu". ...
"Ainsi, l'hématologie est formelle ; les Ainu ne sont pas des Blancs.
Ils sont, très vraisemblablement, des Asiatiques différents des Japonais
actuels, de vieux Asiatiques".
"L'histoire
des migrations indo-européennes, l'histoire des expéditions des
Normands, l'histoire des conquêtes des souverains Khmers sont, toutes
trois, bien connues. Dans les trois cas, d'utiles confirmations ont été
apportées par l'étude du sang, par l'étude du système HLA pour les
Indo-Aryens et les Normands, par l'étude des hémoglobines pour les
Khmers"
C'est donc
dire que la biologie moléculaire contribue aussi à identifier les
mouvements migratoires humains, ainsi que l'a noté Louise
Marie Diop. dans le cas de l'Afrique, lors du 2ème
Congrès international de démographie historique tenu à Paris en juin
1987 :
"-
L.
Excoffier et ses collaborateurs ont mis en évidence une "proximité
génétique" entre "les populations dinka et nuer", d'une part, et "le
groupe de l'Afrique de l'Ouest" d'autre part.
"- Cette
constatation vient renforcer la thèse soutenue par Cheikh Anta Diop
selon laquelle des flux migratoires se sont produits de la vallée du Nil
vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'il apparaît sur le tableau des pages
496 et 497 de Nations nègres et Culture où l'auteur avait
relevé, entre autres, 33 noms ethniques communs aux Nuer, justement, et
aux Sénégalais".
 4.
L'archéologie et la métallurgie du fer en Afrique
4.
L'archéologie et la métallurgie du fer en Afrique
Contre
l'opinion diffusionniste généralement admise, postulant une origine
extra-africaine de la métallurgie du fer, Cheikh Anta Diop, soutenait en
1973, puis en 1976, l'existence d'une métallurgie du fer
endogène et ancienne en Afrique noire, celle-ci incluant l'Egypte
ancienne.
Dans une
synthèse sur l'âge de la métallurgie du fer en Afrique, L. M. Diop
montre que les données archéologiques confirment d'une part son
caractère autochtone et d'autre part son ancienneté. Elle signale que :
"- Au Massif
du Termit (entre le lac Tchad et le Massif de l'Aïr) dans le Niger
oriental , le fer est daté d'environ 1500 avant J.C., au moins, et qu'à
l'ouest de Termit, à Egaro, les dates remontent à 2500 avant J.C.
environ (G. Quéchon et al., Journal des
Africanistes, 62, 2 1992, pp 55-68).
- De
nouvelles dates significatives ont été obtenues en 1998/99 : au Cameroun
pour le site d'Oliga (zone nord de Yaoundé) une série de dates
s'échelonnant de 1300 avant J. C. à 567 ap. J.C (cf. in Paléo-anthropologie en Afrique Centrale,
Michèle Delneuf et al., L'Harmattan, 1999, chap. XIV, "L'archéologie de l'âge du fer
au Cameroun méridional'"par Joseph-Marie Essomba). En
Centrafrique, dans la région mégalithique de Bouar au site de Gbabiri
(site 77,), les dates corrigées tombent vers 800 BC (cf E. Zangato,
1999, BAR, Cambridge, série Monograph. African Archaeo n¡45 Ð cf.
aussi Journal des Africanistes n¡ 65-95,2). Ainsi l'ancienneté et
l'endogénéité de la paléo-sidérurgie africaine sont-elles maintenant
indiscutables et indiscutées".
L'archéologue
Hamady Bocoum, de l'IFAN-Ch. A. Diop (Université Cheikh Anta Diop
de Dakar), auteur de nombreux travaux sur la métallurgie du fer
en Afrique de l'Ouest, a dirigé la publication d'un ouvrage collectif
majeur, édité par l'UNESCO en 2002 et intitulé Aux origines de la
métallurgie du fer en Afrique - Une ancienneté méconnue. Dans
l'introduction générale de cet ouvrage, Hamady Bocoum indique que
:
"Depuis dix
ans en effet, beaucoup d'encre a coulé à propos du fer en Afrique et
dans le monde, et bien des schémas diffusionnistes ont succombé sous le
poids des évidences ... la chronologie du fer en Afrique continue de
tirer comme un boulet cet avatar qu'est le diffusionnisme et qui appara"t
comme un instrument de négation des cultures que l'Europe conquérante
rencontra sur son chemin. Celles-ci étaient ainsi presque partout soit
trop jeunes, soit trop rustiques ou encore insuffisamment raffinées pour
supporter la comparaison ...
"Des
convergences très fortes, reposant sur une meilleure ma"trise des
données, autorisent à accréditer l'hypothèse de l'existence d'un ou
plusieurs foyers d'invention de la sidérurgie en Afrique de l'Ouest et
du Centre, ainsi que dans la région des Grands Lacs ...
"En réalité,
aucun continent ne présente autant de variations dans la conduite de la
cha"ne opératoire de la réduction directe que l'Afrique où les artisans
ont poussé l'ingéniosité jusqu'à produire du fer dans des fourneaux
faits de troncs de bananiers."
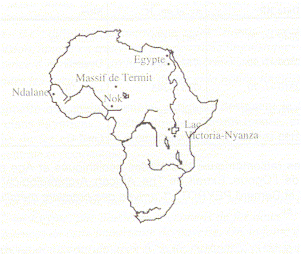 
Les sites de la métallurgie
du fer en Afrique
Outre l'aspect technologique, H. Bocoum,
A. M. Lam et M. I. Sy ont étudié l'évolution dans le temps
de la place et du rôle socio-politique de la métallurgie et du forgeron
dans les sociétés négro-africaines, de l'ancienne Egypte à la période
contemporaine.
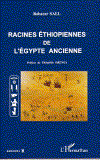 5.
L'archéologie et l'antériorité de la Nubie 5.
L'archéologie et l'antériorité de la Nubie
L'origine des anciens Egyptiens
L'historien grec Diodore de Sicile (vers 90-20 av. J.C.) écrit :
"Les
Ethiopiens disent que les Egyptiens sont une de leurs colonies qui fut
menée en Egypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au
commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil entraînant dans ses
crues beaucoup de limon d'Ethiopie, l'avait enfin comblé et en avait
fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Egyptiens tiennent
d'eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande
partie de leurs lois ; c'est d'eux qu'ils ont appris à honorer les rois
comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe ; la
sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Ethiopiens. Les
Ethiopiens allèguent d'autres preuves de leur ancienneté sur les
Egyptiens ; mais il est inutile de les rappeler ici."
Dans la
biographie qu'elle consacre à
Champollion-le-Jeune (1790-1832), le déchiffreur des
hiéroglyphes, H. Hartleben relate le retour du voyage de ce
dernier (surnommé "l'Egyptien" dans l'extrait ci-dessous) dans la Vallée
du Nil :
"Méhémet Ali
accueillit les voyageurs de retour avec la meilleure grâce, mais l'"Egyptien"
jugea plus important encore un entretien approfondi avec Ibrahim Pacha,
fils adoptif du grand vice-roi : il espérait, en effet, que celui-ci
équiperait une expédition égyptienne sous la protection de l'armée pour
explorer les sources du Nil, ou accorderait au moins son soutien actif à
une entreprise montée en Europe dans ce dessein. Alors qu'il était
professeur d'histoire à Grenoble, il avait déjà vivement déploré ce
point obscur de la science géographique, mais bien plus encore depuis
qu'il avait repris la thèse transmise par les Grecs d'une origine
haut-nilotique pour les Egyptiens et contemplé avec nostalgie depuis la
deuxième cataracte les contrées qu'il ne lui était pas donné de
visiter".
Citons
maintenant Cheikh Anta Diop :
"Nous avions
écrit dans Nations nègres et Culture et dans nos publications
ultérieures que, d'après le témoignage quasi unanime des Anciens, la
civilisation nubienne est antérieure à celle de l'Egypte et lui aurait
même donné naissance. Cela est tout à fait logique si l'on se place dans
la perspective d'un peuplement de la Vallée du Nil par une descente
progressive de peuples noirs depuis la région des Grands Lacs, berceau
de l'Homo sapiens sapiens. Mais les faits archéologiques probants
manquaient pour démontrer cette hypothèse. La lacune, semble-t-il, vient
d'être comblée, grâce aux fouilles de Keith Seele, de l'Université de
Chicago, faites au cimetière de Qostul en Nubie "
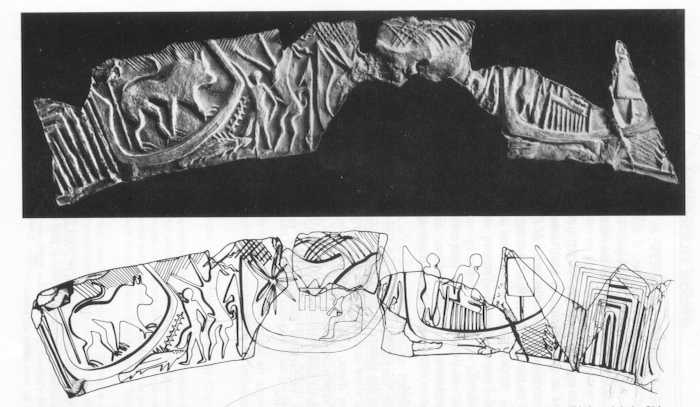
Le brûle-parfum provenant des fouilles
menées par Keith Seele à Qustul en Nubie et étudié par Bruce Williams.
Cet objet par son ancienneté et le lieu de sa découverte témoigne de
l'antériorité de l'Etat Nubien. En particulier, on distingue au centre
les attributs royaux repris plus tard par l'Etat pharaonique égytien.
En effet,
l'archéologue américain Bruce Williams qui a étudié les objets
provenant de ces fouilles effectuées dans les années soixante (le
rapport a été publié en 1986) écrit dans le Courrier de l'UNESCO :
"Grâce au
témoignage fourni par le cimetière L, la période qui précède juste la
première dynastie devient, pour la première fois, une époque historique.
Un fait étonnant se dégage, absolument contraire à toutes les idées
antérieures sur la question : pendant neuf générations au moins, de
3500-3400 à 3200-3100 avant J.C., la Nubie du groupe A fut un Etat
unifié, possédant tous les attributs d'une civilisation : un
gouvernement, un pharaon, des fonctionnaires, une religion officielle,
une écriture et des monuments, un Etat assez fort pour unir des peuples
qui n'étaient pas de même origine. C'est ainsi que les habitants du
Ta-Seti, "Le Pays de l'Arc", nom par lequel les anciens Egyptiens
désignaient la Nubie, participèrent pleinement et sur un plan d'égalité
que personne n'avait jamais soupçonné, à l'irrésistible essor de la
civilisation des rives du Nil".
L'ouvrage collectif Egypt and Africa,
Nubia from Prehistory to Islam est très riche en résultats de
diverses recherches archéologiques entreprises au Soudan. En
introduction, Jean Vercoutter dresse un tableau de
l'investigation archéologique au Soudan depuis le 18ème
siècle, avec les descriptions des ruines de Nubie faites en 1738 par le
voyageur danois Frederik Norden. Dans la dernière section de son
texte, l'auteur procède à une brève analyse prospective de
"l'archéologie nubio-soudanaise" dans laquelle il écrit :
"Les récents
travaux au Ouadi Kubanieh et dans les "Playas" du désert occidental
comme ceux entre Ve et VIe Cataractes : de Kadero,
Saggai, Kadada, el-Ghaba, devraient être étendus aux déserts ouest et
est, si l'on veut discerner l'une des composantes essentielles de la
civilisation pharaonique naissante, celle qui est venue du Sud".
Le matériel
mis au jour, en particulier celui relatif aux pratiques funéraires,
permet à Bruce Williams de caractériser les cultures anciennes de
la Nubie et d'apprécier leurs relations avec celles de l'Egypte dans un
article intitulé "A Prospectus For Exploring The Historical Essence
of Ancient Nubia", initialement publié dans l'ouvrage collectif
Egypt and Africa, Nubia from Prehistory to Islam et
reproduit, dans la revue ANKH.
D'autres
auteurs révèlent aussi l'histoire de la Nubie et son importance dans
l'Afrique ancienne comme Aminata Sakho-Autissier dans son article
"Soudan Royaumes du Nil". L'ouvrage collectif Soudan, Royaumes
sur le Nil, recèle également de nombreuses pièces
archéologiques concrétisant différents aspects des cultures de la vallée
du Nil (art, architecture, artisanat, écriture, spiritualité, etc.) et
leur évolution sur plusieurs milliers d'années.
L'ouvrage de
Babacar Sall, Racines éthiopiennes de l'Egypte ancienne, restitue le rôle
capital joué par la Nubie dans l'émergence des civilisations nilotiques.
Théophile Obenga, dans la préface, souligne trois aspects majeurs
développés par l'auteur :
"-
L'éclaircissement des relations diverses qui ont existé entre l'Ethiopie,
l'Egypte et la Libye, c'est-à-dire entre la Nubie (ancien Soudan), la
Vallée égyptienne du Nil et le plateau Nord de l'Afrique avant la
période dynastique pharaonique, c'est-à-dire avant 4000 ans avant notre
ère ;
- l'unité
géographique, ethnique et culturelle des pays nilotiques ou des contrées
du Nil que sont l'Abyssinie, le Soudan et l'Egypte, Ð ce qu'affirmaient
déjà les auteurs grecs, notamment Diodore de Sicile et Strabon, après
Hérodote, sur la base de la tradition orale pharaonique et des faits de
civilisation examinés sur place ;
- l'influence
fondatrice de l'Ethiopie (Nubie-Soudan) sur l'Egypte et le monde
saharo-maghrebin : ce point capital est la "thèse" même du professeur
Babacar Sall qui démolit, pièce par pièce, les spéculations, franchement
gratuites, sur l'origine sumérienne ou proche-orientale de la
civilisation pharaonique."
Babacar Sall,
écrit dans sa conclusion :
"La monarchie
pharaonique a dé se constituer à partir d'un stimulus éthiopien.
D'abord parce que l'encensoir de Qostul datant d'avant Narmer
porte en décor maints attributs de la monarchie d'Egypte. Parce que Narmer a appartenu à un clan de métallurgistes, en décidant du site
de Memphis, il y consacrait un temple au dieu Ptah connu à
l'époque dynastique comme dieu des forges et des métiers. La métallurgie
du cuivre a été introduite en Egypte par le type stéatopyge puisque
leurs tombes contenaient des épingles de cuivre. Ce caractère primordial
de Ptah explique qu'il débute la liste des pharaons. Il a gardé
ce statut jusqu'à la basse époque puisque les dodécarques avaient fait
de son culte le fondement de leur co-régence. Le lien entre Ptah
et Narmer permet de concevoir la monarchie de Hiéraconpolis comme
une monarchie technologique d'émanation éthiopienne. On comprend alors
que les auteurs de cette institution aient connu Pount très tôt.
"On comprend
alors la préséance du Sud en tant "qu'en soi", que dans les tombes de
Abadiyeh qui contenaient la poterie de la classe B, le mort ait
la tête orientée vers le Sud. Cette direction correspondait au Début.
Au Nouvel Empire, dans la phraséaologie triomphaliste du pharaon idéal,
on écrit que l'empire s'étendait de la "corne de la terre" au Sud
jusqu'aux "marais d'Horus" au Nord. Tel est l'ancrage de l'Egypte
dans l'Ethiopie qu'il fallait circonscrire. L'approche comparatiste qui
découle de cette donnée fait que des auteurs jettent un regard vers
l'univers Dogon. Mais cette perspective doit être comprise comme
englobant à la fois la dimension du caractère Néo-pharaonique de
l'Afrique noire post-pharaonique et celle d'un retour d'une forme
raffinée, épanouie à partir d'un substrat pan-africain".
Se trouve
donc pleinement confirmée l'existence de ce lien ombilical entre la
Nubie et l'Egypte ancienne. L'ensemble de ces travaux ont pour
conséquence salutaire, entre autres pour la recherche historique, de
supprimer cette frontière factice et stérilisante traditionnellement
érigée entre l'Egypte ancienne et le reste de l'Afrique noire.
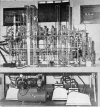 6. Datations
au Carbone 14 et antériorité de la Haute-Egypte par rapport au 6. Datations
au Carbone 14 et antériorité de la Haute-Egypte par rapport au
Delta.
L'Egypte contrée africaine.
Hérodote
critiquait l'opinion des Ioniens qui réduisaient l'Egypte au Delta. :
"Si nous
adoptions cette terminologie nous pourrions faire voir qu'autrefois les
Egyptiens n'avaient point de pays. On sait en effet que leur Delta, ils
le disent eux-mêmes, et c'est mon sentiment, est une terre d'alluvion,
une terre, peut-on dire, nouvellement apparue. Jadis d'ailleurs, on
appelait Egypte la Thébaïde, dont le pourtour est de six mille cent
vingt stades".
Cheikh Anta
Diop, qui, sur la base des témoignages d'Homère, de Sénèque,
d'Ammien Marcellin et d'Hérodote, pense que la
Haute-Egypte était antérieure au Delta, en appelle, en 1967, au verdict
des sciences exactes en ces termes :
"Ajoutons
seulement qu'aujourd'hui les méthodes physiques modernes de datation,
appliquées à l'archéologie, permettraient de trancher la question. Des
tests par le radiocarbone, pratiqués sur des carottes prélevées sur les
emplacements respectifs de ces différentes villes permettraient de
déterminer avec une certitude suffisante les dates d'émergence des
terres qui supportent ces villes et d'une façon générale l'âge du Delta
en tant que terre ferme habitable. Voilà un cas précis où la physique
moderne aiderait l'archéologie à sortir du cercle vicieux de l'exégèse
des textes".
Il
renouvellera cette proposition de prélèvement d'échantillon et de
datation croisée entre les laboratoires du radiocarbone du Caire et de
Dakar lors du colloque d'Egyptologie du Caire de 1974. Proposition qui
restera sans suite immédiate.
Toutefois,
son idée a été en quelque sorte concrétisée, plusieurs années après,
avec l'étude des niveaux de la mer à partir de datations d'échantillons
géologiques. En effet dans le chapitre 5, "Légendes, histoires, niveaux
de la mer", de son livre L'homme et le climat Jacques Labeyrie,
ancien directeur du Centre des faibles radioactivités du CEA-CNRS, à
Gif-sur-Yvette, écrit :
"Bien que ces
documents écrits soient peu nombreux au début, limités à quelques
empreintes de sceaux royaux, ils nous éclairent cependant sur les
premiers temps de l'histoire de l'Egypte, un peu avant que ne débute la
première dynastie. C'était alors l'époque nagadienne. Des rois se
succédaient depuis longtemps déjà dans l'Egypte du Sud, que l'on appelle
aussi haute Egypte, c'est-à-dire tout au long de la vallée du Nil située
plus au sud que la position actuelle du Caire. D'autres rois existaient
aussi dans l'Egypte du Nord, c'est-à-dire la région constituée par le
delta du Nil, mais ces rois du delta ne s'étaient pas installés depuis
longtemps, tout au plus depuis deux ou trois siècles : nous savons
maintenant que c'est parce qu'auparavant le delta était encore immergé.
Le lien entre l'abaissement du niveau de la mer et le développement de
la civilisation égyptienne est clair : il existe, en effet, comme nous
allons le voir maintenant, une très bonne concordance entre les dates
"Carbone 14" égyptiennes et celles de la sortie du Delta de la mer vers
- 4700. On data ainsi une quantité de restes attribuables à l'activité
humaine, dans le Delta, la vallée du Nil et aussi dans les régions qui
entourent cette vallée. Cela a permis de savoir qu'à tel moment du passé
l'homme occupait - ou n'occupait pas - ces lieux. Et de cette manière
l'on a fait une constatation très curieuse. Dans toute l'étendue du
royaume du Sud, c'est-à-dire dans la haute vallée du Nil à partir du sud
du Caire, ainsi que dans ses prolongements dans le Soudan actuel, on
trouve des artefacts humains jusque bien au-delà de -20000 On trouve
aussi de nombreux vestiges très anciens dans ce qui est aujourd'hui la
Palestine et la Jordanie, ainsi que sur le territoire de la Libye. Bref,
toute cette région du Proche-Orient s'est révélée, grâce au Carbone 14,
très anciennement peuplée, dès le paléolithique supérieur. Toute la
région, sauf le delta du Nil. Pour celui-ci, les dates Carbone 14 ne
commencent en effet que vers - 4200, soit 3000 av. J.C. Mais à partir de
ce moment, très vite, elles deviennent très nombreuses. Tout se passe en
fait comme si l'implantation humaine n'avait eu lieu dans le Delta qu'à
partir de cette date, alors que partout ailleurs, comme on vient de le
dire, elle existait depuis longtemps."
Ces résultats
montrent que le mouvement de la civilisation égyptienne du Sud vers le
delta du Nil est corrélé à l'abaissement du niveau de la mer et
recoupent parfaitement la tradition rapportée par les Anciens.
Les résultats
des fouilles archéologiques menées depuis plus de vingt cinq ans par
l'archéologue américain Fred Wendorf et son équipe dans la vallée
du Nil concluent au caractère autochtone et méridional du foyer de la
civilisation égyptienne :
"L'accumulation des données recueillies depuis 1975 au Sahara oriental
par notre équipe et depuis 1980 par une équipe de l'université de
Cologne dirigée par Rudolph Kuper sur la frontière occidentale de l'Egypte,
de Sioua jusqu'au plateau de Guilf Kebir, nous offre une vue bien
différente de la vision traditionnelle".
A propos de
ces fouilles, dans un article intitulé "Aux origines de la
civilisation", l'égyptologue Jean Vercoutter écrit en effet
que :
"D'autre
part, les plus récentes recherches ont montré que, dès la fin du
paléolithique supérieur, il y a quelque dix-sept mille cinq cents ans,
l'orge était connue dans la vallée du Nil, en Haute-Egypte, et que sa
culture s'y maintint jusqu'à ce qu'elle soit perfectionnée par les Egyptiens de l'âge prédynastique et l'Ancien Empire. Ainsi dispara"t
l'un des arguments majeurs des tenants de l'origine orientale de la
civilisation égyptienne. (...) Ainsi, l'Afrique source de civilisation
émerge dans nos hypothèses. Certes, tout est encore nébuleux".
Fred Wendorf et ses collaborateurs indiquent que les bovins domestiques du Sahara
oriental sont légèrement plus anciens que ceux d'Eurasie et que
conséquemment :
"Il faut bien
qu'ait existé en Afrique un foyer de domestication indépendant de ceux
connus plus au nord". Ils pensent que les premiers essais de
domestication des bovins en Afrique ont été effectués dans la vallée du
Nil"
où le bovin
sauvage était "couramment chassé" et ce vers 9000 av. J.C., avant
l'occupation des premiers sites dans le désert au 8e
millénaire, et à la faveur de l'installation d'une période pluvieuse.
En 1996,
Fred Wendorf fait le point sur des fouilles effectuées sur le site
très ancien de Nabta Playa, en Basse Nubie, dans un article publié dans
la revue ANKH : "Nabta
Playa During the Early and Middle Holocene".
Au vu de
l'ensemble des résultats de la recherche archéologique, l'égyptologue Jean Leclant, en 1998, fait le constat suivant :
"Voici que l'Egypte
la plus ancienne, si longtemps perçue dans un contexte asiatique par les
égyptologues, se révèle, grâce aux travaux des préhistoriens, comme
africaine."
L'observation
d'une carte de géographie montre à l'évidence que l'Egypte fait partie
du continent africain et l'archéologie confirme le caractère méridional
autochtone de ses cultures néolithiques, de ses civilisations
prédynastique et dynastique.
 7.
Linguistique et égyptologie : la parenté de l'égyptien pharaonique, du
copte et des langues négro-africaines modernes 7.
Linguistique et égyptologie : la parenté de l'égyptien pharaonique, du
copte et des langues négro-africaines modernes
Dans son
Discours
d'ouverture du cours d'archéologie au Collège Royal de France,
le 10 mai 1831, Jean-François Champollion évoque l'étude de la
langue égyptienne :
"C'est par
l'analyse raisonnée de la langue des Pharaons, que l'ethnographie
décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique, ou
bien si elle descendit, avec le fleuve divinisé, des plateaux de
l'Afrique centrale".
Le rapport du
Colloque international d'égyptologie tenu au Caire en 1974 sur Le
peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture
méroïtique reconnaît, comme on l'a vu plus haut, la valeur
scientifique de l'argumentation linguistique présentée par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga démontrant la parenté de
l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines
contemporaines.
Trois ans
après, Cheikh Anta Diop systématise la comparaison égyptien ancien -
wolof dans son livre Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues
négro-africaines.
En 1993,
Théophile Obenga,
dans L'origine commune
de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes
- Introduction à la linguistique historique, reprend de
manière exhaustive la démonstration de la parenté génétique entre
l'égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines
contemporaines, en appliquant la méthode de la linguistique historique
comparative, inaugurée par Ferdinand de Saussure. La linguistique
historique comparative a déjà fait ses preuves pour l'étude de la
parenté des langues indo-européennes, par exemple. Théophile Obenga
établit en particulier les lois de correspondances phonétiques ("sound
laws") entre les langues africaines modernes, le copte et l'égyptien
pharaonique. Il reconstruit, pour la première fois, leur ancêtre commun,
qu'il dénomme le négro-égyptien :
"L'égyptien
ancien, pharaonique, le copte, les langues négro-africaines modernes
reposent sur un idiome commun dont on vient précisément de voir les
principales caractéristiques phonologiques, phonétiques, morphologiques,
grammaticales, sémantiques et lexicologiques.
"Cet idiome
commun, pré-dialectal, nous l'appelons, faute de mieux : le
négro-égyptien, du fait qu'il englobe l'égyptien (pharaonique et
copte) et toutes les langues négro-africaines modernes, c'est-à-dire les
langues parlées aujourd'hui par les Noirs d'Afrique, mais de tout temps,
depuis toujours. Cet idiome commun est supposé par les nombreuses et
pertinentes concordances observées entre les langues attestées, ici
comparées.
"Une telle
unité linguistique, de nature génétique, indique à son tour une profonde
unité culturelle, historique, nationale des peuples dont les langues
sont justement étudiées, ici dans une perspective temporelle. Il y a eu
par conséquent une "nation négro-égyptienne", c'est-à-dire, plus
simplement, un territoire commun aux langues apparentées : la
méthodologie exige une telle supposition. Le lieu a dé être la Vallée du
Nil depuis la région de Grands Lacs africains (cette région est aussi,
actuellement, le berceau de l'humanité) et le temps vraisemblablement
10000-8000 avant notre ère ..."
Il s'agit
d'un résultat majeur, capital de la recherche linguistique et
égyptologique africaine.
Théophile
Obenga indique les raisons idéologiques qui ont conduit à introduire une
famille linguistique imaginaire le "chamito-sémitique" ou
"afro-asiatique" qui est censée regrouper les langues sémitiques
(accadien, ugaritique, phénicien, hébreu, arabe, sud-arabique),
l'égyptien (ancien égyptien, copte), le berbère (siwa, mzab, tuareg,
kabyle, rifain), les langues couchitiques (sidamo, gedeo, burji, galla,
beja, etc.) et les langues tchadiques (hausa, mada, zelgwa), non fondée
scientifiquement car elle n'a jamais été reconstruite par la méthode de
la linguistique historique :
"... Le
"chamito-sémitique" ou l'"afro-asiatique" n'existe pas dans
la matérialité des faits linguistiques. Cette famille qui n'a jamais été
reconstruite a été inventée de toutes pièces pour couper la Vallée du
Nil égypto-nubienne du reste de l'Afrique noire au plan culturel. La
recherche authentique africaine doit donc détruire définitivement le
mythe "chamito-sémitique" ou "afro-asiatique". Il y a ceux
qui font semblant, comme si le Colloque international du Caire (1974)
n'avait jamais eu lieu. Ce colloque organisé par l'UNESCO avait rejeté
l'idée du "chamito-sémitique" ou de l'"afro-asiatique" qui
n'a aucune assise linguistique probante et vérifiable."
Théophile
Obenga propose une nouvelle classification des langues africaines,
alternative à celle du linguiste J. Greenberg (promoteur de
l'afro-asiatique), et dans laquelle sont distinguéesÊtrois grandes
familles : le négro-égyptien, le berbère, le khoisan.
Le négro-égyptien comprend :
. l'égyptien
: pharaonique, copte
. le
couchitique : couchitique septentrional, couchitique central,
couchitique oriental, couchitique occidental, couchitique méridional
. le
tchadique : tchadique occidental, kotoko, bata-margi, tchadique
oriental
. le
nilo-saharien : songhai, saharien, mabien, fur, chari-nil, comien
. le
nigéro-kordofanien : Niger-Congo et kordofanien
A la IXe
Semaine d'Etudes Africaines de Barcelone, organisée par le Centre
d'Estudis Africans (CEA) et qui s'est tenue du 18 au 22 mars 1996 à
l'Université de Barcelone, le thème retenu était : L'Egypte ancienne,
une civilisation africaine. Les intervenants étaient par ordre
alphabétique : A. Anselin (Martinique), J. C. Autuori
(Barcelone, Espagne), M. Bilolo (Munich, Allemagne), T.
Duquesne (Londres, UK), C. Ehret (Los Angeles, USA), F.
Iniesta (Barcelone, Espagne), Jean Leclant (Paris, France),
J. L. Le Quellec (Brenessard, France), B. Mydant-Reynes (Toulouse, France), A. Muzzolini (Toulouse, France), O. Ndigi
(Lyon, France), T. Obenga (Philadelphie, USA), H. Satzinger
(Vienne, Autriche).
La
communication de Théophile Obenga a porté sur le thème "L'Afro-asiatique
ou le Chamito-sémitique : mythe ou réalité linguistique ?". Les
objections techniques de T. Obenga à la théorie de l'Afro-asiatique ou du Chamito-sémitique exposée par les
spécialistes C. Ehret et H. Satzinger ont de nouveau mis
en évidence le caractère artificiel et linguistiquement infondé de l'Afro-asiatique ou Chamito-sémitique, conduisant par la suite le
professeur C. Ehret à reconsidérer sa position.
Gilbert Ngom
a consacré une série de travaux à la même problématique, établissant les
lois de correspondances phonétiques entre l'égyptien pharaonique, le
copte et le duala, langue bantu parlée au Cameroun : "Rapport Egypte/Afrique
noire : aspects linguistiques", "L'Egyptien et les langues
bantu : le cas du duala", "Variantes graphiques hiéroglyphiques
et phonétique historique de l'égyptien ancien et des langues
négro-africaines modernes". L'auteur produit des parallélismes
frappants tels que ceux-ci : pour signifier : "viens vers le père",
l'égyptien hiéroglyphique et le duala présentent :

"Dans les
faits syntaxiques produits ici, les constituants des énoncés, leur
distribution, les syntagmes qu'ils génèrent et leur sens respectif, dans
les deux langues, concordent étroitement."
Et Gilbert
Ngom de conclure :
"C'est la
parenté génétique entre l'égyptien et le duala - langue bantu - qui
explique les correspondances qui se manifestent entre les deux idiomes
au niveau du vocabulaire et au niveau de la grammaire. Il s'agit là de
faits indestructibles ...".
Aboubacry Moussa Lam,
dans son livre De
l'origine égyptienne des Peuls, présente un lexique égyptien
ancien/pulaar couvrant plusieurs registres et illustrant la parenté
étroite entre les deux langues : parties du corps, termes techniques, de
déplacement et d'action, de sentiments et d'état physique,
géographiques, pastoraux, religieux, de pouvoir, termes agraires, termes
relatifs à la parenté, l'état social, l'habitat, la navigation, aux
aliments, la médecine, le bois, au feu et à la chaleur, etc..
La
connaissance intime qu'ont ces égyptologues africains des langues
négro-africaines concourt à la production de résultats tout à fait
novateurs dans le domaine de l'égyptologie, de la linguistique et plus
généralement de l'histoire des civilisations.
8.
Anthropologie socio-culturelle et égyptologie
Cheikh Anta Diop dans ses ouvrages,
rappelons-le, a étudié les traits fondamentaux de la culture
négro-égyptienne : totémisme, royauté, cosmogonie, organisation sociale,
matriarcat.
La parenté
culturelle et sociale profonde existant entre l'Egypte et l'Afrique
subsaharienne s'est enrichie ces dernières années de nouveaux travaux,
parmi lesquels on peut citer à titre d'illustration ceux portant sur :
- la culture
matérielle étudiée par Aboubacry Moussa Lam, par exemple : le mobilier,
les sceptres et les bâtons, les coiffures.
- les
systèmes graphiques et d'écritures avec les études de Théophile Obenga
dans son livre L'Afrique dans l'Antiquité (1973, et son article
"Contribution de l'égyptologie au développement de l'histoire
africaine", l'étude de Jean-Charles Coovi Gomez intitulée : "Étude
comparée de l'écriture sacrée du Danxomé et des hiéroglyphes de
l'ancienne Egypte".
- l'étude
sociologique de la société égyptienne. Les aspects abordés par Théophile
Obenga dans un article intitulé "La parenté égyptienne -
Considérations sociologiques", concernent les thèmes suivants :
"composition
familiale, familles et occupations professionnelles, dimension
diachronique de la parenté, terminologie égyptienne de la parenté,
circoncision, famille et société".
L'auteur
précise que :
"Les traits
significatifs du système parental pharaonique frappent par leur
similitude avec la plupart des systèmes de parenté africains modernes.
Il est également acquis que l'égyptien et le sémitique ne partagent
ensemble aucun terme de parenté. La théorie des deux berceaux de
civilisation de Cheikh Anta Diop trouve ici une démonstration
anthropologique et linguistique probante".
L'égyptologue
Mouhamadou Nissire Sarr étudie les rites funéraires en Egypte
pharaonique à partir des textes hiéroglyphiques des tombeaux de l'Ancien
et du Moyen Empire. Il dégage également d'importantes similitudes entre
les pratiques funéraires de l'Egypte ancienne et celles de l'Afrique
noire contemporaine. :
"En Egypte
pré-dynastique comme en Afrique noire actuelle, le corps du roi défunt
et des notables attachés à la cour royale, est enveloppé dans une peau
de boeuf avant d'être enseveli. Ce mode d'inhumation est conforme aux
représentations religieuses qu'ils se sont faites de l'animal et de ses
attributs royaux. La puissance du pharaon comme celle du roi africain
s'incarne dans celle du taureau. Les textes pharaoniques du Nouvel
Empire identifient le pharaon au taureau (Urk. IV, 1230 : 16)"
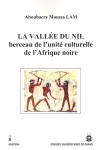 9. Recherches
pluridisciplinaires et le continuum historico-culturel entre la 9. Recherches
pluridisciplinaires et le continuum historico-culturel entre la
vallée
du Nil et les autres régions de l'Afrique noire
Cheikh Anta Diop explique que l'effondrement
de l'Egypte pharaonique indigène consécutif au sac de Thèbes en
Haute-Egypte par Assurbanipal en -661 et de la conquête Perse par
Cambyse en -525, a été ressenti comme un véritable cataclysme sur
l'ensemble du continent africain. En effet, des liens multiples
existaient non seulement entre peuples de la vallée du Nil mais aussi
avec ceux de l'intérieur du continent.
A l'image
d'une Egypte ancienne coupée du reste de l'Afrique noire se substitue
peu à peu, au fil des recherches, l'image d'une grande nation africaine
qui entretenait des relations étroites, culturelles, commerciales,
diplomatiques, etc. avec les pays de l'intérieur du continent. Babacar Sall traite sous un angle nouveau cette importante question
dans l'article intitulé "Herkouf
et le pays de Yam" :
" L'étude des
relations inter-régionales en Afrique ancienne en général, entre l'Egypte
pharaonique d'une part, et la moyenne vallée du Nil d'autre part,
constitue un domaine fondamental de l'égyptologie. Elle permet, entre
autre, de revoir la lecture hégélienne rémanente de l'isolement de
l'Afrique au Sud du Sahara, "l'Afrique proprement dite ".
La
photographie aérienne, elle-même révèle des voies de communication
anciennes, entre les grands fleuves africains comme le Nil et le Niger.
Comme l'a
montré Cheikh Anta Diop, la géographie des noms de personnes et des noms
de lieux fournit des renseignements très précieux sur les liens existant
entre les populations de la vallée du Nil et les populations installées
en dehors de cette vallée sur l'ensemble du continent africain.
En 1984,
L'UNESCO publie, dans le cadre de la rédaction de l'Histoire générale
de l'Afrique, dans la collection associée, Études et Documents,
tout un ouvrage consacré à cette question : Ethnonymes et toponymes
africains.
Des éléments
nouveaux sont apportés par Aboubacry Moussa Lam dans "Quelques
remarques sur les noms de personnes dans l'Egypte pharaonique" ainsi
que dans son livre De l'origine égyptienne des Peuls. L'auteur
approfondit l'étude des relations entre l'Egypte ancienne et le reste de
l'Afrique noire dans ses ouvrages Le Sahara ou la Vallée du Nil ?
Aperçu sur la problématique du berceau de l'unité culturelle de
l'Afrique noire et
Les Chemins du Nil, paru en 1997 :
"Ce livre,
une suite logique de De l'origine égyptienne des Peuls, focalise
la problématique des relations entre l'Egypte ancienne et l'Afrique sur
l'ensemble que constitue l'Afrique de l'ouest et présente dans ce
domaine, des convergences capitales jusqu'ici inédites.
Se repose
ainsi la question de l'unité culturelle négro-africaine : les multiples
similitudes entre l'Egypte et l'Afrique noire s'expliquent-elles
uniquement par un berceau saharien commun, disloqué avant l'éclosion de
la civilisation pharaonique, et des influences tardives et indirectes du
pays des pharaons sur le reste du continent ? C'est ce schéma-là qui,
malgré ses insuffisances manifestes, a la préférence de bon nombre de
spécialistes de disciplines et d'appartenances diverses.
Pourtant les
traditions orales négro-africaines ignorent le Sahara et désignent avec
insistance la vallée du Nil comme région d'origine de bien des
populations fixées de nos jours à l'extrémité occidentale de l'Afrique.
Aujourd'hui, grâce à elles, il est établi dans ce livre que Korotoumou ba (le fleuve de Korotoumou) et la "Grande Eau" des
traditions mandé, ainsi que Heli et Yooyo, le pays
mythique des Peuls, renvoient incontestablement à la vallée du Nil. Mais
de manière encore plus éclatante, elles permettent de cerner avec
précision les origines du premier grand Etat de l'Afrique de l'ouest,
Ghana : celles des Soninkés, corroborées par les données de
l'égyptologie et de l'archéologie ouest-africaine, permettent maintenant
d'affirmer avec certitude que ce ne sont pas les néolithiques de Dhar
Tichitt qui en sont les fondateurs, comme certains l'ont soutenu
jusqu'ici, mais les éléments de l'une des toutes premières vagues
migratoires qui fuyaient l'invasion perse de la grande métropole
négro-africaine".
Boubacar Diop,
dans sa thèse de doctorat d'Etat soutenue à Dakar en mai 2002 et en
cours de publication, apporte d'autres éléments à la connaissance du
passé africain en étudiant l'Afrique ancienne sous l'éclairage croisé de
la géographie physique, de la cartographie, de l'écologie (faune,
flore), de l'égyptologie et des sources littéraires.
Décrits par
les témoignages des voyageurs arabes du 8ème siècle de notre
ère et les relations des premiers navigateurs européens aux 15ème
et 16ème siècles, portugais et hollandais surtout, les Etats
africains précoloniaux font aujourd'hui l'objet d'études plus précises
grâce aux fouilles archéologiques, aux datations physico-chimiques, à
l'investigation génétique et l'étude de la tradition orale.
L'exposition
et l'ouvrage Vallées du Niger, présenté en introduction par
l'historien et Président du Mali Alpha Omar Konaré, offre un bilan des
fouilles archéologiques menées dans les régions traversées par le fleuve
Niger : Mali, Burkina-Faso, Mauritanie, Niger, Nigeria. Elles ont mis à
profit la prospection par photographies aériennes.
L. M. Diop a recensé par exemple des
renseignements précieux livrés par l'archéologie et les datations sur :
"- la cité de
Djenné-Djeno (près de l'actuelle Djenné au Mali), qui date du 3e
siècle BC, comme les premières agglomérations urbaines de l'Ethiopie.
L'existence de Djenné-Djeno a été révélée par les fouilles de S. et R.
Mc Intosh (1980) à partir de l'analyse préalable de photographies
aériennes. [...], les datations effectuées pour le Mali et l'Ethiopie
ont donc révélé que la cité malienne a la même ancienneté que les
premières villes éthiopiennes. S. et R. Mac Intosh ont pu en outre
établir que la région de Djenné est en pleine expansion depuis la fin du
premier millénaire A.D et que cette expansion n'est pas due au commerce
transsaharien mais bien au développement interne d'un réseau commercial
de plus en plus complexe ce qui est confirmé par des fouilles menées à
l'ouest du lac Debo. La naissance de l'empire de Ghana a été aussi
reculée de plusieurs siècles. On la localise maintenant vers le 3e
siècle A.D. (après JC.).
- La
civilisation de Nok-Taruga sur le territoire du Nigéria, au nord
de la Basse-Bénoué. Elle est caractérisée principalement par des
figurines en terre cuite et la présence du fer, et dont les dates
Carbone 14 s'échelonnent de -3500 à + 200,
- Les Royaumes anciens Yoruba et
Ile-Ife/Bénin, dont
certains sont bien antérieurs au 13ème siècle comme celui de
Igbo-Ukwu qui remonte au 9ème siècle.
- Les
nécropoles de Sanga et de Katoko, dans la haute vallée du
Congo, (Graben de l'Upemba), qui ont été datées du 8e siècle
AD environ. Les 6800 ruines d'Engarouka, à la frontière Kenya/Tanzanie, sont datées de 330 (± 90 ans) AD à 1460 (±90 ans) AD."
Ces
recherches historiques et archéologiques consolident les études faites
par Cheikh Anta Diop, en 1954 dans Nations Nègres et Culture,
puis, quelques années plus tard dans l'Afrique noire précoloniale,
portant sur le développement de civilisations négro-africaines
post-pharaoniques et les liens historico-culturels existant entre les
civilisations de la vallée du Nil et les grands Etats en Afrique
subsaharienne : Ghana, Mali, Songhaï, Ile-Ife, Oyo, Bénin, ...
 10. Recherches pluridisciplinaires et apport de l'Afrique à la
connaissance et
10. Recherches pluridisciplinaires et apport de l'Afrique à la
connaissance et
la spiritualité - Antériorité et transmission des savoir
L'os d'Ishango dont
l'ancienneté
remonte à 23000 ans environ
Cheikh Anta Diop a consacré plusieurs
développements approfondis à l'histoire de la pensée humaine. Son effort
d'investigation a surtout porté sur l'Antiquité égypto-nubienne,
soutenant la chronologie longue de l'histoire égyptienne, dont
l'écriture marque le commencement. Pour autant, il n'a pas ignoré les
autres aires géo-culturelles et les autres époques sur le continent
africain : en exemple ses développements sur l'astronomie Dogon, sur l'université
de Tombouctou construite vers 1325 au temps des grands empires
sahéliens, ou encore sur l'apport arabo-musulman à l'Europe.
Citons
quelques-uns des nouveaux travaux et résultats de fouilles
archéologiques s'inscrivant dans cette thématique de recherche.
Écriture et
chrononologie historique
Une
confirmation de l'invention autochtone de l'écriture est fournie par les
résultats des fouilles menées par l'égyptologue allemand Günter
Dreyer, à Abydos. Ils montrent, en effet, que l'écriture égyptienne
remonte au moins à 3400 ans avant J.-C. Il s'agit aussi d'une
confirmation de l'antériorité de l'écriture hiéroglyphique par rapport
aux autres systèmes d'écritures connus. A l'opposé des écritures suméro-assyro-babyloniennes (les "cunéïformes", les formes-clous) qui
ont disparu sans laisser de descendants, l'écriture égyptienne
(hiéroglyphique, hiératique, démotique) est l'origine lointaine (entre
autres alphabets) après des transformations successives (emprunts
phénicien, grec, romain , etc.), de l'alphabet latin tel que nous
l'employons aujourd'hui.
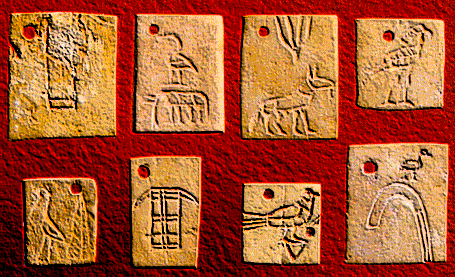
Les plus anciens
hiéroglyphes connus, vers 3400 av. J.C, mis au jour lors des fouilles
menées par l'égyptologue allemand Günter Dreyerà Abydos en Haute-Egypte.
L'écriture égyptienne est une invention autochtone africaine et est la
plus ancienne écriture connue à ce jour.
Il est aussi à noter que les datations par
le radiocarbone d'échantillons archéologiques tendent à remettre en
cause la chronologie de l'histoire égyptienne en particulier celle de la
IIIème dynastie marquée par le règne du pharaon Djoser
et les réalisations scientifiques et architecturales du savant divinisé
Imhotep :
" ... ou
alors, la chronologie de la IIIe dynastie doit être repoussée
dans le passé de trois à quatre siècles, ce que d'autres résultats
récents tendent à accréditer. C'est l'opinion du groupe de chercheurs
Eugen Strouhal, M. F. Gabalah, G. Bonanai, W. Woelfi, A. Nemeckova et S.
Saunders qui communiquèrent leurs conclusions à Cambridge, lors du VIIe
congrès international des Egyptologues, en septembre dernier".
Philosophie,
spiritualité, religion
La
caractérisation de l'apport philosophique, spirituel et religieux
négro-africain initiée par Cheikh Anta Diop a été en particulier
poursuivie par Théophile Obenga. Il systématise le travail de recherche
directement à partir des textes égyptiens hiéroglyphiques eux-mêmes:
traduction, translittération, commentaire sémantique, grammatical,
philologique, linguistique, culturel.
Dans La
Philosophie africaine de la période pharaonique - 2780-330 avant
notre ère Théophile Obenga écrit :
"Il y a eu
une activité philosophique spécifique dans l'Egypte pharaonique. Cet
effort de questionnement radical face à la réalité rugueuse dura plus de
vingt cinq siècles, c'est-à-dire tout le temps et tout au long de la
splendide civilisation pharaonique. [...] La Maât est de l'ordre
du "comme il faut", tandis que le Noun de l'ordre de "ce à partir
de quoi" est advenu le monde tel qu'il est : le cosmos immense et
l'humanité de la planète Terre, la structure primordiale avec toutes ses
nervures essentielles et l'invention de la connaissance de soi qui ne va
pas sans celle du devoir. Telle est la couche originelle de la
philosophie pharaonique - dès le rythme majeur des pyramides - où le Noun traduit une notion de matière opérante et la
Maât
représente en hiéroglyphe parfait, la notion élevée de perfection
morale."
De même,
Mubabinge Bilolo, dans une série d'ouvrages et d'articles, a
étudié de manière très érudite la pensée égyptienne, notamment les "Cosmo-théologies
philosophiques d'héliopolis et d'hermopolis". Très schématiquement
rappelons qu'à la cosmogonie héliopolitaine est attachée l'Ennéade : Ra a engendré quatre couples divins
Shou (l'air,
l'espace) et Tefnut (l'humidité, l'eau), Geb (la terre) et
Nut (le ciel, la lumière, le feu), Osiris et Isis
symboles de la fécondité et qui engendrera l'humanité (Horus, le
neuvième élément), Seth et Nephtys couple stérile symbole
du mal. La cosmogonie hermopolitaine pose des principes opposés
symbolisés par quatre couples divins, l'Ogdoade : Kouk
(les ténèbres) et Kouket (la lumière), Noun (les eaux
primordiales) et Nounet (matière et néant), Amon (le
caché) et Amonet (le visible), Heh (l'illimité) et Hehet (le limité).
Les
sciences
S'agissant
des sciences il convient de mentionner d'abord l'ouvrage collectif Black in Science - ancient and modern publié en 1983 aux USA par Ivan Van Sertima, qui offre une synthèse très documentée de la
contribution des Africains et Africains-Américains à la science, de la
préhistoire, avec les tables numériques de l'Os d'Ishango trouvé
en République du Congo et daté de 23000 ans environ, à la période
contemporaine. Sont abordés les domaines de l'astronomie, l'agriculture,
l'architecture, les mathématiques, la médecine, la navigation, les
systèmes d'écriture, la métallurgie, la physique, l'ingénierie, la
technologie.
Astronomie
Un site
mégalithique très ancien, antérieur à celui de Stonehenge, en
Angleterre, environ 4800 ans avant J.-C., a également été mis au jour en
Haute-Egypte. La disposition des pierres levées sont considérées comme
la preuve de l'existence d'une astronomie dès cette époque reculée.

Site astronomique au Soudan
datant du néolithique, vers 4800 avant Jésus-Chris( (J. McKim Malville,
F. Wendorf, A. A Mazar, Romuald Schild, Megaliths and Neolithic
astronomy in southern Egypt, Nature, Vol 392, 2 April 1998,
pp. 488-491.
La thèse (PhD) de Mario Beatty The Image of Celestial Phenomena in The Book of Coming Forth By
Day : An Astronomical and Philological Analysis, met en évidence les
connaissances astronomiques des anciens Egyptiens jusque-là ignorées.
S'appuyant sur l'étude des textes hiéroglyphiques comme Le Grand
Hymne à Thoth inscrit sur la statue de Horemheb et des passages du Livre de la venue au Jour (Livre des Morts), Mario Beatty avait déjà analysé dans la revue ANKH des textes
hiéroglyphiques indiquant que les :
"anciens
Egyptiens semblent avoir découvert que la lune brillait non pas d'une
lumière émise intrinsèquement par elle-même, mais par réflexion de la
lumière provenant du soleil. Les observations astronomiques attestées
par ces textes permettent d'affirmer qu'au Nouvel Empire (1600 B.C. -
1080 B.C.) les Egyptiens savaient que la lumière lunaire avait pour
origine le Soleil."
L'article du
même auteur sur la notion de sphère céleste en Egypte pharaonique, "The
Celestial Sphere in Ancient Egypt", co-publié avec Allen Troy
dans ANKH, est également à signaler.
La
communication, résumée ci-après, de l'astrophysicien Jean-Paul Mbelek
sur Le lever héliaque de Sirius dans l'Afrique ancienne, à
la Journée ANKH'2000, a mis aussi en évidence les
implications de l'observation et du suivi au cours du temps de ce
phénomène astronomique, dans le domaine de l'histoire de l'astronomie,
des calendriers et celui de l'égyptologie :
"Après avoir
défini et caractérisé ce phénomène, une analyse prenant en compte le
lieu géographique et les conditions d'observation est proposée. Il
appara"t que les sites d'observation les plus favorables, pour la
découverte, à l'Ïil nu dans la Haute Antiquité, d'un phénomène aussi
fugace, se trouvent en Afrique de l'Est dans une région sub-équatoriale
centrée sur la Tanzanie actuelle".
L'astrophysicien
Jean-Marc Bonnet-Bidaud, a mené une mission
scientifique chez les Dogon du Mali qui a fait l'objet d'un film "Sirius,
l'étoile Dogon" réalisé par Jérôme Blumberg et d'une
conférence "Astronomie chez les Dogon". Equipé d'un matériel
scientifique moderne, il a pu concrètement vérifier la précision des
observations du ciel faites par les Dogon et au-delà de ce constat, à la
suite de Marcel Griaule, reconna"tre l'existence de l'astronomie
Dogon.
Anne-Sophie
von Bomhard, auteur de l'ouvrage Le Calendrier Egyptien, Une
"oeuvre d'Eternité, préfacé par l'égyptologue Jean Yoyotte, rassemble et analyse de nombreux documents astronomiques égyptiens :
tombe de Senmout, verso du Papyrus Ebers, plafond du
temple de Ramsès II à Louxor, Calendrier d'Eléphantine, Table
horaire décanale du sarcophage de Idy, temple de Dendérah, etc.
Au cours de son étude comparée des différents calendriers égyptiens -
sothiaque, solaire et lunaire, elle montre la très grande précision des
observations faites par les astronomes égyptiens.
Dans son
livre The Star of Deep Beginings - Genesis of African Science and
Technology, Charles S. Finch III, offre une nouvelle
synthèse portant sur la métallurgie, l'astronomie, l'architecture et la
navigation. Il insiste sur la dimension cosmique de la science
africaine. Charles S. Finch, médecin, avait déjà publié
une série de travaux sur les connaissances anatomiques, médicales,
prophylactiques, pharmaceutiques africaines non seulement chez les
anciens Egyptiens mais aussi chez d'autres peuples du continent comme
les Masaï ou les Banyoro d'Ouganda dont les chirurgiens pratiquaient la
césarienne.
Mathématiques
Le livre de
Théophile Obenga, La géométrie égyptienne - Contribution de l'Afrique
à la Mathématique mondiale, dédié aux savants égyptiens Imhotep (Ancien
Empire, vers 2780 avant notre ère), et Ahmès (vers 1650 avant notre
ère) ainsi qu'au mathématicien Africain Américain Thomas Fuller
(1710-1790) et aux mathématiciens africains contemporains, restitue la
géométrie égyptienne directement à partir des documents : papyrus,
monuments, instruments, bas-reliefs, etc. Les objets et problèmes
géométriques traités sont nombreux : la ligne droite, la circonférence,
les angles, le triangle, le rectangle, le losange, le carré, le trapèze,
les polygones réguliers, les symétries par rapport à un point et à un
axe, l'homothétie et la similitude, les aires du rectangle, du carré, du
triangle, du trapèze, du cercle, l'aire d'une surface limitée par une
courbe quelconque, la surface de la sphère, la trigonométrie, le
parallélépipède, l'ellipse, les volumes du cylindre, de la pyramide, du
tronc de cône, l'obélisque, la rampe, ... L'auteur fournit aussi
l'ensemble du vocabulaire géométrique en égyptien hiéroglyphique.
Dans
l'article paru dans la revue ANKH "Sur la mesure du cercle et
de la sphère en Egypte ancienne"
Pascal Kossivi Adjamagbo
et Cheikh M'Backé Diop. rappellent les deux approches qui s'opposent
dans l'étude des mathématiques égyptiennes :
"Les études
consacrées aux mathématiques égyptiennes font apparaître deux approches
différentes :
la
première, sous-jacente aux travaux de E. T. Peet, postule le caractère
empirique du savoir mathématique égyptien. Ce point de vue est très
souvent repris dans des ouvrages de vulgarisation d'une haute tenue : "Mais
leur plus grand titre de gloire, en géométrie plane, est la possession
d'une recette pour calculer la surface d'un cercle en fonction de la
longueur de son diamètre" (G. Posener, sous la direction de, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, Fernand Hazan,
1970, p. 165), "Elle ne se soucie pas de démonstrations, mais donne
des "recettes" plus ou moins approximatives" (André Pichot,
La
naissance de la science, tome 1. Mésopotamie, Egypte, Paris,
Gallimard, 1991). Cette démarche conduit à rechercher les procédures
empiriques (qui s'opposeraient à une approche théorique abstraite) par
lesquelles les anciens Egyptiens auraient abouti à leurs résultats.
la seconde
attire l'attention sur des faits qui excluent un simple empirisme, et
qui expriment de manière implicite ou explicite la connaissance de
propriétés mathématiques et l'existence d'une réflexion théorique sur
des êtres mathématiques. C'est le cas des auteurs comme V. V. Struve en
Allemagne, R. J. Gillings aux USA, C. A. Diop et T. Obenga en Afrique,
S. Couchoud en France."
Après un
rappel succinct des types de documents égyptiens disponibles relatifs à
la mesure d'une grandeur, ils montrent qu'une explication du caractère
exact et général peut être trouvée en examinant la notion de mesure en
Egypte ancienne
[...], les
papyrus mathématiques égyptiens, et en particulier le Papyrus Rhind,
dont le titre est : "Méthode correcte d'investigation dans la nature
pour conna"tre tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets
[T. Obenga, La Géométrie égyptienne, op. cit., p. 290],
témoignent de cette conquête de la raison humaine : l'homme découvre
qu'il peut accéder à la connaissance du réel grâce à des formules
mathématiques."
*
Il est tout à
fait remarquable, que depuis 1954, date de parution de Nations nègres
et Culture, les découvertes archéologiques, les études
égyptologiques, linguistiques, les études de biologie moléculaire et de
génétique, l'étude de la culture matérielle, l'analyse de la pensée
philosophique, de la tradition orale É ont régulièrement confirmé la
fécondité des voies de recherches tracées par Cheikh Anta Diop. C'est
dire aussi que le cadre académique traditionnel de formation et de
recherche au sein duquel l'égyptologue ignore l'Afrique noire et le
spécialiste de l'Afrique noire ignore l'Egypte ancienne est obsolète.
Les travaux de Cheikh Anta Diop, puis ceux de ses continuateurs ont
justement supprimé la frontière artificielle créée entre l'égyptologie
et l'étude du passé négro-africain, et il convient de réaffirmer toute
l'importance que revêt la connaissance, de l'intérieur, de l'univers
négro-africain pour renouveler l'égyptologie et inversement celle que
revêt la connaissance du passé égypto-nubien sous tous ses aspects pour
renouveler les sciences humaines en particulier en Afrique.
L'ensemble
des nouveaux travaux, s'ajoutant à ceux de Cheikh Anta Diop, contribuent
à restituer et réévaluer l'apport de l'Afrique à la civilisation humaine
et à encourager les hommes et femmes de sciences, médecins, historiens,
sociologues, juristes, économistes, artistes, artisans, sportifs,
architectes, philosophes, ... africains à prendre en charge cet immense
patrimoine légué par les civilisations de la vallée du Nil, par celles
de l'ensemble du continent. Ce travail mené avec l'École africaine
d'Égyptologie aidera à l'élaboration d'un véritable corps de
sciences humaines en Afrique susceptible de renouveler la recherche et
l'enseignement de plusieurs disciplines sur le continent africain et
aussi dans le monde.
Il
contribuera aussi à nourrir la réflexion sur le devenir de l'humanité.
En effet, la civilisation égypto-nubienne étonne, fascine par sa
longévité de plus de trois mille ans, par la stabilité de ses
institutions, par la rationalité de son organisation sociale, par son
éthique - la Maât -, son idéal de justice, par ses systèmes
philosophiques, par ses connaissances scientifiques, par sa spiritualité
incarnée dans les Textes des Pyramides, l'architecture, l'art, la
momification, et qui a su transcender la mort. Ce sont les fruits d'une
expérience humaine multi-millénaire acquise au cours d'une longue
évolution notamment le long du Nil à partir de la région des Grands
Lacs africains, sous une latitude intertropicale, là où l'Homme est
né.
Notes, références, bibliographie (voir
ANKH n°10/11)
Cf. Editorial inaugural de
la revue ANKH : "L'Oeuvre de Cheikh Anta Diop, un héritage
vivant", ANKH, n°1, février 1992, pp. 5-26.
M. Brunet et al.,
Nature, n°418, p.145, 2002 ; Alain Beauvilain, Touma -
L'aventure humaine, Paris, Editions de la Table ronde, 2003.
B. Asfaw et al.,
Science, n° 284, p. 629, 1999.
Humanity from African
Naissance to Coming Millenia - Colloquia in Human Biology and
Palaeoanthropology, 28th june - 4th july 1998,
Editors Philip V. Tobias, Michael A. Raath, Jacopo Moggi-Cecchi and
Gerald A. Doyle, Firenze University Press (Italy), Witwatersrand
University Press (South Africa), 2001 ; Berhane Asfaw, W. Henry Gilbert,
Yonas Beyene, William K. Hart, Paul R. Renne, Giday Wolde Gabriel,
Elisabeth S. Vrba, Tim D. White, "Remains of Homo erectus from Bouri,
Middle Awash", Ethiopia, Nature, vol. 416, 21 march 2002, pp.
317-320.
Véronique Barriel,
"L'origine génétique de l'homme moderne", in Dossier Pour la Science,
Les origines de l'humanité, janvier 1999, pp. 92-98.
Dans le cadre de
l'anthropologie physique, la formulation d'approches polygénistes et
monogénistes pour expliquer l'existence des divers types humains
observés, remonte au XIXème siècle. Elles sont reformulées au
XXème siècle partir des données fournies par la
paléontologie humaine et la génétique.
Véronique Barriel, "La
génétique au service de la quête de nos origines", in Y. Coppens, P.
Picq (sous la direction de), Aux origines de l'humanité, Paris,
Fayard, 2001, pp. 462-509.
Véronique Barriel, "La
génétique au service de la quête de nos origines", op. cit.
Cf. respectivement : "A
craniological Approach of the origin of anatomically Modern homo sapiens
in Africa", in The Origins of Modern Humans Ð A World Survey of the
Fossil Evidence, F. H. Smith and Spencer (eds), pp. 327-410, New-York,
Alan R. Liss Inc., 1984 ; "Early Homo sapiens from East and South Africa
for Evolution of "Anatomically Modern Man" outside Africa",
communication au séminaire d'Yves Coppens, in Année académique du
Collège de France, 1988-1989, pp. 454-456) ; "L'émergence de l'Homme
moderne", in Pour la Science, n° 160, février 1991, pp. 54-62
suivi d'un bref commentaire critique d'André Langaney.
G. Günter Bräuer, "L'origine
africaine des hommes modernes", ANKH, n°3 juin 1994.
Günter Bräuer, "The
ÔOut-of-Africa' Model and the Question of Regional Continuity", "The
KNM-ER 3884 Hominid and Emergence of Modern Anatomy in Africa", Humanity from Afican Naissance to Coming Millenia - Colloquia in Human
Biology and Palaeoanthropology, 28th june - 4th
july 1998, Editors Philip V. Tobias, Michael A. Raath, Jacopo
Moggi-Cecchi and Gerald A. Doyle, Firenze University Press (Italy),
Witwatersrand University Press (South Africa), 2001.
Nature, Tim D. White,
Berthane Asfaw, David DeGusta, Henry Gilbert, Gary D. Richards, Gen Suwa,
F. Clark Howell, "Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia",
12 June 2003, volume 423, issue n°6941, pp. 742-747 ; voir aussi : Nature, Chris Stringer, "Out of Ethiopia", 12 June 2003, volume 423,
issue n°6941, pp. 692-695 ; Nature, J. Desmond Clark et al.,
"Statigraphic, chronological and behavioural contexts of Pleistocene
Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia", 12 June 2003, volume 423,
issue n°6941, pp. 747-752
Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS),
David Caramelli et al., "Evidence for a genetic discontinuity
between Neanderthals and 24,000-year-old anatomically modern Europeans",
May 27, 2003, vol. 100, n°11, pp. 6593-6597.
In Les origines de
l'humanité, Dossier Pour La Science, janvier 1999, p. 83.
Pascal Picq, Les origines
de l'Homme. L'Odyssée de l'espèce, Paris, Taillandier/Historia,
1999, p. 135.
Henshilwood, C.S., Sealy,
J.S., Yates, R., Cruz-Uribe, K., Goldberg, P., Grine, F.E., Klein, R.G.,
Poggenpoel, C.A., van Niekerk, K. & Watts, I. 2001, "Blombos Cave,
Southern Cape, South Africa : Preliminary Report on the 1992-1999
Excavations of the Middle Stone Age Levels", Journal of
Archaeological Science, 28, 421-448 ; "Emergence of modern human
behavior : Middle Age Engravings from South Africa", Michael Balter,
"From a Modern Human's Brow or Doodling ?, Science, vol. 295, 11
January 2002, pp. 247-248 ; Hervé Morin, "Quand Homo sapiens
jouait les artistes en Afrique du Sud", Le Monde, mercredi 16
janvier 2002, p. 24.
Richard Mankiewicz, L'histoire des mathématiques, Paris, Seuil, 2001, traduit de
l'anglais par Christian Jeanmougin, p. 10.
Jean Bernard, Le sang et
l'histoire, Editions Buchet/Chastel, 1983.
Véronique Barriel, "La
génétique au service de la quête de nos origines", in Y. Coppens, P.
Picq (sous la direction de), Aux origines de l'humanité, Paris,
Fayard, 2001, pp. 462-509.
Jim Wainscoat, "Out of the
garden of Eden", in Nature, Vol. 325, 1 January, 1987, p. 13.
Allan C. Wilson et al.,
"Mitochondrial DNA and human evolution", in Nature, Vol. 325, 1
January, 1987, pp. 31-36.
Gérard Lucotte et Jacques
Ruffié, Communication au 2e Congrès international de
démographie historique consacré au peuplement du monde avant 1800
intitulée "Origin of modern humans : evidence from Y-chromosom specific
polymorphic DNA probe", Paris, CNRS/INED/Société de démographie
historique, in Bulletin d'information des Annales de démographie
historique, n° 49, juin 1987, pp. 56-57Ê; Gérard Lucotte, Introduction l'anthropologie moléculaire Ð éve était noire, Paris,
Editions Lavoisier, 1990.
Luigi Luca Cavalli-Sforza,
"Reconstruction of human evolution : Bringing together genetic,
archaeological and linguistic data", in Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, Vol. 65, August 1988, Evolution, pp. 6002-6006 ; "Des gènes, des
peuples, des langues", in Pour la Science, n° 171, janvier 1992,
pp. 26-33, suivi du commentaire de Laurent Excoffier, p. 33 ; S. A.
Tischkoff et. al., "Global Patterns of Linkage Disequilibrium at the CD4
Locus and Modern Human Origins", in Science, vol. 271, 8 march
1996, pp. 1380-1387 : "... This global patternof haplotype variation
and linkage disequilibrium suggests a common and recent African origin
for all non-African human populations." ; Reich and Goldstein.,
Proceedings of the National Academy of Sciences, Evolution,
Vol. 95, pp. pp. 8119-8123, september 1998 : "Éour analysis, like many
other genetic analyses, assigns a unique role to Africa in human
evolution".
J.Y. Chu et al., Proceedings of the National Academy of Sciences,
Evolution,
Vol. 95, pp. 11763-11768, september 1998.
Li Jin et. Al., "African
Origin of Modern Humans in East Asia : A tale of 12,000 Y Chromosomes",
Science, vol. 292, 11 may 2001, pp. 1151-1152.
Véronique Barriel,
"L'origine génétique de l'homme moderne", in Les origines de
l'humanité, Dossier Pour La Science, janvier 1999, pp. 92-98.
Aux origines de
l'humanité, Paris, Fayard, 2001.
Bryan Sykes, Les sept
filles d'Eve , Paris, Albin Michel, 2001, pp. 67-68.
Cheikh Anta Diop, "Histoire
primitive de l'Humanité - Evolution du monde noir", Bulletin de l'IFAN,
T. XXIV, série B, n° 3-4, 1962, p. 449.
Livre II.
Physionomie. 6.
Navigation, § 2 et 3
Livre II, "La famille
d'Inacus", § 3 et 4.
Les Suppliantes, vers
719 720, vers 745.
Géographie, Livre I,
chapitre 3, §10.
Histoire universelle,
Livre III.
Livre VII, 1.
XXII, §8, 24
Mubabinge Bilolo, "Aristote
et la mélanité des anciens Egyptiens, ANKH, n°6/7, 1997-1998, pp.
138-161.
Cf. "Editorial inaugural :
L'Ïuvre de Cheikh Anta Diop, un héritage vivant", ANKH n°1,
février 1992, pp. 5-26.
Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres. Mythe ou vérité historiqueÊ?,
Paris, Présence Africaine, 1967, 1993, pp. 280-283.
Cheikh Anta Diop,
"Pigmentation des anciens Egyptiens Ð Test par la mélanine",
in Bulletin de l'IFAN, Tome XXXV, série B, n° 3, Dakar, 1973 ; cet
article a été republié dans la revue ANKH, n°8/9, 1999-2000.
Cf. Histoire Générale de
l'Afrique - Etudes et documents 1, UNESCO, Paris 1978, et Histoire Générale de l'Afrique, Tome II, Paris, Jeune
Afrique/Stock/UNESCO, 1980.
Cf. "Actes du premier
Colloque international d'anthropologie physique des anciens Egyptiens",
in Bulletins et mémoires de la société d'anthropologie de Paris,
Tome huitième, Ð XIIIe série, septembre 1981, Paris, Doin
éditeurs.
Cf. Cheikh Anta Diop, Pigmentation des anciens Egyptiens Ð Test par la mélanine,
in Bulletin de l'IFAN, Tome XXXV, série B, n° 3, Dakar, 1973 ; cet
article a été republié dans la revue ANKH, n°8/9, 199-2000.
Cheikh Anta Diop en 1973 préconise l'étude des groupes sanguins pour
préciser l'appartenance ethnique des momies de l'ancienne Egypte ; le
groupe sanguin B se retrouve en particulier chez les Nègres.
Jean Bernard, Le sang et
l'histoire, Editions Buchet/Chastel, 1983, pp. 12-13.
Pääbo S., "Preservation of
DNA in ancient Egyptian mummies", J. Archaeolo. Sci. 12, 1985,
pp. 411-417 ; "Molecular cloning of ancient Egyptian mummy DNA",
Nature, 314, 1985, pp. 644-645 ; "Les gènes des os",
Pour la
Science, n°181, mars 1991, p. 12.
In V. Davies and R.
Walker, Editors, Biological Anthropology and the Study of Ancient
Egypt, British Museum Press, 1993, pp. 86-90 ; Voir aussi A.
Arnaiz-Villena et alii, "HLA genes in Macedonians and the
sub-Saharan origin of the Greeks, Tissue Antigens 2001, 57, pp.
118-127.
Eric Crubézy, Christine
Keyser, Bertrand Ludes, "Les surprises de l'ADN ancien - Une technique
miracle manier avec précaution", La Recherche, Mai 2002, n° 353, pp.
44-47 ; Eric Crubézy , B. Ludes, D. Rougé, B. Midant Reynes, " Sternal
perforation and bifid ribs a possible familial case 5400 years old. An
example of epigenetic control of development ?, Bulle tins et
Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. 13, 2001, 1-2,
pp. 5-13.
Cf. "Quand l'ADN bouscule
l'histoire", Dossier in Historia, n°654, juin 2001, pp. 50-72.
Jean Bernard, Le sang et
l'histoire, Editions Buchet/Chastel, 1983, p. 69 et p. 71.
Idem, p. 41.
L. M. Diop, ANKH,
n°1, 1992, p. 13.
Cf. notamment la
communication de A. Chaventré et al., INED.
"Le peuplement de l'Afrique
: Hypothèses génétiques", in Le peuplement du Monde avant 1800,
Liège, A. Fauve-Chamoux Editeurs, Ordina, 1990, p. 39.
op. cit., 1954.
Cheikh Anta Diop, "La
métallurgie du fer sous l'Ancien Empire égyptien", Bulletin de l'IFAN,
tome XXXV, série B, n°3, 1973, pp. 532-537.
Cheikh Anta Diop, "L'usage
du fer en Afrique", Notes Africaines, n°152, octobre 1976, pp.
93-95.
L. M. Diop-Maes, Afrique
noire, Démographie, sol et histoire, Paris, Khepera/Présence
Africaine, 1996Ê; L. M. Diop, "L'apport des méthodes de datations
physico-chimiques la connaissance du passé de l'Afrique", Ankh n°8/9,
1999-2000, pp. 144-181 ; "Bilan des datations des vestiges anciens de la
sidérurgie en Afrique", in Aux origines de la métallurgie du fer en
Afrique - Une ancienneté méconnue, UNESCO, 2002, pp. 189-193.
Hamady Bocoum, L'åge du
Fer au Sénégal Ð Histoire et Archéologie, IFAN Ch. A. Diop/CRIAA,
Dakar, Nouakchott, 2000 ; Les Routes du Fer en Afrique Ð The Iron
Roads in Africa Ð Première présentation scénographique, UNESCO,
Paris, 26 octobre-17 novembre 1999, cf. ANKH, n°8/9, 1999-2000,
pp. 128-143.
Hamady Bocoum, L'åge du
Fer au Sénégal Ð Histoire et Archéologie, op. cit. ; Aboubacry
Moussa Lam, Mamadou Ibra Sy, "Le forgeron en Afrique Noire de puis
l'Egypte ancienne : du héros civilisateur au paria d'aujourd'hui",
Revue sénégalaise d'Histoire, Nouvelle série, n° 4-5, 1999-2000, pp.
2-25.
Diodore de Sicile,
Histoire Universelle, Livre 3, p. 341, traduction de l'abbé
Terrasson, Paris, 1758, cité par C. A. Diop dans Nations nègres et
Culture, op. cit., 1954).
Ethiopiens au sens des
Anciens Grecs c'est--dire les Noirs Africains.
H. Hartleben, Champollion,
Paris, Pygmalion, 1983, page 507.
Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, Paris, Présence Africaine, 1981, chapitre
4, p. 133.
Bruce Williams, "Excavations
between Abu Simbel and the Sudan frontier, part I Ð The A-group royal
cemetery at Qustul : Cemetery L", University of Chicago, Oriental
Institute Nubian Expedition, Vol. III, Chicago, 1986. Voir aussi ANKH,
n° 6/7, 1997-1998.
février-mars 1980, pp.
43-44.Ê
Edited by W. V. Davies,
London, British Museum Press in association with the Egypt Exploration
Society, 1991, second impression 1993, p. 4.
Edited by W. V. Davies,
idem, pp. 74-91 ;
ANKH n°6/7,
1997-1998, pp. 90-119.
Par exemple : Jacques
Reinold, Archéologie du Soudan Ð Les Civilisations de Nubie,
Paris, Editions Errance, 2000 ; Joyce L. Haynes, Nubia - Ancient
Kingdoms of Africa, Museum of fine Arts, Boston, USA, 1992.
Achéologia, n°331,
février 1997, pp. 36-47.
Catalogue de l'exposition et
ABCdaire, Paris, Flammarion/Institut du Monde Arabe, 1997.
Paris, Khepera/L'Harmattan,
1999.
Racines éthiopiennes de
l'Egypte ancienne, op. cit., p. 397.
Hérodote, Livre II, 15.
Cheikh Anta Diop,
Antériorité des civilisations nègres - mythe ou vérité historique ?,
op. cit., p. 12.
Jacques Labeyrie, L'homme
et le climat, Paris, Editions Denol, 1985.
Cf. Jacques Labeyrie : "Les
méthodes de datation développées au CEA", in Revue Générale Nucléaire,
RGN, n° 6, novembre-décembre 1989, p. 446.
Fred Wendorf et al., "Use of
Barley in the Egyptian Late Paleolithic", in Science, 28 September 1979,
Volume 205, Number 4413, pp. 1341-1347.
Jean Vercoutter, in
Le
Monde, samedi 27 décembre 1980, "Le centenaire de l'école franaise
du Caire", p. 19.
Cf."Les débuts du
pastoralisme en Egypte", in La Recherche, n° 220, avril
1990, Volume 21, pp. 436-445.
Fred Wendorf et al., "Nabta
Playa During the Early and Middle Holocene", ANKH, n° 4/5,
1995-1996, pp. 32-55.
Cf. Préface au livre de M.
Cornevin, Secrets du continent noir révélés par l'archéologie,
Paris, Maisonneuve et Larose, 1998, p. 10.
Jean-François Champollion,
Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne, Paris,
Institut d'Orient, 1984, p. xix).
organisé par l'UNESCO du 28
janvier-3 février 1974, voir chapitre 4 du présent ouvrage.
Théophile Obenga, L'origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues
négro-africaines modernes - Introduction la linguistique
historique, Paris, L'Harmattan, 1993, p. 343.
Théophile Obenga, idem,
p. 343.
Théophile Obenga, "Le
chamito-sémitique n'existe pas", ANKH, n°1, février 1992, pp.
51-58.
Josep Cervello Autori
(editor), África Antigua - El antiguo Egipto una civilizacion
africana, Aula ®gyptiaca Studia, Barcelone, 2001.
in Revue Présence
Africaine, 1986, n° 137-138, pp. 25-57.
in Revue Présence
Africaine, 1989, n° 149-150, pp. 214-248.
in ANKH, revue
d'Egyptologie et des Civilisations africaines, n°6/7, 1997-1998,
pp.75-89.
in Revue Présence
Africaine, 1986, n° 137-138, p. 79.
"La parenté génétique entre
l'égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes, le cas du
duala", ANKH, n°2, avril 1993, pp. 29-83.
Études des chevets,
thèse de 3e cycle.
ANKH, n°3, juin 1994,
pp.115-131.
ANKH, n°4/5,
1995-1996, pp.122-137.
Présence Africaine,
n° 94, 3e trimestre 1975, pp. 119-129.
ANKH, n°1, février
1992, pp. 59-78.
ANKH, n°4/5,
1995-1996, pp.139-183.
Funérailles et
représentations dans les tombes de l'Ancien et du Moyen Empires
Egyptiens - Cas de comparaison avec les civilisations actuelles de
l'Afrique noire. Thèse Université de Hamburg, Hamburg, Lit Verlag,
2001, p. 145.
ANKH, n°4/5,
1995-1996, p.57.
Cf. Nations nègres et
Culture, op. cit., Chapitre 6, p. 371 et "Introduction
l'étude des migrations en Afrique centrale et occidentale Ð
Identification du berceau nilotique du peuple sénégalais", in Bulletin
de l'IFAN, Tome XXXV, série B, n° 4, Dakar, 1973, pp. 769-792.
n° 6, 1984.
A. M. Lam, in Annales de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, n°13, Université de
Dakar, 1983, pp. 141-153.
Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, 1989, 2 volumes.
Aboubacry Moussa LAM, Dakar,
IFAN-Publifan/Khepera, 1994.
Co-édition Présence
Africaine/Khepera, 1993.
Vallées du Niger,
Catalogue de l'exposition, Paris, Réunion des Musées nationaux (RMN),
1993
L. M. Diop-Maes, ANKH,
n°8/9, 1999-2000, pp. 144-181.
G. Connah, 1987, African
Civilizations, Precolonial cities and States in Tropical Africa,
Cambridge, University Press, p.136
F. Van Noten, Histoire
générale de l'Afrique, Unesco, vol.2 p.691.
Cf. Antériorité des
civilisations nègres Ð mythe ou vérité historique ? (Paris, Présence
Africaine, 1967, chapitre 5 "Apport de l'Egypte la civilisation", p.
97, et chapitre 11 : "Transmission des valeurs culturelles et des
connaissances d'Egypte en Grèce et de la Grèce au Monde", p. 216),
L'Antiquité africaine par l'image (Dakar, IFAN-NEA, 1976), Civilisation ou Barbarie ("Apport de l'Afrique l'humanité en
sciences et en philosophie", p. 291, "Vocabulaire grec d'origine
négro-africaine", p. 479.
Ismal Diadié Haïdara,
L'Espagne musulmane et l'Afrique subsaharienne, Bamako, Editions
Donniya, 1997, p. 118.
Günter Dreyer, "Recent
Discoveries at Abydos Cemetery U", in The Nile Delta in TransitionÊ:
4th-3rd millenium B.C., Tel Aviv, E.C. M. Van
Den Brink Editor, 1992, pp. 293-299Ê; V. David and R. Friedman, Egypt,
Londres, British Museum Press, 1998, pp. 35-38.
Théophile Obenga, "Africa,
the Cradle of Writing", ANKH, n°8/9, 1999-2000, pp. 88-95.
Brunet Albert, Actualité : "Le
pied du pharaon Djéser va-t-il changer l'histoire de la IIIe dynastie",
in Archéologia n°323, mai 1996, p. 5Ê; voir aussi, Herbert
Haas et al., "Radiocarbon Chronology and the Historical Calendar", in
Egypt, Chronologies in the Near East, Aurenche O., Evin J. and Hours
F. eds. BAR International Series, 1987, pp. 585-598.
Paris, L'Harmattan, 1990,
pp. 509-510.
Les cosmo-théologies
philosophiques de l'Egypte antique. Problématique, Prémisses
herméneutiques et Problèmes majeurs, Académie de la Pensée
Africaine, Sect.I : La Pensée de l'Egypte et de la Nubie Anciennes,
Vol.1, Kinshasa/ Libreville/ Münich, 1986 ; Les cosmo-théologies
philosophiques d'Héliopolis et d'Hermopolis. Essai de thématisation et
de systématisation, Académie de la Pensée Africaine, Sect. I : La
Pensée de lÉgypte et de la Nubie Anciennes, Vol. 2, Kinshasa /
Libreville/ Münich, 1986 ; Le Créateur et la Création dans la pensée
memphite et amarnienne ; Académie de la Pensée Africaine, Sect.I :
La Pensée de l'Egypte et de la Nubie Anciennes, Vol.3 ; Kinshasa/
Libreville/ Münich, 1988 ; Métaphysique pharaonique, IIIe millénaire
av. J.C., Prolégomènes et Postulats majeurs ; Académie de la Pensée
Africaine, Sect.I : La Pensée de l'Egypte et de la Nubie Anciennes,
Vol.4 ; Kinshasa/ Libreville/ Münich, 1988 ; "Linéarité de l'histoire et
l'idéal du progrès au cours du IIIème millénaire avant J. C.
en Egypte ancienne. Introduction la philosophie pharaonique de
l'histoire", ANKH, n° 4/5, 1996-1997, p. 73-91.
voir aussi : Jean-Charles
Coovi Gomez dans son article "La signification du vocable AKHU en
Egypte ancienne et en Afrique noire contemporaine" étudie les
notions ontologiques ka, ba, akh ANKH, n°3,
juin 1994, pp. 82-113.
Jésus l'Egyptien,
1. Prolégomènes, 2. Naissance divine du Pharaon et de Jésus, Summa
Aegyptiaca, 1999.
New Brunswick (USA),
Transaction Books, 1983 ; Ivan Van Sertima Editor, Journal of African
Civilizations, Vol. 1, n°2, special issue African and African-American
Science and Invention -1, november 1979
Richard Mankiewicz, L'histoire des mathématiques, Paris, Seuil, 2001, traduit de
l'anglais par Christian Jeanmougin, p. 10.
J. McKim Malville, F.
Wendorf, A. A Mazar, Romuald Schild, Megaliths and Neolithic
astronomy in southern Egypt, Nature, Vol 392, 2 April 1998,
pp. 488-491.
ANKH, n° 6/7,
1997-1998, pp. 162-177.
ANKH, n° 4/5,
1995-1996, pp. 214-221.
ANKH, n° 6/7,
1997-1998, pp. 162-177.
ANKH, n°8/9,
1999-2000, p. 239.
Periplus Publishing London
Ltd, 1999.
Georgia, USA, Khenti, 1998.
Charles S. Finch, "The
African Background of Medical Science", in Black in Science - ancient
and modern, Editor Ivan Van Sertima, New Brunswick (USA),
Transaction Books, 1983, pp. 140-156 ; voir aussi Thierry Bardinet, Les papyrus médicaux de l'Egypte pharaonique, Paris, Fayard,
Collection Penser la médecine, 1995.
Paris, L'Harmattan/Khepera,
1995.
ANKH, n° 4/5,
1995-1996, pp. 222-245.
. Cf. André P. R. Pochan, Les Calendriers des Anciens Egyptiens, Montesson, Edition de Mat,
1962 ; Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, Paris,
Présence africaine, 1981 ; Théophile Obenga, La philosophie africaine
de la période pharaonique, Paris, L'Harmattan, 1990.
. Cf. W. F. Petrie, Ancient Weights and Measures, Londres, 1926 ; Karl M. Petruso, "Early
Weights and Weightings in Egypt and the Indus Valley", in
Bulletin of the Museum of Fine Arts, 79, 1981, p. 44-51 ;
Marguerite-Annie Court-Marty, "Les poids égyptiens, de précieux
jalons archéologiques", in CRIPEL 12, 1990, pp. 17-55,
"Les poids et la pesée dans l'Egypte ancienne", in
Cahiers de Métrologie, tomes 11-12, 1993-1994, pp. 345-358.
. Cf. Cheikh Anta Diop, op. cit.
; Théophile Obenga, La Géométrie égyptienne -
Contribution de l'Afrique antique la Mathématique mondiale, Paris,
L'Harmattan/Khepera, 1995 ; Sylvia Couchoud, Mathématiques
égyptiennes, Recherches sur les connaissances mathématiques de l'Egypte
pharaonique, Paris, Editions Le Léopard d'Or, 1993.
|
Revue ANKH |
Civilisations africaines |
Nubie/Egypte |
Sciences exactes |
Enseignements |
Informations |
Bibliographie |
Télécharger |
|
©2006 Association KHEPERA, BP 11 91192 Gif-sur-Yvette Cedex - France Email: info-ankhonl@ankhonline.com
|
|

