Apport des
datations physico-chimiques
à la
connaissance du passé de l'Afrique
Louise Marie Diop-Maes
Article publié dans
ANKH n°8/9
Résumé
: Les
grandes étapes de l'évolution de l'homme sur le continent africain ainsi
que celles de ses migrations successives vers les autres continents sont
retracées à partir des résultats des datations physico-chimiques
révélant l'âge des vestiges paléo-anthropologiques, lithiques et
archéologiques. Cette synthèse aborde également la période historique
qui débute avec l'apparition de l'écriture vers 3400 avant Jésus-Christ,
en Egypte ancienne. Quoiqu'encore sporadiques, les datations ont permis
de restituer l'ancienneté méconnue et l'avancement des civilisations
noires africaines. L'ensemble des différentes datations corrobore les
travaux de Cheikh Anta Diop.
Abstract
: Contribution of the physico-chemical datings to the
knowledge of Africa's past.
The great stages of the evolution of
man on the African continent as well as those of his migrations towards
other continents are related here using the results of the
physico-chemical dating disclosing the age of the paleo-anthropological,
lithical and archaeological remains. This synthesis also tackles the
historical period which starts with the appearance of writing around
3400 B.C., in ancient Egypt. Although still sporadic, the dating allowed
the restitution of the misjudged ancientness and the advanced state of
Black African civilisations. The different datings taken as a whole
corroborate Cheikh Anta Diop's works.
1.
Introduction
L’archéologie
et les datations physico-chimiques sont cruciales pour la connaissance
objective et la compréhension du passé de l'humanité dans tous les cas
où font défaut des documents explicites : écrits ou événements repères
bien connus et datés comme certaines éruptions volcaniques, certains
tremblements de terre.
Les datations sont
indispensables non seulement pour les périodes préhistoriques mais aussi
aux différentes époques historiques de l'Antiquité aux temps modernes.
Nous passons ici en revue les grandes étapes de l'évolution historique
et culturelle de l'Afrique noire des origines au 16ème siècle
à la lumière des résultats des datations physico-chimiques.
2. Bref rappel des méthodes de datations
La chronologie relative à la
Terre est décrite en séquences géologiques dont les délimitations et la
nomenclature sont fondées sur l'étude des roches, du climat, du
magnétisme terrestre, de l'évolution biologique. Avec "l'apparition"de
l'homme s'y ajoute une séquence de nature archéologique qui comporte les
différentes étapes de l'évolution culturelle (dans son acception la plus
large) de l'humanité. Si l'on ramasse la chronologie terrestre sur une
année, alors l'homme moderne, l'Homo sapiens sapiens, apparaît le
15 décembre et l'écriture est inventée dans la matinée du 31 décembre.
Pour repérer les événements de la façon la plus objective possible il
faut définir une échelle de temps (ou référentiel temporel) constituée
d'une origine et d'une unité de temps (l'année solaire). Sur cette
échelle on affecte un temps "absolu" aux événements, c'est-à-dire leur
ancienneté par rapport au présent.
Les méthodes permettant de situer
dans le temps les étapes de l'évolution humaine sont multiples [1] :
- La stratigraphie
- Les relations typologiques
- La dendrochronologie
- La racémisation des acides
aminés
- Le dosage chimique :
azote, fluor, l'uranium
- L'hydratation de
l'obsidienne
- Les traces biologiques :
palynologie, paléontologie, micropaléontologie
- L'archéomagnétisme
- La thermoluminescence
- Les méthodes radioactives
: Carbone 14, Potassium-Argon, Uranium/Thorium.
Toutes les méthodes ne
permettent pas d'établir une chronologie absolue : exemples de la
typologie, de la stratigraphie, du dosage de corps chimiques qui sont
des méthodes de datations relatives. Les méthodes
stratigraphiques restituaient déjà, mais seulement de façon relative,
localement et non sans lacunes, des successions de cultures et d'âges
technologiques. Seules les datations physico-chimiques permettent de
déterminer, avec une approximation variable, l'âge absolu des couches de
terrain et, par suite, des êtres et objets qu'elles contiennent, ou bien
de dater directement les vestiges eux-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent. Les
méthodes qualifiées d'absolues sont fondées sur des phénomènes physiques
naturels susceptibles de positionner un "événement" ou un "objet" sur
une échelle de temps absolu : c'est le cas par exemple de la méthode
de datation par le Carbone 14 (ou radiocarbone).
Le cas de la datation par le
Carbone 14 (14C
ou C14)
Deux phénomènes principaux
sont à la base de cette méthode qui est, de loin, encore aujourd'hui, la
plus utilisée :
1 - Le Carbone 14
contenu dans l'atmosphère est absorbé par les organismes vivants.
2 - Après leur mort,
la radioactivité du Carbone 14 qu'ils ont fixé de leur vivant, commence
à décroître de façon régulière et mesurable.
La radioactivité du Carbone
14 diminue de moitié en 5730 ans ± 40 ans : sa période de désintégration
est de 5730 ans ± 40 ans. La limite utile des mesures est habituellement
de l'ordre de 40 000 ans mais atteint 60 000 ans si les installations
sont très perfectionnées. Cependant, la concentration en Carbone 14 dans
les organismes, durant leur vie, a varié avec l'intensité des rayons
cosmiques. Des irrégularités sont donc observées par rapport à la
chronologie absolue, surtout entre 2500 et 1500 avant J.-C. D'où la
nécessité d'utiliser la dendrochronologie pour corriger les écarts et
calibrer les dates obtenues par le radiocarbone. Des tables de
correction ont été établies, faciles à utiliser. Elles ont été
contrôlées et affinées grâce au magnétisme thermorémanent et aux
différences saisonnières dans les feuillets sédimentaires (varves)
déposés dans les lacs périglaciaires.
Le résultat des mesures est
aussi affecté par les fluctuations statistiques, comme dans toutes les
mesures de radioactivité, car les impulsions (ou désintégrations) émises
par l'échantillon sont distribuées au hasard du temps. Le résultat
fourni est donc une moyenne assortie des écarts évalués par des calculs
standardisés.
Conventionnellement, les
dates sont d'abord données 'Before Present' (BP),
c'est-à-dire avant l'année 1950, prise au départ comme année
de référence. Selon le nombre obtenu, ces dates sont donc soit 'Before
Christ' (BC, avant J.-C.), soit AD, anno
domini, autrement dit, de l'ère chrétienne. Les publications
britanniques notent en lettres minuscules les dates non corrigées : b.p., b.c., a.d., et réservent les majuscules pour les dates
corrigées. Mais les conventions internationales s'en tiennent aux
majuscules pour les dates non corrigées. Il faut alors utiliser les
tables de calibration, et savoir que les dates brutes, dites 'conventionnelles',
sont basées sur l'ancienne estimation de la période de
demi-désintégration de Carbone 14 (demi-vie) : 5568 ± 30 ans, au lieu de
5730 ans ± 40 ans, de sorte que la date brute doit être multipliée par
1.03. Ces dates sont généralement publiées dans la revue Radiocarbon,
éditée par The American Journal of Science, (Yale University, New
Haven, Connecticut, USA).
Les dates concernant
l'Afrique sont souvent publiées par les inventeurs des échantillons et
les chercheurs dans les diverses revues consacrées à l'Afrique. Par
convention internationale, toute date radiocarbone brute est précédée du
sigle servant à désigner le laboratoire qui a effectué la datation, et
ce sigle est suivi du n° d'ordre, dans ce laboratoire, de la dite date,
c'est-à-dire de l'échantillon ; par exemple Gif- 5469, Dak-148.
|
Méthodes de
datation |
Domaine de
temps approximatif couvert en années |
|
Dendrochronologie |
actuel
jusqu'à -7000 |
|
Racémisation des acides aminés |
actuel
jusqu'à -100 000 |
|
Hydratation de l'obsidienne |
200 bp
jusqu'au-delà de - 1 000 000 |
|
Archéomagnétisme |
actuel
jusqu'à -7000 |
|
Thermoluminescence |
quelques
dizaines d'années bp jusqu'à -300 000 |
|
Carbone 14 (ou radiocarbone)
|
actuel
jusqu'à -60 000 |
|
Uranium/Thorium |
actuel
jusqu'à - 300 000 |
|
Résonance de spin électronique |
quelques 1000
ans à 20 millions d'années |
|
Potassium-Argon |
actuel à 4.5
milliards d'années |
Limites inférieures et
supérieures indicatives de validité des méthodes de datations absolues.
Loin d'être concurrentes,
les diverses méthodes se complètent en couvrant des périodes
différentes, en datant des éléments de nature variée, en se contrôlant
mutuellement. Elles ont bouleversé notre vision de la préhistoire et des
débuts de l'histoire.
3. Phénomènes géophysiques, haute
préhistoire et évolution générale
1) -
La méthode du
potassium-argon a permis de connaître l'âge des limites entre deux
périodes de polarité opposée du champ magnétique terrestre (tantôt nord,
tantôt sud). Grâce à ces repères chronologiques, une échelle valable
pour tout lieu du globe a pu être établie sur plus de 5 millions
d'années ; elle sert à dater, indirectement, les niveaux anciens tels
que terrasses fluviatiles, sites paléolithiques, quand une inversion
de polarité y est décelée. Ainsi a-t-il été possible de mettre en
évidence la corrélation entre des sites paléontologiques du lac Turkana
et de la vallée de l'Omo vers 1,8 million d'années (charnière fin
tertiaire / début quaternaire), ainsi que le signalent D. Grimaud-Hervé,
F. Serre et J.-J. Bahain, (Histoire d'ancêtres, Paris, éd.
Artcom, 1998).
2) -
La méthode du
potassium-argon a également permis de préciser des concordances de
phénomènes climatiques. Avant les datations on supposait qu'à chaque
glaciation européenne correspondait une période pluviale en Afrique et à
chaque phase interglaciaire, une période aride en Afrique. Les datations
montrent que ce sont au contraire les périodes arides, et non les
périodes pluviales de l'Afrique qui correspondent à des périodes
glaciaires de l'Europe. Ce scénario semble d'ailleurs beaucoup plus
logique puisque l’eau atmosphérique est partiellement immobilisée sur
les terres froides sous forme de glace et l'évaporation est moindre
quand les températures baissent. Les deux plus anciens pluviaux
africains repérés sont de beaucoup antérieurs à la plus ancienne
glaciation européenne. Le kamasien I, pluvial antérieurement
supposé contemporain de la glaciation de Mindel, c'est-à-dire 600
000 ans, a en réalité 2,1 millions d'années ! Le géologue français H.
Faure écrit en effet dans le volume I de l'Histoire générale de
l'Afrique (Unesco, chap. 16, p. 433) :
- Olduvai (Tanzanie) : la
succession des formations classiques et leur chronologie est la suivante
:
m. a = millions d'années
|
Pluvial |
(ancien
Kanjeran) |
Bed III |
-1,15 |
MA |
|
|
|
Bed II |
-1,7 |
MA |
|
Pluvial |
(ancien
Kamasian) |
Bed I |
-2,1 |
MA |
(d'après Leakey, Cook, Bishop - 1967, Howel - 1972,
Hay- 1975)
Tout ceci est évidemment
capital pour la connaissance de l'évolution et de l'expansion de nos
lointains ancêtres en Afrique même et sur les autres continents.
3) - Les datations
physico-chimiques ont permis d'établir que les pré-Australopithèques
sont apparus entre 5 et 4 millions d'années en Afrique orientale et
australe, que les Australopithèques se multiplièrent et se
diversifièrent entre 4 et 3 millions d'années parmi lesquels Lucy, (Australopithecus
afarensis d'Ethiopie) et Abel, (Australopithecus Bahrel ghazali du Tchad, cf. M. Brunet et al., 'Australopithecus Bahrel
ghazali, une nouvelle espèce d'hominidé ancien de la région de
Koro Toro (Tchad)', C.R. Acad. Sci. Paris, t. 322, série Iia, pp.
907-913, 1996).
De même s'avère-t-il
qu'entre 3,3 et 2,4 millions d'années, la Terre s'est rafraîchie et
l'Afrique orientale asséchée, que les premiers outils lithiques sont
apparus entre 2,6 et 2,4 millions d'années (région de Hadar en
Ethiopie et à l'est du lac Turkana au Kenya) et qu'on les trouve
dans la vallée de l'Omo (extrême sud de l'Ethiopie), entre 2,3 et
2 millions d'années.
Une cinquantaine de ces 'chopping
tools' très grossiers viennent d'être découverts en Chine, au site de Renzidong (région du bas Yangzijian), datés de 2,25 millions
d'années, mais sans fossile humain associé. Cela laisse supposer,
néanmoins, une première migration d'hominiens très ancienne, de
l'Afrique orientale vers l'Asie. La présence de quelques vestiges de
préhumains simiesques amène divers chercheurs à envisager la possibilité
de découvrir en Chine un second berceau de la lignée humaine. Mais rien,
à ce jour, ne vient étayer une telle hypothèse au stade crucial
proto-Australopithèque et Australopithèque en particulier.
C'est entre 2 et 1,6
millions d'années que sont attestés les Homo rudolphensis / Homo habilis, les plus anciens habitats, les premiers 'Homo
ergaster' / Homo erectus (jadis appelés 'pithécanthropes') -
Homo ergaster étant un Homo erectus archaïque. Les
Australopithèques ont continué d'exister à coté d'eux jusqu'à
environ 1 million d'années. Comme leurs prédécesseurs, c'est en Afrique
orientale que sont nés les Homo ergaster et erectus. Les
datations prouvent que c'est de là qu'ils ont essaimé dans d'autres
régions de l'Afrique, en Asie et en Europe, à plusieurs reprises, avant
et après avoir perfectionné la taille de la pierre. Leurs industries se
trouvent dans tout le continent africain, en Asie occidentale,
méridionale et orientale ainsi qu'en Europe. Les premiers bifaces
apparaissent vers 1,4 million d'années.
En Ethiopie, dans la haute
vallée du fleuve Awash, non loin d'Addis Abeba, l'ensemble des sites de
Melka Kunturé ' a permis de reconnaître une évolution de
l'industrie, depuis l'Oldowayen[2],
composé de nombreux galets aménagés ('choppers'), jusqu'à 'l'Acheuléen'
final, avec une représentation importante de bifaces, de hachereaux et
d'outils sur éclats ' (D. Grimaud-Hervé et al., Histoire
d'Ancêtres, éd. Artcom, 1998, p.44) - l'Acheuléen étant
l'industrie lithique riche en bifaces, créée par les Homo erectus
et décrite, au départ, d'après celle qui avait été découverte à
Saint-Acheul, (site éponyme) près d'Amiens, en France. Naturellement,
entre 1,8 million d'années et 400 000 ans, l'anatomie des Homo
erectus a évolué, notamment dans le sens d'un accroissement de la
capacité crânienne. L'observation des industries lithiques indiquent
qu'à chaque période aride les Africains perfectionnaient leur industrie
alors que certains d'entre eux émigraient, mais dans d'autres régions
que lors des périodes pluviales. L'évolution des Homo erectus a
été buissonnante.
4) - Entre environ
400 000 et 120 000 ans, l'Afrique présente des hommes fossiles
intermédiaires entre les Homo erectus évolués et les Homo
sapiens sapiens appelés aussi Hommes modernes, c'est-à-dire,
grosso modo, déjà semblables à nous, en particulier par le
développement du lobe frontal du cerveau (qui permet de concevoir une
stratégie globale, une planification de l'action) et par une disposition
différente du réseau méningé (D. Grimaud-Hervé, 'Les empreintes
vasculaires observées sur les moulages endocraniens d'hominiens fossiles
et actuels', Anthropologie, XXXIV/1-2 . pp. 27- 34, 1996, pp.
27-34).
Le paléontologue allemand
Günter Bräuer distingue :
- entre 400 000 et
200 000 ans, approximativement, des Homo sapiens archaïques anciens (Bodo, Ndutu, Hopefield, Broken Hill, Eyasi,
...)
- entre 200 000 et
100 000, les Homo sapiens archaïques récents (Florisbad,
Laetoli H18, Omo 2, Eliye Springs au Kenya, Jebel Irhoud au Maroc)
- à partir de 130
000, les Homo sapiens anatomiquement modernes, ou Homo
sapiens sapiens commencent à apparaître (Omo 1, Mumba 21, Klasies
river, Border Cave, Omo 3, Dire Dawa, Kanjera, Oldoway, ...).
Avant les datations
physico-chimiques, les chercheurs européens n'imaginaient pas que les Homo sapiens africains aient pu être plus anciens que les
Homo
sapiens européens et encore moins qu'ils puissent être nés en
Afrique intertropicale - (ce que la génétique a confirmé).
En Europe, G. Bräuer
distingue (Ankh 1994) :
p
de 400 000 à 150 000 ans, des Hominidés 'anté-Néandertaliens'
qui sont des Homo erectus évolués.p
de 150 000 à 70000, des 'Néandertaliens précoces',
intermédiaires entre Homo erectus évolué et Homo
neandertalensis.p de
70000 à 35000/30000, les Néandertaliens tardifs ou typiques,
dont le front est resté fuyant et dont les derniers ont vu arriver les
Hommes modernes venant du sud-est, avant de disparaître.La
classification de B. Vandermeersch est un peu différente :
p de 400 000 à 250 000 ans,
apparition sur les fossiles de certains caractères néandertaliens ;
p de 250 000 à 100 000
ans (glaciation de Riss), organisation des caractères de
l'architecture néandertalienne ; p
de 100 000 à 35000, stabilisation de cette architecture ; (History
of Humanity, Unesco, vol 1, chap. 9).
4. Paléolithique moyen et peuplement
Dans ' History of
Humanity ' (Unesco, volume 1, 1994 chap. 11, p.130-131) F. Wendorf,
A . Close et R. Schild indiquent les dates suivantes pour l'Acheuléen
final à la charnière du paléolithique moyen :
-
260 000 ans
à Isimila
en Tanzanie (Howel et al., 1972) par la méthode de
l'Uranium-Thorium.
- 230 000 ans au lac
Baringo (nord-Kenya) par la méthode du potassium-argon
(Bishop, 1972, table 1, Leakey et al., 1969)
- 240 000 ans à
Malawa Gorge au Kenya par la méthode du potassium-argon
(Evernden et Curtis, 1965, p. 358)
- 200 000 ans est
l'âge estimé pour l'Afrique du Sud
- 235 000 ans
(±
5000) à Gademotta en Ethiopie par le potassium-argon, mais 181
000 ans (± 6000) à Kulkuletti, localité voisine, et même 149 000
ans (±12000), écarts probablement dés à des différences de niveaux.
-
En Egypte / Sahara oriental,
200 000 à 100 000 (Close, Wendorf, Schild in 'Sahara', 3,
1990, p. 121).
Ces auteurs constatent que
le Paléolithique moyen débute au Maghreb 100 000 ou 150 000 ans plus
tard qu'en Afrique orientale.
En Asie occidentale, le
Paléolithique moyen s'installe vers 150 000 /125 000 ans (âge obtenu par
la méthode ESR = résonance de spin électronique) probablement
apporté par 'l'homme de Galilée’ ou de Zuttiyeh (Homo
sapiens archaïque venu d'Afrique orientale vers 150 000 ans : niveaux yabroudiens, cf. G. Grimaud-Hervé
et al., 1998, p.
159)[3].
Il faut avoir présent à
l'esprit le fait que l'homme anatomiquement plus évolué naît dans un
contexte lithique donné. Ainsi les premiers Homo erectus ont-ils
continué à retoucher les galets avant d'inventer les bifaces et les
hachereaux, vers 1,4 million d'années. De même, Omo 1, Homme
moderne, est-il associé à du paléolithique moyen vers 130 000 ans. Ce
sont ses descendants qui inventeront, quelque 70000 ans plus tard, le
Paléolithique supérieur. En Afrique orientale, il semble que le
Paléolithique moyen ait été élaboré par les derniers 'Homo sapiens
archaïques anciens' (selon la classification de G. Bräuer).
Toujours dans la région
Isra‘l-Palestine les Hommes de Qafzeh sont, eux, des Hommes
modernes datés de 92000 ans par la méthode de la
thermoluminescence.
Dans cette région, le
paléolithique moyen dure jusque vers 43000/40000 ans - industrie de
transition (cf. A.J. Jelinek et O. Bar Yosef, History of Humanity,
Unesco, vol 1, 1994, chap. 14). Les paléontologues ont baptisé
'Proto-Cro-Magnon' les Hommes de Qafzeh parce que ces derniers ont
finalement donné naissance, après émigration, aux 'Hommes de
Cro-Magnon', célèbres fossiles d'Hommes modernes récents de
la France du Sud-Ouest. Mais les Hommes de Qafzeh eux-mêmes sont très
probablement venus lors d'une nouvelle migration, postérieure à celle de
l'Homme de Zuttiyeh, depuis l'Afrique orientale, par la vallée du Nil. 'L'Homme
de Singa', au sud de Khartoum, peut en représenter un jalon.
Le laps de temps séparant
les Hommes de Qafzeh de l'Homme de Zuttiyeh semble trop court pour que
le dernier puisse descendre des premiers ? Et y a-t-il des fossiles
intermédiaires sur place ?
Cependant, toujours en Asie
occidentale, sont juxtaposés, durant la même période, des crânes de
Néandertaliens : à Tabun, l'un d'eux a été daté de 120 000 ans
(C.S. Larsen, 1991)_ ; à Kebara et à Amud, ils sont datés
de 60000 ans. Au Kurdistan Irakien et en Ouzbékistan (limite orientale
de la population néandertalienne) ils ont été découverts dans des
niveaux compris entre 70000 et 45000 ans. Les Hommes de Skhul qui
ont 100 000 ans et dont la morphologie est composite, pourraient
résulter du contact entre Homo sapiens archaïques de Zuttiyeh et
Néandertaliens de Tabun (?).
En l'absence de vestiges
pré-néandertaliens dans le Proche-Orient, O.Bar-Yosef et B.
Vandermeersch présument que ce sont des Néandertaliens d'Europe
qui ont migré sur plusieurs générations vers l'Asie occidentale, lors de
froids extrêmes (cf O.Bar-Yosef et B. Vandermeersch, in 'Les
origines de l'humanité', dossier Pour la Science, janvier
1999, p.107 - 108).
La question se pose alors de
savoir si, quelque 100 000 ans après les Homo sapiens archaïques
d'Afrique, les 'Néandertaliens précoces' d'Europe ont inventé de
façon tout à fait autonome, le débitage 'Levallois’ et la
pointe 'moustérienne', c'est-à-dire le même Paléolithique Moyen
qu'en Afrique orientale ?
Cependant, une possibilité
de passage a pu exister entre l'Afrique du Nord et l'Europe au détroit
de Gibraltar à certains moments de la préhistoire. Durant les périodes
glaciaires, le fond de la Manche était assez largement asséché, les
rivages pouvaient se déplacer de 5 à 10 km, voire davantage, selon la
pente, d'une part, et l'ampleur de la régression marine, d'autre part.
Or, le détroit de Gibraltar a 14 km de large de nos jours.
Dans son chapitre sur la
préhistoire de l'Afrique du Nord (Histoire générale de l'Afrique,
Unesco, vol. I, p. 607) L. Balout écrit à propos de l'Acheuléen
maghrébin : ' La principale originalité est la place tenue par
les hachereaux sur éclats. Sa présence en Espagne (Rio Manzanares, près
de Madrid) et son franchissement des Pyrénées ont conduit H. Alimen à
reconsidérer le problème du franchissement du détroit de Gibraltar. Elle
conclut à l'existence d'un isthme favorisé par de hauts fonds, rendu
praticable au cours des régressions rissiennes (' Les isthmes
hispano-marocain et sicilo-tunisien aux temps acheuléens '. Anthropologie, 1975, 79, 3 : p. 399-430).
L. Balout constate ensuite
que le débitage Levallois apparaît au Maghreb dès l'Acheuléen
ancien et que la technique de 'l'éclat-nucléus' est présente (technique
de Kombema en Afrique méridionale) ; cette technique permet
d'obtenir un pourtour tranchant parfait. Il se demande enfin si c'est
l'Afrique qui a transmis à l'Europe des méthodes aussi élaborées ? Les
sites moustériens en revanche sont plus rares. L. Balout observe que '
le moustérien maghrébin n'a pu venir que de l'est '.
Puis, du Nil à l'Atlantique,
dans le Sahara et en Afrique du Nord, à partir d'environ 50000 / 40000
ans, les pointes moustériennes, déjà plus petites, sont systématiquement
pédonculées, constituant l'industrie 'atérienne' du site
éponyme, Bir el Ater, dans le Sud Constantinois, en Algérie.
En Afrique occidentale et
centrale, les industries sont rarement 'en place' et par conséquent
difficiles à dater. En Afrique forestière, les classifications lithiques
sont différentes ('Sangoen', 'Lupembienî) ; leur
ancienneté et leur durée sont mal connues.
5. Fin Paléolithique moyen /
Paléolithique supérieur
Ce qui caractérise
l'industrie du paléolithique supérieur c'est le microlithisme géométrique. Les outils lithiques et leurs formes sont de plus en
plus diversifiés. Objets de parure et art apparaissent.
A - Les dates
En Afrique orientale, la
charnière se situe vers 50000 ans à Ndutu et dans la gorge
d'Olduvaï, d'après plusieurs auteurs ; mais dans la grotte du
Porc-Epic, près de Diré Dawa, en Ethiopie, la date de 61000
ans BP a été obtenue par la méthode de l'hydratation de l'obsidienne
(F. Wendorf et al., History of Humanity, vol. 1 chap. 11
p. 131, d'après J.D.Clark et al, 1984, 'A Middle stone Age occupation
site at Porc Epic cave, Diré Dawa, East central Ethiopia', African
Archéol. Rev ; Cambridge, vol. 2 p. 37/71). En Afrique
australe, environ 38000 BP à Border Cave (Butzer et al.
1978), 30000 BP au Cap. Au Maghreb, 14000 BP (Oranien ou 'Ibéro-maurusien’)
[4].
En Asie occidentale, 43000 / 40000 BP. En Europe 38000/ 33000 BP. (History of Humanity, chap. 20 à 24 et autres sources).
En Afrique orientale,
l'évolution est remarquablement continue dans le temps et dans l'espace
(passage insensible d'une industrie à une autre). Les industries locales
sont certes spécifiques et variées mais, grosso modo,
l'observation montre que l'Afrique orientale d'abord, puis l'Afrique
australe sont passées à l'industrie dénommée 'Stillbayen’
(décrite au site de Stillbay en Afrique du Sud). Les 'feuilles de
laurier' sont travaillées sur deux faces, les éclats finement retouchés
par différents plans de frappe, dominance de la forme triangulaire ...
cette industrie est encore du 'Middle stone âge’ mais évolué et
final. Apparaît ensuite au Kenya l'industrie 'Capsienne’
[5]
(encore plus raffinée) et qui a été rebaptisée 'Eburran’
du nom de la montagne volcanique où tant de sites sont localisés, près
des lacs Naïvasha et Nakura ; elle aurait débuté vers 20000 BP (P.
Robertshaw, Journal of African History., 1984 p. 380).
Des variantes de cette
industrie apparaissent un peu plus tard, en Egypte, en Cyrénaïque puis
au Maghreb oriental, vers 9000 BP. En Afrique occidentale le
Paléolithique supérieur est peu daté. Ë défaut de mieux, l'âge de l'homme d'Iwo Eleru (Nigeria) lui est attribué, soit environ 11000
BP. Dans la zone du fleuve Congo, le Tshitolien apparaît vers
14000/ 12000 BP dérivé du Lupembien (nombreux tranchets) adapté à
la coupe du bois.
B - La grotte du
Porc-Epic
Mais il importe de s'arrêter
sur le cas de la grotte du Porc-Epic et de sa région, en
Ethiopie.
La grotte du Porc-Epic est
située à 2 km au sud de Dire Dawa. Y fut découvertes en toutes
sortes de roches (notamment silex, obsidienne, parfois même hématite)
une industrie de taille moyenne et petite nettement apparentée au Stillbayen, et une mandibule humaine très robuste, mais
'anatomiquement moderne' selon la classification de G. Bräuer, dans le
niveau le plus ancien, daté de 77500 ans.
Les parois de cette caverne
portent des peintures ' recouvertes de concrétions et considérées
comme antérieures à la couche archéologique la moins ancienne ' (H.
Alimen, 1955, p.443). Or deux dates ont été obtenues à partir de
pièces en obsidienne : 61000 et 77500 ans BP. Dans la moitié
supérieure du remplissage de la grotte, des microlithes géométriques
sont présents. Ë l'outillage de pierre se mêlent des fragments d'oeuf
d'autruche et des fragments de poteries que les découvreurs ne croient
pas être contemporains de l'industrie des mêmes couches.
La question qui se pose est
: de quand datent ces peintures ? L'âge habituellement attribué à la
naissance de l'art est 35000 à 40000 ans environ. Les sujets peints ici
sont l'homme (20 figurations très schématiques) l'éléphant, le lion, les
antilopes, les bovidés, un bubale, un cerf, une autruche. Les peintures
sont rouges, ocre jaune et brun-rouge. Richard Leakey estime à 35000 ans
des figurations rupestres de Tanzanie qui sont aussi très schématiques
(cf. La naissance de l'homme, Paris, éd. du Fanal, 1981,
pp. 163-164). Les techniques les plus récentes permettent de dater les
peintures elles-mêmes ; nous avons donc les moyens, maintenant, de
savoir si les peintures de la grotte du Porc-Epic sont plus anciennes ou
moins anciennes que 35000 ans, ou si elles sont contemporaines des
fragments de poterie. Ë noter également l'existence de perles faites en
coquilles d'Ïufs d'autruche datées de plus de 40000 ans, découvertes sur
le site d'Enkapune Ya Muto (Lac Naivasha, Kenya ; cf. R. G. Klein,
'L'art est-il né d'une mutation génétique ? La Recherche hors
série n°4, 'La Naissance de l'Art', novembre 2000, pp. 18-21).
Indépendamment de cette
question très intéressante, la grotte du Porc-Epic représente une pièce
capitale du puzzle préhistorique : c'est actuellement, à ma
connaissance, le seul endroit où l'on ait une date aussi ancienne pour
la charnière Paléolithique moyen/Paléolithique supérieur. Déjà, avec la
date de 50000 ans, il était clair que l'invention du Paléolithique
Supérieur avait eu lieu en Afrique orientale, ce qui est rarement dit.
Avec les dates obtenues à la grotte du Porc-Epic, ce n'est plus 7000 ou
8000 ans avant l'Asie occidentale que l'Afrique orientale a inauguré le
Paléolithique supérieur, mais une vingtaine de milliers d'années.
C - Des Africains en
Europe
En Asie occidentale, le
passage du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur se fait aussi
progressivement. En Isra‘l une séquence transitionnelle est repérée
entre 43000 et 40000 BP. Ofer Bar-Yosef en déduit que l'évolution s'est
faite sur place, sans influence extérieure, (History of Humanity, Unesco, vol. 1, chap. 24, p. 241 et 59). Le fait que
l'Egypte connaisse elle aussi une évolution continue et particulière,
même un peu plus tardive, semble-t-il, pourrait confirmer cette
autonomie.
Il en va différemment en
Europe où, à l'exception de quelques endroits localisés dont nous dirons
un mot plus loin, le Paléolithique supérieur repose directement sur le
Paléolithique moyen, même si, dans les régions septentrionales de
l'Europe, durant l'interstade 'les cottés‘ (36000 à 34000 BP),
quelques modifications dans le faciès lithique sont décelées : les Néandertaliens ont adapté leur industrie à la vie dans des steppes
parcourues par d'importants troupeaux d'herbivores (cf. Marcel Otte,
History of Humanity, vol. 1 chap. 21, p. 210).
La première formation ou
assise du Paléolithique Supérieur en Europe a reçu le nom d'Aurignacien,
ou culture aurignacienne, d'après le nom du lieu où elle
fut d'abord découverte : Aurignac en Haute-Garonne. C'est dans
les Balkans qu'elle est la plus ancienne : 40000 ans BP (Bulgarie,
Hongrie). En France, elle débute vers 35000 B.P (dates C14). Les
spécialistes s'accordent pour penser qu'elle a été apportée en Europe
par des migrants venus d'Asie occidentale (descendants des Hommes de
Qafzeh). Eux-mêmes très probablement venus d'Afrique orientale).
Cependant, de la Bourgogne
au nord-ouest de l'Espagne, et en Italie, une industrie intermédiaire
entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur existe sur
certains sites. En France elle est appelée 'Chatelperronien’,
du nom de la localité où elle fut découverte : Chatelperron (dans
le département de l'Allier). Les datations indiquent que des Néandertaliens tardifs vivaient encore en Europe occidentale il n'y
a que 35000 ans et qu'ils étaient les auteurs de cette industrie. Deux
interprétations possibles ont été formulées :
a/. perfectionnement
ultime et autonome de l'industrie néandertalienne.
b/. évolution par
contact avec les Aurignaciens, d'une manière ou d'une autre :
imitation des outils aurignaciens, avec une technique différente,
métissage culturel.
L'interprétation b/ paraît
plus plausible que l'interprétation a/ : cf. N. Mercier et H. Valladas
et al., in Nature, vol. 351, 27 juin 1999, pp. 737-738 ; J. J.
Hublin 'Derniers Néandertaliens et É' in Pour la Science, dossier
hors série sur Les Origines de l'Humanité, janv. 1999 p.
110-118 ; Anne Taverne, in La Recherche, n°334, septembre 2000,
pp. 48-51.
Notons au passage que plus
de 20 ans avant que la communauté scientifique internationale ne
commence à l'admettre
[6],
Cheikh Anta Diop écrivait que l'Homo sapiens sapiens était né en
Afrique [7].
Cette affirmation était le résultat de l'observation et de
l'interprétation objective des faits. En effet, les plus anciens
Hommes modernes qui aient été trouvés en Europe
occidentale sont les premiers Aurignaciens, ceux de la couche
inférieure de l'industrie aurignacienne, l'‘Homme de Combe
Capelle' et les deux squelettes entiers du fond de la Grotte
des Enfants au site italien de Grimaldi /Baoussé-Roussé,
proche de Menton. Ils présentaient une parenté évidente avec les
squelettes de l'Afrique intertropicale (prognathisme, nez large,
verticalité des ilions et courbure de la crête iliaque chez la femme,
etc.) ; de nombreux anthropologues européens l'avaient constaté. Et,
d'après les découvertes paléontologiques et paléolithiques déjà
effectuées en Afrique (cf les ouvrages et articles de C. Arambourg et H.
Alimen entre 1952 et 1961), C.A. Diop avait constaté que seul le
continent africain recelait les vestiges de tous les stades évolutifs,
tant après qu'avant les Australopithèques ; vu la morphologie des
premiers Aurignaciens d'Europe, il a logiquement pensé qu'ils ne
pouvaient venir que d'Afrique, selon un itinéraire à préciser et resté
hypothétique avant la découverte de l'Homme de Qafzeh et la
multiplication des datations.
Dans les années cinquante -
début des années soixante, en l'absence de datation absolue des
industries et des hommes fossiles africains d'aspect moderne, les
chercheurs occidentaux restaient persuadés que les Homo sapiens
sapiens n'avaient pénétré en Afrique que très tardivement à partir
de l'Asie . Ils s'évertuaient à trouver en Europe même le maillon
manquant entre les Homo erectus évolués Européens et les Hommes de Cro-magnon proprement dits (c'est-à-dire
orthognathes,
à nez étroit, ancêtres directs des Européens) et ce - soit
indépendamment des Néandertaliens - soit en passant par eux. En
effet, les Aurignaciens prognathes et à nez large, contemporains
de la couche de base du faciès aurignacien étaient perçus comme une
population intrusive, insérée dans le sud de l'Europe comme un corps
étranger entre les Néandertaliens et les Cro-Magnons.
Puis, dans les années 60/70,
ces mêmes Aurignaciens furent progressivement ramenés au rang de
simple sous-groupe, inclus dans une population dénommée globalement 'Cro-Magnons’
[8] 'à
larges variations' englobant tous les types, (y compris des crânes
complexes d'Europe centrale pouvant peut-être provenir d'un métissage
avec les Néandertaliens), et cela, sans plus tenir compte de la
chronologie exacte et précise. (cf. E. Genet-Varcin, Les Hommes
fossiles, Paris, Boubée, 1979, pp. 179 et sq ; et Origine
et évolution de l'Homme, ouvrage collectif, Laboratoire
de Préhistoire du Musée de l'Homme, Paris, MNHN, 1982, p. 211 et sq).
Il serait trop long de
développer ici une analyse critique de ce glissement opéré à la suite
des travaux de P. Leroux et de F. Mantelin. Observons seulement que :
a
- Les deux squelettes
aurignaciens anciens de la Grotte des Enfants à Grimaldi ont été
trouvés au fond d'une fosse creusée dans le Moustérien tandis que
les restes de l'Homme de Cro-Magnon étaient enterrés dans
l'Aurignacien - Ils ne peuvent donc être du même âge alors qu'ils
sont présentés comme tels dans les publications récentes (notamment
celle du Musée de l'Homme, 1982). L'Homme de Cro-Magnon ne peut
être que moins ancien : soit du Gravettien, environ 27000 BP, soit du
solutréen inférieur, 23000 BP.
b -
L'Homme de
Combe Capelle date de 35000 ans (D. Grimaud-Hervé et al., op. cit., 1998, p. 79), son ancienneté a été confirmée, entre
autres, par F. Bordes et J.J. Bouvier (cf. E. Genet-Varcin, 1979, p.
180). Les Aurignaciens d'Espagne, sont maintenant datés d'environ
38500 ans (Nature, 27 juin 1991, p. 737). Selon l'hypothèse
formulée par C.A. Diop, les descendants des Aurignaciens ont dé
perdre en Europe leur coloration foncée, surtout durant le fort maximum
glaciaire de 23000 à 19000 BP. Un confinement au moins partiel dans les
grottes a dé y contribuer. En 1981, Richard Leakey a de même supposé que
les Homo erectus passés d'Afrique en Europe avaient dé perdre
leur pigmentation (La naissance de l'homme, éd. du Fanal,
p. 117)
[9].
c -
La première reconstitution de la mâchoire de l'adolescent aurignacien de
Grimaldi avait, certes, exagéré son prognathisme, mais ce prognathisme
existe néanmoins et il y a 18 signes qui peuvent différencier le
squelette (tête et corps) des ressortissants de la zone intertropicale
africaine de celui des individus récents (à partir de 25000/20000 BC) de
la zone tempérée froide européenne, encore qu'en Afrique
intertropicale même, une grande variabilité existe. Sans être
majoritaires, quantités d'individus y ont le nez moins large et peu de
prognathisme, et cela, depuis la préhistoire, ainsi que le montre
notamment la description par H. Alimen de l'un des Hommes d'Oldoway.
(La Préhistoire de l'Afrique, 1955, pp. 397-398). La plupart de
ces signes distinctifs ont été répertoriés dans un texte de M. Chabeuf,
sous le titre 'À propos de l'Homme de Grimaldi - Mélanodermes, Nègres
et Négroïdes’. Ce texte permet aussi de remettre en cause, comme je
l'avais fait dans ma thèse
[10],
la classification des 'Hommes de Mechta’ qui vivaient au Maghreb
entre 14000 et 10000 BP. Le récent ouvrage de B. Sall, Racines
éthiopiennes de l'Egypte ancienne (Khepera/L'Harmattan, Paris,
1999) apporte des éléments qui confirment ces observations (pp.
163-180).
d -
Le cas de l'Afrique du Nord
Ajoutons que l'ostéologie
des premiers Aurignaciens d'Europe et d'Asie occidentale, celle
des 'Hommes de Mechta’ et celle des 'Capsiens’ interdisent
d'appeler 'Blancs' les 'proto- méditerranéens' comme le fait M. Cornevin
dans son ouvrage Secrets du continent noir révélés par
l'archéologie, p. 52.
Comme les Homo erectus
l'avaient fait à plusieurs reprises lors des périodes humides, les
habitants du Soudan oriental et central ont occupé le Sahara jusqu'à la
côte méditerranéenne quand les conditions naturelles les y incitaient.
Les disparités climatiques régionales observées et leurs oscillations
ont contribué à ce processus.
Déjà H. Alimen avait observé
l'unité des styles dans les figurations pariétales en Afrique de l'est,
du nord et du sud. Elle notait qu'en Afrique orientale l'art est ancien
selon L. Leakey (Paléolithique supérieur) et devient vite naturaliste.
Sur les rives ouest des lacs Victoria et Eyasi et en Tanzanie
centrale, l'ancienneté des peintures est attestée (environ 35000
ans) : le Stillbayen est présent dans les districts riches en
peintures et les couches archéologiques contiennent, à plus de 5 m de
profondeur, des matières colorantes et des palettes de couleurs
alors qu'en Afrique du Nord ' les plus anciennes semblent incluses
dans les couches à industrie capsienne ' qui est postérieure à 10000
BP. En Egypte et en Libye, elles paraissent d'un âge intermédiaire
notamment au Djebel Ouennat. Comme B. Sall l'a rappelé dans le précédent
numéro de Ankh, des affinités ont été constatées entre
l'industrie des hommes de Mechta et le Qadien en Nubie
[11].
Les Noirs ne se sont certainement pas arrêtés dans les massifs du Sahara
central où des 'Blancs' (imaginaires) seraient venus les rejoindre ' dès 8000 BC
' ! Dans l'Histoire générale de l'Afrique (Unesco, vol. 2, chap. 17, 'Les Protoberbères') J.
Desanges observe que, dans l'iconographie égyptienne de l'ancien Empire,
les Libyens sont représentés avec le type africain ('grande taille,
lèvres épaisses'). C'est seulement vers 2300 BC qu'apparaît ' un
groupe ethnique nouveau, à la peau plus claire et aux yeux bleus avec un
pourcentage non négligeable de blonds ' (p. 461). Auparavant, il n'y
avait dans toute l'Afrique septentrionale, y compris l'Egypte, que de
minimes infiltrations de Blancs et de Sémites. Le métissage date de
l'invasion des Hyksos (à partir de 1730 av. J.C.).
6. Coup d'oeil sur l'Asie
méridionale et orientale
Les paléontologues se sont
demandé pendant longtemps si l'Asie, plutôt que l'Afrique, n'était pas
le berceau de l'humanité, du moins au stade Homo erectus
(Pithécanthrope de Java) ou au stade Homo sapiens sapiens.
Là encore les datations ont
joué le rôle essentiel pour tirer au clair cette question. G. Bräuer a
déjà montré dans cette revue même (n°3, 1994, p. 139) que de telles
hypothèses ne peuvent pas être retenues dans l'état actuel des
découvertes.
Au stade Homo erectus
archaïque, une mandibule, un éclat et un percuteur ont été découverts
dans la grotte de Longgupo, en Chine du Sud, daté de 1,8 million
d'années, ce qui prouve la migration précoce des plus anciens Homo
erectus africains ; mais c'est au niveau de 1 million d'années à Java
et 800 000 ans en Chine qu'apparaissent des séries d'Homo
erectus s'échelonnant dans le temps. Cependant, dans les deux cas,
apparaissent des lacunes paléontologiques et chronologiques entre les
séries de vestiges, ce qui signifie que des migrations se sont produites
de l'Afrique vers l'Asie à des stades différents d'évolution,
particulièrement à ceux des Homo sapiens archaïques et des Homo sapiens sapiens ou
Hommes modernes lesquels arrivent
tard en Chine (vers 20000 BC).
En Inde, les
conditions géologiques de fouilles ne sont guère favorables. En dehors
du site septentrional de Kiwat, vieux de 1,6 million d'années,
ont été dénombrés treize sites principaux dont la moitié sont groupés
dans la région de la rivière Narmada (région nord-ouest). Bifaces et
hacheraux acheuléens sont présents. Un crâne
incomplet, intermédiaire entre Homo erectus et Homo sapiens
archaïque a été trouvé. Il a beaucoup de ressemblance avec celui du
gisement de Dali en Chine centrale.
Sur la côte Est du
Japon,
à Takamori, des outils en pierre ont été découverts sous une
couche volcanique datée d'environ 300 000 ans, (D. Grimaud-Hervé et
al., 1998, p. 56). C'est la plus ancienne attestation de présence
humaine dans ce pays et cela laisse supposer qu'un pont a dé exister
lors d'un fort maximum glaciaire (régression marine). Tomokazu Endo
(1994) a attribué 350 000 ans d’âge à cette industrie lithique (époque
de la glaciation de Mindel en Europe).
Les divers spécialistes
s'interrogent sur quelques hybridations possibles entre Aurignaciens
et Néandertaliens, en Europe et aussi en Indonésie entre les
nouveaux arrivants (Hommes modernes) et les occupants précédents,
ce qui permettrait d'expliquer, selon eux, la morphologie de certains
crânes. Mais dans l'état actuel des découvertes, un hiatus
chronologique de 50000 ans les sépare comme l'a fait remarquer G.
Bräuer.
Notons de plus avec G.
Bräuer que certains caractères que l'on croyait spécifiquement
asiatiques, existent en fait, dans environ 20% des populations de
l'Afrique noire, ce qui conduit à penser que des émigrants, parmi les
ancêtres de ces populations, se sont multipliés en Asie orientale. Une
équipe de généticiens chinois et texans a récemment confirmé l'origine
africaine des Chinois (cf. Proceedings of the National Academy of
Sciences, Etats-Unis, vol, 95, septembre 1998).
L' 'Homme moderne’
est arrivé au sud de la Malaisie il y a environ 40000 ans et en
Australie vers 30000 BP ou peut-être plus tôt. Certains spécialistes
avancent 50000 ans pour une première vague d'immigrants.
Les Amériques ont été
peuplées tardivement. La date des premiers arrivants reste discutée. Ils
provenaient vraisemblablement de l'Asie centrale et orientale par le
détroit de Béring, pris dans les glaces lors de la dernière glaciation.
Ils ont occupé successivement toutes les régions du nord et du sud le
long du Pacifique et de la cordillère des Andes jusqu'à la Patagonie.
Mais le site complètement isolé dans la corne atlantique du Brésil (Toca do Boqueira / Pedra Furada) pourrait s'expliquer
par une traversée involontaire réalisée par hasard, sur une barque, de
quelques Africains entraînés (comme l'a été P.A. Cabral en 1500), par
des courants marins (comme aussi probablement quelques rescapés
de l'expédition du frère de l'empereur du Mali, vers 1300, puisque,
selon diverses sources, les Espagnols trouvèrent en Amérique 'des
populations noires arrivées en très petit nombre'[12]).
L'eau de pluie leur aurait permis de subsister. C'est en tout cas plus
plausible que de les imaginer venant du pacifique, en traversant les
Andes et l'Amazonie[13].
7. Néolithique
Le passage du Paléolithique supérieur au
Néolithique se fait par l'Epipaléolithique ou par le
Mésolithique.
La définition du
Néolithique a donné lieu à des controverses, et la question a été
posée de savoir si l'on pouvait parler de 'révolution néolithique'.
Si le Néolithique se réduit à la capacité d'accumuler des provisions
grâce à la production agricole, force est de constater que l'agriculture
n'apparaît pas forcément en même temps ou au même endroit que d'autres
éléments habituellement considérés comme propres au Néolithique :
céramique, polissage de la pierre, domestication des animaux, vannerie,
tissage, agglomération notable des habitations ...
Il a été admis
internationalement de substituer le concept anglo-saxon de 'food
production' à celui de Néolithique, ce qui paraît valable pour la Haute-Egypte et la
Basse-Nubie mais pas pour toute l'Afrique
où élevage et agriculture sont des activités souvent séparées, où la
céramique est très précoce, où les métaux eux-mêmes peuvent apparaître
en même temps que l'agriculture, où l'abondance de la pêche, de fruits,
d'animaux comestibles très différenciés, permettait aux habitants
d'avoir une vie déjà de type néolithique dans des régions où ils
n'avaient pas encore un besoin pressant d'une production agricole
proprement dite : sédentarisation, accroissement des densités de
populations, ateliers de fabrication d'industrie lithique, meulesÉ Je
proposerais donc de donner au Néolithique une certaine épaisseur
et de convenir qu'il commence quand deux de ces éléments apparaissent.
Répertorions les faits
suivants :
- Début
d'agriculture en Haute-Egypte vers 10000 BP (A. Close, in Journal
of African History, 1984 ; vol. 25, p.4) et environ 1000 ans plus
tard dans le Sahara central.
- Vers 10000 - 9000
BP, en Basse-Nubie (sites de Nabta Playa et de Kir Kiseiba, à
l'ouest d'Abou Simbel), domestication des bovins (F. Wendorf, A.
Close, A. Gautier et R. Schild, 'Les débuts du pastoralisme en Egypte'
in 'La Recherche' vol. 21 n°220 avril 1990 pp. 436-446). Les
auteurs précisent que ce processus de domestication des bovins est 'légèrement
plus ancien' qu'en Asie.
- Vers 10000 BP
les outils polis commencent à apparaître dans le Nachikoufien,
en Zambie septentrionale (F. Van Noten, in 'Méthodologie et
Préhistoire', Histoire générale de l'Afrique, vol 1,
1980, Unesco /jeune d'Afrique, Paris, p.676).
- Vers 9500 BP,
la
céramique est attestée dans le massif de l'Aïr (cf. La Recherche
n°148 oct.1983 p.1248 : travaux de J.P. Roset et A W Fairhall). Dans la
grotte de Gamble (Elmenteira, à l'est du lac Victoria
Nyanza) une céramique a été trouvée dans le niveau inférieur daté de
8000 BP environ (JEG Sutton, 'Préhistoire de l'Afrique orientale' in Histoire générale de l'Afrique, Unesco, vol.1 chap.19, p.522, 1980)
et plus au sud, des 4e et 3e millénaires.
- Vers 9000 BP une
ville commençait à se développer dans la région de
Nabta
(à l'ouest d'Abou Simbel). Son histoire démontre que le désert au
sud-ouest de l'Egypte fut le berceau de la civilisation égyptienne (BIA,
n°5, Janvier/juin 1992 p. 63 publication de l'IFAO, le Caire).
Bien entendu il s'agit là
des dates les plus anciennes dans chaque domaine, mais elles prouvent
que contrairement à une idée qui reste répandue, les Africains (tous
foncés à l'époque, plus ou moins prognathes et le nez plus ou moins
large) n'étaient aucunement en retard sur l'Asie et l'Europe aux débuts
du Néolithique. Pour le passage à la production agricole, J.R. Harlan a
relevé des dates plus anciennes en Asie occidentale, en Grèce et dans la
péninsule Indienne : 11000 et 12000 BP. (History of Humanity,
UNESCO, vol.1, chap.37). Mais la Haute-Egypte donne des dates aussi
anciennes et même plus anciennes pour ce qu'on pourrait appeler une
'pré-agriculture' en raison, notamment, de la présence de faucilles en
pierre (F. WendorfÉ). En dehors de la Haute-Egypte et de certains sites
du Sahara central, la production agricole en Afrique débute plus tard :
8000-7000 BP au Soudan (A. Close, J.A.H. 1984 p.7), 5800 BP en
Afrique occidentale, à la lisière forêt/savane, notamment à Iwo-Eleru,
au Nigeria (Waï Andah B. 'l'Afrique de l'Ouest avant le 7e
siècle", in Histoire générale de l'Afrique, vol.2
chap.24, Unesco, 1980).
-
A Dufuna (Bassin nigérian du Tchad) une
pirogue monoxyle a été récemment découverte et datée d'environ 6000 ans
avant J.C. (P. Breunig, K. Neumann, W. Van Neer, 'New Research on the
Holocene Settlement and Environnement of the Chad Basin in Nigeria', in
African Archaeological Review, vol. 13, n°2, 1996, p. 111 et
sq.).
-
La domestication des bovins date
de 6000 BP à Arlit dans le massif de l'Aïr d'après H. Lhote (R. Vernet,
Vallées du Niger, Paris 1993, p.70) et vers le milieu du 3e
millénaire à Karkarichinkat (Mali), Ntereso et Kintampo (Ghana), ainsi
que sur les hauts plateaux de l'Afrique orientale (J.E.G. Sutton, Histoire générale de
l'Afrique, Unesco, vol.1 p.522).
-
Diverses autres régions affirment, dans
les 2 derniers millénaires avant J.C., leur développement économique :
dans le Nachikoufien (Zambie) la poterie apparaît vers 4000 BP.
En Centrafrique, l'archéologue P. Vidal estime à 3100 BP le moment où
apparaît 'une population sédentarisée et probablement agricole ' (1100
BC) ; (cf. P. Vidal 'Au-delà des mégalithes : archéologie Centrafricaine
et Histoire de l'Afrique centrale', in J.M.Essomba éd. L'Archéologie du Cameroun, Actes du colloque international de
Yaoundé, Paris, Karthala 1992, p.147-148) ; 3100 BP, c'est aussi la
date à laquelle, en Mauritanie, la proportion de millet perlé fait un
bond de 5 à 60% dans les graines de graminées locales (T. Shaw, Histoire générale de l'Afrique, Unesco, vol.1 p.663) ; c'est
encore à cette même date que de nombreux villages ont été repérés en
Mauritanie orientale.
-
C'est au cours du premier millénaire
avant J.C., c'est-à-dire entre 3000 et 2000 BP, que s'épanouit autour
des rives méridionales du lac Tchad, progressivement rétréci, ' une
économie mixte associant l'agriculture, l'élevage et la pêche " (D.
Lange et BW. Barkindo, Histoire générale de l'Afrique,
vol.3, chap. 15).
Il n'est pas inutile de
rappeler ici que la naissance de Rome en tant que hameau se situe vers
753 av. JC. Ce serait aussi à cette époque que les San d'Afrique du Sud
auraient commencé à pratiquer l'élevage.
8. L'Histoire
a) Histoire de l'Egypte
ancienne et de la Nubie
Toute une série de datations
récentes ruinent les théories échafaudées pour faire à tout prix venir
du Proche-Orient les éléments civilisateurs de l'ancienne Egypte. Ces
datations concernent les points suivants :
-
L'identification d'un site
d'observation astronomique en Haute-Egypte. Un site mégalithique
très ancien, antérieur à celui de Stonehenge, en Angleterre, environ
4800 ans avant J.-C., a également été mis au jour dans cette région. La
disposition des pierres levées est considérée comme la preuve de
l'existence d'une astronomie dès cette époque en Haute-Egypte
[14].
-
L'apparition de l'écriture
hiéroglyphique. Les récents résultats des fouilles menées par
l'égyptologue allemand Günter Dreyer
[15],
à Abydos, montrent que l'écriture égyptienne remonte au-delà de 3250 ans
avant J.-C., vers 3400 (G. Dreyer, 'Beginnings of Writing in Ancient
Egypt', presentation at New York)[16].
Il s'agit d'une confirmation de l'antériorité de l'écriture
hiéroglyphique par rapport aux autres systèmes d'écritures connus (Cf.
article de Théophile Obenga dans ce même numéro de ANKH).
Elle est née en Haute-Egypte
dans un contexte 'prédynastique' qui couvre d'ailleurs à la fois
l'Egypte et la Nubie, et qui s'affine rapidement entre 4600 ans et 3100
av. JC.. Les phases successives du 'Prédynastique' ont été datées[17].
-
La période d'émergence du delta du Nil
et l'antériorité de la Haute-Egypte par rapport à la Basse-Egypte.
En effet dans le chapitre 5, "Légendes, histoires, niveaux de la mer",
de son livre L'Homme et le Climat
[18]
Jacques Labeyrie, ancien directeur du Centre des faibles radioactivités
du CEA-CNRS, à Gif-sur-Yvette, écrit :
"Bien que ces documents
écrits soient peu nombreux au début, limités à quelques empreintes de
sceaux royaux, ils nous éclairent cependant sur les premiers temps de
l'histoire de l'Egypte, un peu avant que ne débute la première dynastie.
C'était alors l'époque nagadienne. Des rois se succédaient depuis
longtemps déjà dans l'Egypte du Sud, que l'on appelle aussi haute
Egypte, c'est-à-dire tout au long de la vallée du Nil située plus au sud
que la position actuelle du Caire. D'autres rois existaient aussi dans
l'Egypte du Nord, c'est-à-dire la région constituée par le delta du Nil,
mais ces rois du delta ne s'étaient pas installés depuis longtemps, tout
au plus depuis deux ou trois siècles : nous savons maintenant que c'est
parce qu'auparavant le delta était encore immergé (É) Le lien entre
l'abaissement du niveau de la mer et le développement de la civilisation
égyptienne est clair : il existe, en effet, comme nous allons le voir
maintenant, une très bonne concordance entre les dates "Carbone 14"
égyptiennes et celles de la sortie du Delta de la mer vers - 4700 (É) On
data ainsi une quantité de restes attribuables à l'activité humaine,
dans le Delta, la vallée du Nil et aussi dans les régions qui entourent
cette vallée. Cela a permis de savoir qu'à tel moment du passé l'homme
occupait - ou n'occupait pas - ces lieux. Et de cette manière l'on a
fait une constatation très curieuse. Dans toute l'étendue du royaume du
Sud, c'est-à-dire dans la haute vallée du Nil à partir du sud du Caire,
ainsi que dans ses prolongements dans le Soudan actuel, on trouve des
artefacts humains jusque bien au-delà de - 20000 (É) On trouve aussi de
nombreux vestiges très anciens dans ce qui est aujourd'hui la Palestine
et la Jordanie, ainsi que sur le territoire de la Libye. Bref, toute
cette région du Proche-Orient s'est révélée, grâce au Carbone 14, très
anciennement peuplée, dès le paléolithique supérieur. Toute la région,
sauf le delta du Nil. Pour celui-ci, les dates Carbone 14 ne commencent
en effet que vers - 4200, soit 3000 av. J.C. Mais à partir de ce moment,
très vite, elles deviennent très nombreuses. Tout se passe en fait comme
si l'implantation humaine n'avait eu lieu dans le Delta qu'à partir de
cette date, alors que partout ailleurs, comme on vient de le dire, elle
existait depuis longtemps."
Ces résultats montrent
que le mouvement de la civilisation égyptienne du Sud vers le delta du
Nil est corrélé à l'abaissement du niveau de la mer et recoupent
parfaitement la tradition rapportée par les Anciens
[19].
Si les textes
hiéroglyphiques qui ont subsisté ont permis de reconstituer la
chronologie des dynasties qui se sont succédé sur le trône de l'Egypte
ancienne, les datations ont aidé à en vérifier l'exactitude.
Réciproquement les méthodes de datation physico-chimiques ont pu tester
leur validité en confrontant leurs résultats aux dates anciennes déjà
historiquement situées dans le temps avec certitude. Lorsqu'il y a un
décalage, le problème est soulevé et étudié de part et d'autre.
L'antériorité de la
royauté en Basse-Nubie ainsi que son lien et rôle capital dans la
genèse de la civilisation égyptienne. C'est grâce aux datations qu'on a
pu se rendre compte que l'origine de la civilisation égyptienne se situe
en Basse-Nubie :
- d'une part, en
étudiant les figures gravées sur l'encensoir découvert à Qustul, dans
une tombe du cimetière L appartenant à la population dite du groupe A de
Nubie, lui-même daté de la seconde moitié du 4e millénaire,
vers 3200 BC ; le chercheur américain Bruce Williams y reconnut la
longue couronne blanche de la Haute-Egypte, le dieu faucon Horus, la
façade d'un palais rappelant celle du domaine funéraire de Djoser
[20],
- d'autre part, en
déterminant l'âge de la ville préhistorique découverte dans la région de
Nabta. Certes les Egyptiens anciens eux-mêmes disaient qu'ils étaient
originaires du sud. Mais aujourd'hui, nous en avons la preuve matérielle
et certaine [21].
De même, les civilisations anciennes de la Nubie :
- 'Groupe A' de -3500 à
-2700,
- 'Groupe C' de -2240 à
-2100,- Kerma : de -1730 à -1580,
- Napata : de -900 à -600,
- Méroé : de -500 à 400
après Jésus-Christ
ont-elles pu être
reconnues à partir de l'archéologie et des datations, en liaison avec
les documents égyptiens. Il est à noter que les datations par le
radiocarbone d'échantillons archéologiques tendent à vieillir certaines
phases de la civilisation égyptienne. Tel est par exemple le cas de
l'Ancien Empire égyptien qui débute avec la IIIème dynastie
marquée en particulier par le règne du pharaon Djoser et le
savant divinisé Imhotep, et qu'il faudrait repousser de 300 à 400
ans dans le passé [22]
et donc placer vers 3000 avant J. C.
L'ensemble de ces
nouveaux éléments, qui d'une manière générale montrent que les faits de
civilisation relatifs à la Nubie et à l'Egypte ancienne doivent être
reculés dans le temps, invitent à réviser en profondeur la chronologie
et l'image habituellement proposée de la genèse des civilisations
nilotiques ainsi qu' à évacuer toute synchronisation arbitraire entre la
chronologie du Bassin du Nil et celle de la Mésopotamie
[23].
Ce sont autant de confirmations de la pertinence scientifique des
travaux de Cheikh Anta Diop et de ses continuateurs.
b) La métallurgie du Fer
[24]
La métallurgie du fer
de gisement est aussi, rappelons-le, beaucoup plus ancienne en Afrique
que ne l'admettait l'opinion générale. Si l'on combine le tableau établi
par J.P.Mohen ('Métallurgie préhistorique', Paris 1990, reprise
dans History of Humanity, vol 2, UNESCO, 1996, p.19) avec
les plus anciennes dates obtenues récemment par G. Quéchon et al.
au massif de Termit (entre le lac Tchad et le Massif de l'Aïr)
[25]
nous obtenons le tableau suivant :
|
Site |
Définition |
Date B.C. |
Nickel |
Conclusion |
|
Niger
oriental :
Egaro
(ouest de Termit) |
Objets divers |
2520-1675
2900-2300 |
No
No |
Reduced
Reduced |
|
Égypte :
Gisa
Abydos |
Rust, Valley of the
Temple M
Rusted tool,
pyramide of Cheops
Lump of rust_ |
2565-2440
2565-2440 ?
2345-2181 |
No
No
No |
Reduced
Reduced
Reduced |
|
Égypte : Buhen (Nubie) |
Lance-head |
1991-1786 ? |
No |
Reduced |
|
Niger
oriental :
Termit
Tchire
Oumma146
Gara Tchia
BO 48 b |
Objets divers |
1870-1130
1810-1375 |
No
No |
Reduced
Reduced |
Vestiges les plus anciens
de fer de minerai en Afrique
|
MesopotamiaTell
AsmarTell
Chagar Bazar
Alaça |
Blade
of dagger with Cu handle
Fragment No. 5, tomb G.67
Dagger
blade. Tomb K |
2450-2340
2400-2100 |
No
No
No |
Reduced
Reduced
Reduced |
|
Cyprus : Lapithos |
Rough bead, tomb 313 |
1800-1750 |
No |
Reduced |
Comparaison avec la
Mésopotamie et l'Ile de Chypre
J.P Mohen signale également
un instrument en fer (ne comportant pas de pourcentage de nickel)
découvert dans une tombe datée de 5000 BC à Samarra en Iraq, au sujet
duquel on s'interroge. Par ailleurs, la lame du poignard de Tell
Asmar avait disparu par oxydation ; ce qui fut analysé ce sont
quelques parcelles adhérentes au manche, c'est-à-dire des parcelles
d'oxyde provenant de la décomposition de la lame. Dans ce cas, la
constatation de l'absence de nickel n'est guère probante. Notons que les
dates obtenues à Egaro permettent de considérer comme possible l'origine
ouest-africaine des quelques échantillons de fer de minerai trouvés en
Egypte et datant de l'Ancien Empire (2565-2181), d'autant qu'en
Mésopotamie, les dates sont comprises entre 2450 et 2100, sauf à
confirmer celle de Samarra.
Nous ne reprenons pas ici
les dates obtenues à Ndalane au Sénégal car il s'avère
que la fouille n'a pas été réalisée selon les règles et qu'en
conséquence, le charbon dément daté à Dakar (Sénégal) et à Gif/Yvette
(France), pourrait ne pas être du même âge que l'outil en fer découvert
dans le fond du tumulus. De nouvelles fouilles seraient donc nécessaires
avant de confirmer ou infirmer la date ancienne précédemment retenue. En
revanche, de nouvelles dates significatives ont été obtenues en 1998/99
: au Cameroun pour le site d'Oliga (zone nord de
Yaoundé) une série de dates s'échelonnant de 1300 avant J.C. à 567 ap.
J.C. (cf. Paléo-anthropologie en Afrique Centrale,
Michèle Delneuf et al., l'Harmattan, 1999, chap. XIV, 'L'archéologie
de l'âge du fer au Cameroun méridional' par Joseph-Marie
Essomba). En Centrafrique, dans la région mégalithique de Bouar
au site de Gbabiri (site 77), les dates corrigées tombent vers
800 BC (cf E. Zangato, 1999, BAR, Cambridge, série monograph. African Archaeology n°45 - cf. aussi
Journal des Africanistes
n° 65-95,2). Ainsi l'ancienneté et l'endogénéité de la paléo-sidérurgie
africaine sont-elles maintenant indiscutables et indiscutées. La carte
schématique ci-après résume la répartition des sites du fer antérieurs
au 6e siècle avant J.C. Dans la moyenne vallée du fleuve
Sénégal, le site de Sincu Bara a été découvert en 1972
par A. Ravisé. Il a été occupé sur une période allant du 5ème
siècle au 12ème siècle après J.C.
[26].
c) Agglomérations et
vie économique en Afrique subsaharienne [27]
L'archéologie et les
datations apportent des éléments nouveaux sur l'habitat et l'économie de
l'Afrique subsaharienne dans les temps anciens. Les deux exemples les
plus frappants pour l'Afrique occidentale sont :
1. La
civilisation de Nok-Taruga
[28]
(Nigéria, au nord de la Basse-Bénoué), caractérisée principalement par
ses figurines en terre cuite et la présence du fer, et dont les dates
C14 s'échelonnent de -3 500 à + 200.En fait, faute de fouilles assez
nombreuses et systématiques, il n'existe que peu de dates pour la région
de Nok. Les deux dates les plus anciennes, 3500 BC et 2000 BC ont été
décrétées inacceptables depuis quarante ans. L'ancienneté du fer au
massif de Termit, qui pourrait dépasser 2500 BC, oblige
à reconsidérer cette question. Actuellement, les dates généralement
admises pour la civilisation de Nok ne
remontent pas au-delà du 9e ou 10e siècle BC. On
ne saurait trop insister sur la priorité qu'il faudrait accorder à la
région de Nok comme lieu de fouilles approfondies d'autant que dans la
région de Termit les datations ont révélé que les
objets en fer ont été trouvés dans des couches plus anciennes que celles
qui contiennent les vestiges de fourneaux (Do Dimmi), sauf erreur de ma
part.
2. La cité de
Jenné-Jeno [29]
(près de l'actuelle Djenné au Mali), qui date du 3e siècle
BC, comme les premières agglomérations urbaines de l'Ethiopie. C'est
grâce aux travaux remarquables de S. et R. Mc Intosh (1980)
[30]
que l'existence de Djenné-Djeno a été révélée. Personne auparavant
n'imaginait qu'une cité ait pu naître en Afrique occidentale avant le 3e
siècle AD, sinon plus tard encore.
En ce qui concerne
Jenné-Jeno, les datations effectuées pour le Mali et l'Ethiopie
ont donc révélé que la cité malienne a la même ancienneté que les
premières villes éthiopiennes. S. et R. Mac Intosh ont pu en outre
établir que la région de Djénné (Jenné)
est en pleine expansion depuis la fin du premier millénaire A.D. et que
cette expansion n'est pas due au commerce transsaharien mais
bien au développement interne d'un réseau commercial de
plus en plus complexe ce qui est confirmé par des fouilles
menées à l'ouest du lac Debo. La naissance de l'empire de Ghana a été
aussi reculée de plusieurs siècles. On la localise maintenant vers le 3e
siècle A.D. (après J.C.).
Grâce aux datations, G.
Connah a pu démontrer que les objets d'art, notamment en cuivre, des
Royaumes anciens Yoruba (Ilé-Ifé, Oyo) et Bénin sont
antérieurs à l'arrivée des navigateurs européens. Certains datent du 13e
siècle, mais leur origine est très antérieure. Le site Igbo-Ukwu à l'est
du fleuve est daté du 9e siècle après J.C. d'après G. Connah.
Il a livré plus de 150 000 perles de pierre et de verre et des centaines
d'objets artistiques en cuivre et en bronze. D'autres vestiges ont été
datés du 15e siècle par la méthode de la
thermoluminescence (G. Connah, 1987, African
Civilizations, Precolonial cities and States in Tropical Africa,
Cambridge, University Press, p.136). à Ifé, G. Connah signale que la
principale période où des pavements ont été élaborés, va du 12e
au 15e siècle (dates C14 et par la thermoluminescence),
d'après T. Shaw (1980, p.376).
En Afrique orientale,
les nécropoles de Sanga et de Katoko,
dans la haute vallée du Congo, (Graben de l'Upemba), ont été datées du 8e
siècle AD environ (F. Van Noten, Histoire générale de
l'Afrique, Unesco, vol.2 p.691). L'auteur remarque en
particulier l'abondance et la qualité des objets en fer et en cuivre. A
Bigo, en Ouganda, des ouvrages de terre 'immenses'
(talus et fossés) ont été datés des 15e /16e
siècles AD, par le radiocarbone. Les 6800 ruines d'Engarouka
qui ont fait couler beaucoup d'encre, sont datées de 330 (±90) AD à 1460
(±90) AD. Elles se trouvent à la frontière Kenya/Tanzanie,
entre la côte et le lac Victoria Nyanza.
Au sujet de 'Great
Zimbabwe’ dont les constructions cyclopéennes ont tant étonné
les premiers immigrants ou voyageurs européens, on reste finalement peu
renseigné. 'Le niveau de 'l'acropole' correspondant au début de l'âge
du fer, a été daté d'avant le 4e siècle AD " écrit B.
Fagon (Université de Californie, Santa Barbara) dans le vol.4 de l'Histoire générale de l'Afrique, (Unesco, p.583 et sq). Diverses
publications sur la question ne sont pas plus précises (P. Garlake,
1973, G. Connah, 1987).
L'apogée du
Mwene
Mutapa se situe au 13e siècle, et sa chute, au 15e.
Plus au sud, Mapungubwé aurait été le centre le plus
important au 12e siècle, selon Huffman (1978 et 1982), cité
par G. Connah.
9. Discussion et
conclusion
Depuis une quarantaine
d'années que les datations physico-chimiques se multiplient, la vision
que l'on pouvait avoir de la préhistoire a été progressivement, mais
complètement renversée. Il s'est avéré qu'à tous les stades de
l'hominisation, y compris celui de l'Homme moderne, l'Afrique
orientale est restée le lieu où les mutations majeures se sont d'abord
produites, tant dans l'anatomie du squelette que dans l'évolution des
industries lithiques, mais toujours de façon décalée dans le temps.
Les périodes arides, donc de
difficultés de survie et de rassemblement à proximité de points d'eau,
ont toujours été un facteur de progrès. Le rôle des datations dans la
connaissance de ces processus a été fondamental. Mais en ce qui concerne
le phylum humain, la génétique a apporté, de son côté, des
éléments essentiels. Si le consensus a été acquis assez facilement au
stade des Homo erectus, il n'en fut pas de même au stade de
l'Homme moderne (Homo sapiens sapiens).
C'est tout récemment
seulement qu'ont été abandonnées les théories soutenues à l'encontre de
celle dite de 'l'arche de Noé' selon laquelle seuls les Hommes
modernes d'Afrique ont échappé à l'extinction et ont remplacé
complètement les derniers descendants des Homo erectus évolués
et/ou des Homo sapiens archaïques et/ou des Néandertaliens
qui s'étaient perpétués en Asie et en Europe, plus ou moins longtemps.
Les travaux de l'équipe de
généticiens chinois et texans qui ont démontré que les Hommes modernes
extrême-orientaux étaient, eux aussi, des Africains (Proceedings of
the National Academy of Sciences, Etats-Unis, vol.95, septembre
1998) rendent caduques :
1) la théorie dite
du candélabre selon laquelle chaque continent aurait eu sa lignée
propre à partir d'Homo erectus (polygénisme).
2) la théorie dite
réticulaire selon laquelle (les Néandertaliens d'Europe mis à
part) des échanges constants de gènes entre Asie et Afrique auraient
unifié le patrimoine génétique des premiers hommes modernes par de très
fréquentes migrations réciproques. C'est transformer en phénomène
prépondérant un fait qui n'a pu être que marginal et localisé durant la
préhistoire.
Certains spécialistes (comme
M. Wolpof aux USA, Wu Xhingsi en Chine, R. Thorpe en Australie, ...)
tendent à revenir maintenant à la théorie polygéniste en raison de la
constance des formes 'asiatiques' de la tête osseuse à différents stades
de l'hominisation en Chine, et, aussi, en raison de la permanence des
types locaux d'industire lithique vers -60000.Mais, jusqu'à présent, les
lacunes chronologiques et morphologiques ne sont pas comblées, et le Dr.
J.N. Biraben, par exemple, indique à juste titre, qu'une ' évolution
sur place en plusieurs régions éloignées pour donner les différents
types humains actuels [variantes d'un même Homo sapiens sapiens]
... supposerait des convergences si nombreuses, que ce serait un cas
unique dans l’histoire des êtres vivants ". (J.N. Biraben et M.L.
Marcillo, 1977, 'Les étapes du peuplement des continents', in Actes
du Congrès International de Mexico sur la population).
Cette position monogéniste a
été, depuis, entièrement confirmée par la génétique
(cf.
J. Chaline,
Un million de
générations, Editions du Seuil, 2000, chapitre 15). Les
faits relevés à son encontre peuvent facilement s'expliquer par une ou
plusieurs migrations à des stades successifs d'évolution de
ressortissants africains dotés d'une morphologie 'asiatique'[31],
localisés dans une région d'Afrique orientale géographiquement favorable
à un déplacement vers l'Asie du Sud. L'unique site moustérien
(sans homme fossile associé) daté de 60000 ans, situé au Nord-Ouest de
la Chine, laisse simplement supposer qu'un nouvel arrivant, Homo
sapiens archaïque récent ou Néandertalien
d'Uzbékistan, n'a pas dépassé cette région dans sa marche vers l'Est,
tandis que des Homo erectus évolués, et/ou des Homo sapiens
archaïques plus anciens, perduraient encore à cette date dans
l'ensemble de la Chine, -
l'Homo sapiens sapiens lui-même n'y arrivant que vers 20000 BC.
L'idée selon laquelle les
Hommes modernes européens auraient pu être issus des
Néandertaliens est réfutée et abandonnée depuis plusieurs années.
Tout au plus certains spécialistes évoquent la possibilité de quelques
hybridations entre Néandertaliens et Hommes modernes. De
même pour les hommes modernes africains qui auraient pu rencontrer en
Asie des descendants tardifs d'Homo sapiens archaïques ou d'Homo
erectus évolués. Cela supposerait une interfécondité qui n'est pas
démontrée.
Il est clair aujourd'hui que
les Néandertaliens ont constitué une lignée latérale, marginale,
en cul-de-sac. La lignée africaine, continue, constitue le tronc. Aussi
est-il étonnant qu'on puisse voir présenter dans la littérature de
vulgarisation la section chronologique située entre l'Homo sapiens
archaïque et l'Homme moderne de Cro-Magnon sous le
titre 'Les Néandertaliens et leurs contemporains'. C'est d'autant plus
choquant que les premiers hommes anatomiquement modernes typiques
d'Afrique orientale sont nés plus de vingt mille ans avant les Néandertaliens typiques. De même, le fossile capital
Omo 1
peut être présenté avec les Homo sapiens archaïques en signalant
discrètement qu'il est anatomiquement moderne. Dans les deux cas, les
branches latérales sont mises en évidence tandis que le tronc est
escamoté.
Par ailleurs, si le
Paléolithique inférieur africain est décrit logiquement, en commençant
par l'Afrique orientale, il n'en est pas de même à partir du
Paléolithique moyen. L'habitude est conservée de commencer par l'Afrique
du Nord alors que le Maghreb apparaît comme une zone terminus où les
hommes arrivent de temps en temps - soit après avoir traversé le Sahara
(seulement si la phase pluviale a été assez longue et assez accentuée) -
soit en longeant la côte
depuis la Basse-Egypte. Les gisements y sont très sporadiques par
rapport à l'Afrique orientale et plus récents à niveau égal d'industrie
ou de stade d'hominisation. Quand l'isthme hispano-marocain a été
utilisé lors de la régression rissienne, c'est dans le sens sud-nord,
ainsi que l'a expliqué H. Alimen, car les stations à hachereaux en
Europe ' montrent que ces pièces sont issues de l'acheuléen africain
". Il en est de même pour l'isthme siculo-tunisien. Avec cet ordre
géographique, cette succession de tableaux régionaux (sans lien entre
eux) indépendante de l'ordre chronologique, le lecteur n'a plus en tête
qu'une mosaïque d'industries et de fossiles, sans fil conducteur.
Si peu nombreuses que soient
encore aujourd'hui les datations, elles permettent déjà de se faire une
idée du processus de développement des hommes et de leurs industries à
partir de l'Afrique orientale durant le Paléolithique moyen et le
Paléolithique supérieur.
Ce n'est qu'à partir
d'environ 12000 ans avant J.C. que cette primauté de l'Afrique orientale
disparaît au profit du sud du Sahara Oriental, de la Basse-Nubie et de
la Haute-Egypte et aussi de certaines régions d'Asie proches de
l'Afrique orientale c'est-à-dire un certain nombre de sites de l'Asie
occidentale où l'Homme moderne est arrivé très tôt en passant par
l'isthme de Suez et où il a trouvé des conditions de vie analogues :
groupes humains dont la survie exige qu'ils s'organisent à proximité de
points d'eau et de cours d'eau en climat aride ou semi-aride.
En tout cas, il apparaît que
dans la littérature on n'accorde pas à Omo 1 la place qu'il
occupe réellement dans l'évolution chronologique et anatomique de
l'Homme. Il y a lieu d'insister sur le fait qu'il est, à ce jour, le
plus ancien Homme moderne (ou Homo sapiens sapiens) connu
; il a été trouvé in situ, les caractéristiques de son crâne sont
claires, et il a été daté d'environ 130 000 ans par la méthode de
l'Uranium-Thorium. Même si la suspicion persiste quant à la
fiabilité de cette datation, en supposant une approximation de 10000 ans
(en moins ou en plus), ce fossile de l'extrême sud de l'Ethiopie reste
l'attestation la plus sére et la plus ancienne de l'apparition de notre
ancêtre direct caractérisé principalement par le développement du lobe
frontal du cerveau. Ë ce jour, il est, à l'échelle mondiale, le fossile
clé.
Cependant, il faudrait
pouvoir dater les 'Hommes de Kanam-Kanjéra’ découverts sur les
bords du lac Victoria-Nyanza en 1932, mais dans un contexte
stratigraphique discuté. Il s'agit d'une portion de mandibule, de
fragments de crânes et d'une portion de fémur dont H. Alimen a écrit que
' les anthropologistes ont été unanimes à les regarder comme des Homo
sapiens ... la mandibule ainsi que les os du crâne sont seulement plus
épais que ceux des hommes modernes " (Préhistoire de l'Afrique,
1955 p.391). Dans le volume 1 de l'Histoire générale de l'Afrique
(Unesco, 1980 p.476 et 552), R. Leakey et J.D. Clark leur attribue une
ancienneté de 200 000 ans environ. L'industrie associée est classée acheuléenne. Il serait du plus grand intérêt de les réétudier et de
dater les os eux-mêmes. Il serait également nécessaire de dater les
couches inférieures de la grotte de Matupi (située dans le Nord-Est du
Congo-Kinshasa) dont on sait qu'elles sont antérieures à 40000 ans.
Parmi les sites et vestiges
qui devraient aussi concentrer les efforts prioritairement, indiquons la
région de Nok (Nigéria), les ruines de Télé Nugar (Tchad), la région
Nord-Est de la Centrafrique, le site de Ndalane au Sénégal. La liste
pourrait s'allonger.
En fait, comme l'écrit
Graham Connah, les régions prospectées sont comme des ' îles
d'information dans un espace où les archéologues n'ont pas encore
fouillé le centième de ce qui devrait l'être ".
La tâche qui reste à
accomplir est certes considérable, mais elle est indispensable à la
connaissance de la préhistoire du monde et de l'histoire de l'Afrique.
Il serait donc souhaitable que les organismes et fondations à vocation
culturelle contribuent 1°) à former davantage d'archéologues
africains 2°) à organiser des fouilles plus nombreuses dans des
sites particulièrement significatifs (ainsi que le repérage de sites
prometteurs jusque là passés inaperçus), et enfin 3°) à faciliter
les datations.
L'apport des datations à la
connaissance de l'Afrique sur la période s'étendant de la fin de la
civilisation égypto-nubienne au XVIème siècle confirme
l'hypothèse de travail formulée par Cheikh Anta Diop en 1954 dans Nations nègres et Culture, puis reprise
dans l'Afrique
noire précoloniale en 1959, portant sur la continuité et la
corrélation historiques entre les civilisations nègres de la vallée du
Nil et celles contemporaines ou ultérieures (comme les grands empires de
l'Afrique de l'Ouest : Ghana, Mali É) situées plus à l'intérieur du
continent. Il convient aussi de se reporter aux travaux de A. M. Lam
dans De l'origine égyptienne des Peuls (1993, Présence
Africaine/Khepera) et Les Chemins du Nil (1997, Présence
Africaine/Khepera). Son étude des migrations anciennes en Afrique l'a
conduit à conclure : "Le départ initial est bien l'Egypte ; mais
comme le danger vient du nord, les contraintes géographiques de la
région ont obligé les populations à se replier vers le sud avant un
ébranlement définitif qui va les disperser dans le continent" (Les
Chemins du Nil, p. 164).
Les résultats des datations
conduisent à proposer une réactualisation de la chronologie du passé
africain depuis la préhistoire. Une nouvelle vision en découlera tout en
faisant apparaître les périodes où l'effort de connaissance doit être
intensifié en faisant appel à toutes les sources : l'archéologie, la
linguistique, les textes, la tradition orale, la génétique, etc. D'autre
part, les nouvelles données devraient être insérées dans les manuels
scolaires et universitaires.
Notes et références
bibliographiques
1.
Cheikh Anta Diop, Physique nucléaire et chronologie absolue,
IFAN-Dakar/NEA, Dakar/Abidjan, 1974 ; P. R. Giot, L. Langouet, La
datation du passé - La Mesure du Temps en Archéologie, Revue
d'Archéométrie, GMPCA, Université de Rennes, 1984 ; E. Roth et B.
Poty (sous la direction de), Méthodes de datation par les
phénomènes nucléaires naturels. Applications, Ouvrage collectif,
Paris, Masson, 1985. Michel Fontugne, 'Progrès de la datation par le
Carbone 14', Archéologia, n°323, mai 1996, pp. 26-33.
2.
Industrie lithique primitive caractérisée à Olduvaï (ou Oldoway).
3.
Larsen C.S. Matter R.M et Gebo D.L, 'Human Origins. The Fossil
Record', Waveland Press. 1991, cité par D. Grimaud - Hervé et al.
op. cit.
4.
Une 'bladelet industry’ est toutefois signalée sur la côte
Atlantique du Maroc vers 27700 ans par Angela Close dans ‘Stone Age
Préhistory' 1986, GN Bailey et P. Callow eds, Cambridge, p. 169
-180. Mais quel est son classement ?
5.
Terme dérivé du nom du site préhistorique de Gafsa en Tunisie.
6.
LL. Cavalli-Sforza et al., 'Reconstruction of human Evolution :
Bringing together Genetic, Archaeological and Linguistic Data' Pro.
Ntl Acord-Sci.USA, vol. 1985, pp. 6002-6006, August 1988, après les
si remarquables articles de G. Bräuer depuis 1982 et plus spécialement :
Bräuer, G. (1984b). 'A craniological approach to the origin of
anatomically modern Homo sapiens in Africa and implications for the
appearance of modern Europeans'. In : Smith, F. H. and F. Spencer (eds),
The Origins of Modern Human. A World Survery of the
Fossil Evidence, A.R. Liss, New York : 327-410.
7.
Cheikh Anta Diop, 'Histoire primitive de l'Humanité : Evolution du monde
noir', Bulletin de l'IFAN, T. XXIV, série B, n° 3-4, 1962, p. 449
; Cheikh Anta Diop, 'L'apparition de l'Homo sapiens",
Bulletin de l'IFAN, T. XXXII, série B, n°3, 1970, pp. 623- 641.
8.
Cro-Magnon est alors devenu abusivement synonyme de
Homo
sapiens sapiens ou homme moderne (ce qui embrouille
singulièrement la compréhension du processus).
9.
E. Genet-Varcin (1979) note que 'les négroïdes de Grimaldi sont plus
proches de Combe Capelle (qualifié d'éthiopique) que de Cro-Magnon"
(p. 181 et sq.). Elle affirme que la composante sapiens du fossile de
Combe Capelle a évolué lentement, tandis que celle correspondant à
Cro-Magnon, d'ailleurs différente, 'a connu une expansion rapide".
Ce qui s'accorde bien avec l'hypothèse de Cheikh Anta Diop.
10.
L. M. Diop, Thèse de Doctorat d'Etat, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, 1983, Document de synthèse, Bibliothèque de la
Sorbonne, p. 34, 43, 45.
11.
Babacar Sall, 'Hommes et Cultures du Sahara ancien', ANKH, n°
6/7, 1997-1998, pp. 121-137. E. Genet-Varcin (1979) note (à propos des
hommes de Djebel Irhoud), que les hommes d'Afalou bou Rhummel qui ont
servi à caractériser l'homme de Mechta, ont, en fait, un prognatisme
alvéolaire (pp 244 et 268). Et ces hommes sont apparentés à ceux de Wadi
Halfa É Comment sont-ils décrits ? : Epaules larges, allongement
caractérisé des avant-bras et des jambes, trou nasal platyrrhinien,
mâchoire inférieure puissante, avulsion des incisives médianes
supérieures comme chez de nombreux hommes fossiles d'Afrique noire (cf.
H. Alimen, 1955, p. 400).
12.
Cf. L. M. Diop-Maes, Afrique noire : démographie, sol et histoire,
Paris, Présence Africaine/Khepera, pp. 287-288 ; Ivan Van Sertima,
Ils y étaient avant Christophe Colomb, Paris, Flammarion,
(1976) traduction française 1981.
13.
Une barque de pêcheurs africains est arrivée récemment sur cette côte
avec 2 survivants sur 5 (Cf. film documentaire : 'Les premiers hommes
d'Amérique' de J. Cl. Bragard (G.B., 1999) qui néanmoins fait venir ces
premiers hommes de type noir, d'Australie !).
14.
J. McKim Malville, F. Wendorf, A. A Mazar, Romuald Schild, 'Megaliths
and Neolithic astronomy in southern Egypt', Nature, Vol 392, 2
April 1998, pp. 488-491.
15.
Günter Dreyer, 'Recent Discoveries at Abydos Cemetery U', in
The Nile
Delta in Transition : 4th-3rd millenium B.C.,
Tel Aviv, E.C. M. Van Den Brink Editor, 1992, pp. 293-299.
16.
Cf. Mario Beatty, 'Recent finds in Predynastic Egypt', dans ce même
numéro de ANKH.
17.
Stephen H. Savage, 'AMS Radiocarbon Dates from the Predynastic Egyptian
Cemetery, N700, at Naga-ed-Dêr', in Journal of Archaeological Science,
25, 1998, pp. 235-249.
18.
Jacques Labeyrie, L'Homme et le Climat, Paris, Editions
Deno‘l, 1985.
19.
Cf. Jacques Labeyrie : "Les méthodes de datation développées au CEA", in
Revue Générale Nucléaire, RGN, n° 6, novembre-décembre 1989, p.
446 ; voir aussi ANKH, n°1, éditorial inaugural, 1992.
20.
Bruce Williams, "Excavations between Abu Simbel and the Sudan frontier,
part I - The A-group royal cemetery at Qustul : Cemetery L", University
of Chicago, Oriental Institute Nubian Expedition, Vol. III, Chicago,
1986. Voir aussi ANKH, n° 6/7, 1997-1998.
21.
Bulletin d'Information Archéologique (BIA) dans son n° 5
couvrant la période janvier - juin 1992.
22.
Herbert Haas et al., 'Radiocarbon Chronology and the Historical
Calendar', in Egypt, Chronologies in the Near East, Aurenche O.,
Evin J. and Hours F. eds. BAR International Series, 1987, pp. 585-598.
Voir aussi, Brunet Albert, Actualité : 'Le pied du pharaon Djéser
va-t-il changer l'histoire de la IIIe dynastie’, in
Archéologia n°323, mai 1996, p. 5 '(...) ou alors, la
chronologie de la IIIe dynastie doit être repoussée dans le
passé de trois à quatre siècles, ce que d'autres résultats récents
tendent à accréditer. C'est l'opinion du groupe de chercheurs - Eugen
Strouhal, M. F. Gabalah, G. Bonanai, W. Woelfi, A. Nemeckova et S.
Saunders - qui communiquèrent leurs conclusions à Cambridge, lors du
VIIe congrès international des Egyptologues, en septembre dernier."
23.
Fekri A. Hassan, Steven W. Robinson, 'High precision radiocarbon
chronometry of ancient Egypt, and comparisons with Nubia, Palestine and
Mesopotamia', in Antiquity, 61, pp. 119-135, 1987 ; Andrew R.
Millard and Toby A.H. Wilkinson, 'Comment on 'AMS Radiocarbon Dates from
the Predynastic Egyptian Cemetery, N700, at Naga-ed-Dêr' by S. H.
Savage', in Journal of Archaeological Science, 26, 1999, pp.
339-241.
24.
Cf. L. M. Diop, 'La question de l'åge du Fer en Afrique', in
ANKH,
n°4/5, 1995-1996, pp. 278-302.
25.
G. Quéchon, F. Paris, J.F. Saliège, Journal des Africanistes, 62,
2, 1992, pp. 55-68.
26.
Cf. H. Bocoum, P. Fluzin, 'Réduction et traitement du fer à Sincu Bara
(Sénégal)', dans le présent numéro de ANKH.
27.
L. M. Diop, Afrique noire - Démographie, sol et histoire,
Paris, Présence Africaine /Khepera.
28.
Yashim Isa Bitiyong, 'Culture Nok, Nigeria', in Vallées du Niger,
ouvrage collectif, Paris, RMN, pp. 393-413.
29.
S.K. et R.J. Mac Intosh, 'Les prospections d'après les photos aériennes
: régions de Djenné et Tombouctou', in Vallées du Niger,
ouvrage collectif, Paris, RMN, pp. 239-248.
30.
S.K. et R.J. Mac Intosh, 'Prehistoric investigations at Djenne, Mali',
British Archaeology Report, Int. Series, 80 ;
31.
Environ 20% des hommes fossiles africains
Cartes de sites
archéologiques
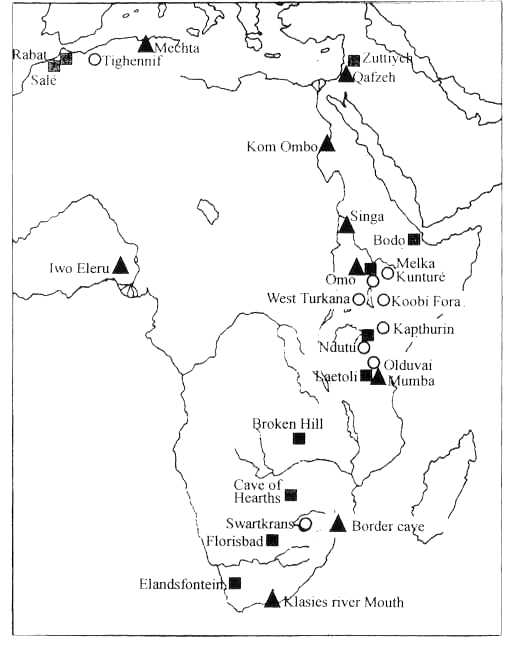
Sites d'hommes
fossiles importants (ˆ partir d'Homo ergaster).
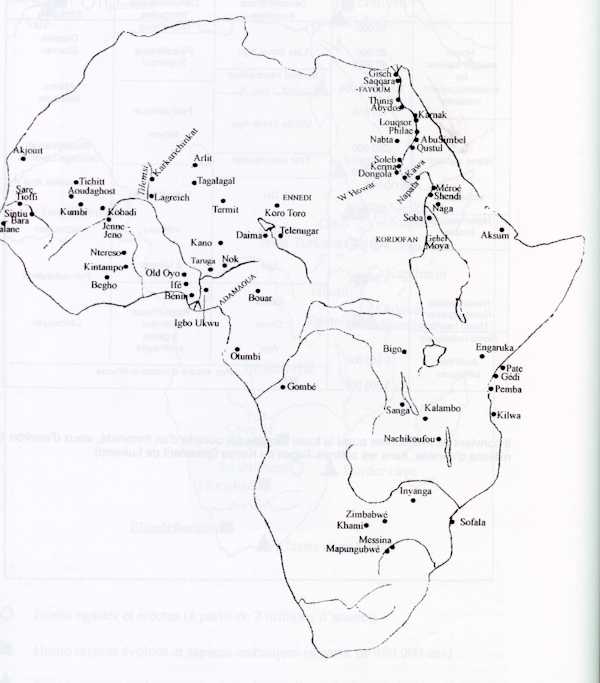
Divers sites
archéologiques (néolithiques,
préhistoriques, historiques) en Afrique.
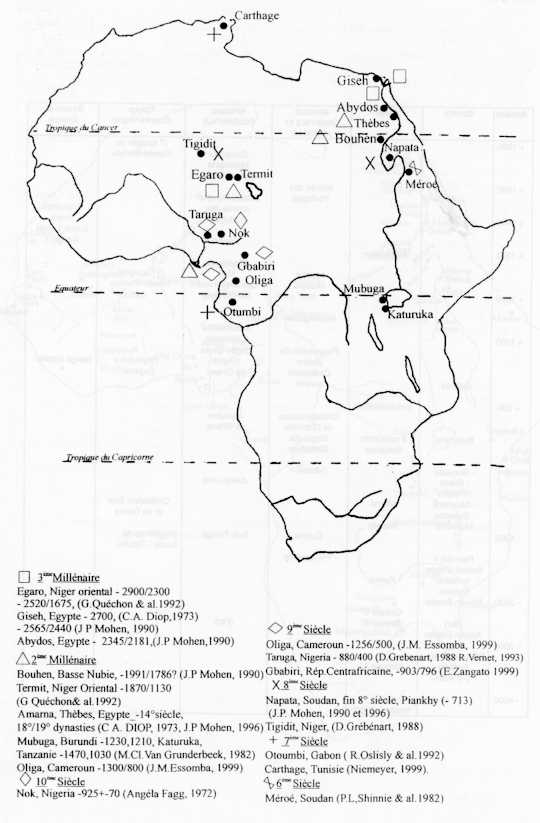
Sites anciens du
fer en Afrique antérieurs au 5e siècle av. J.C .
|

